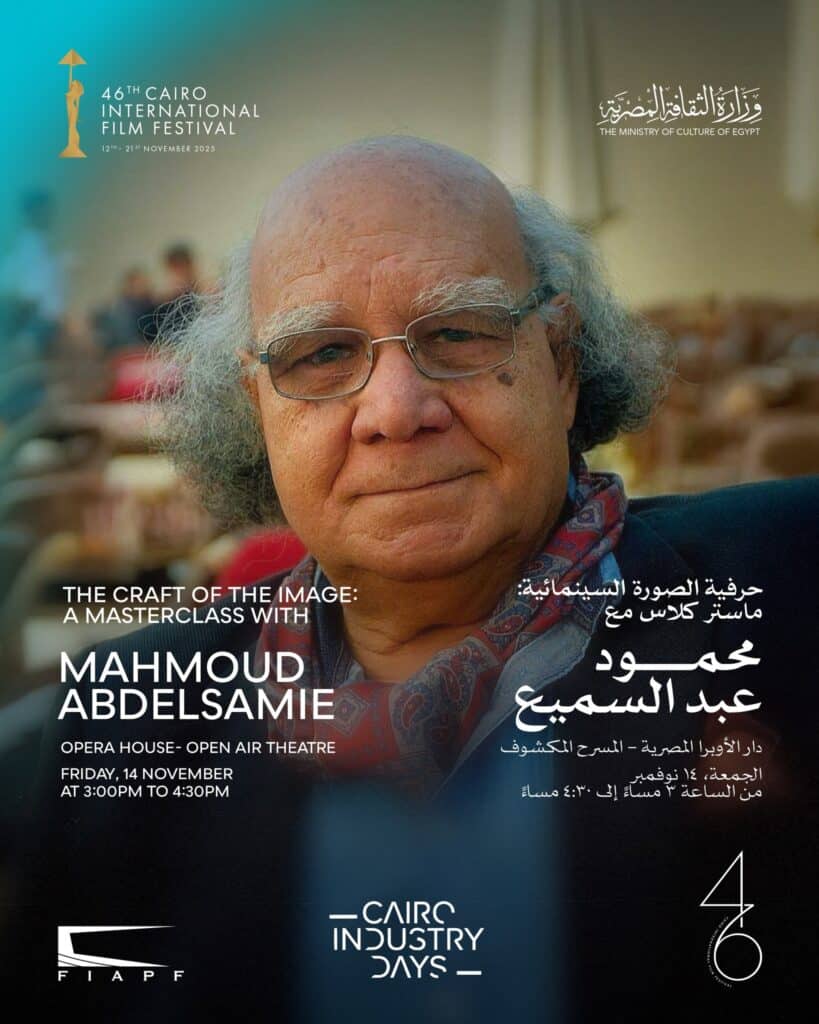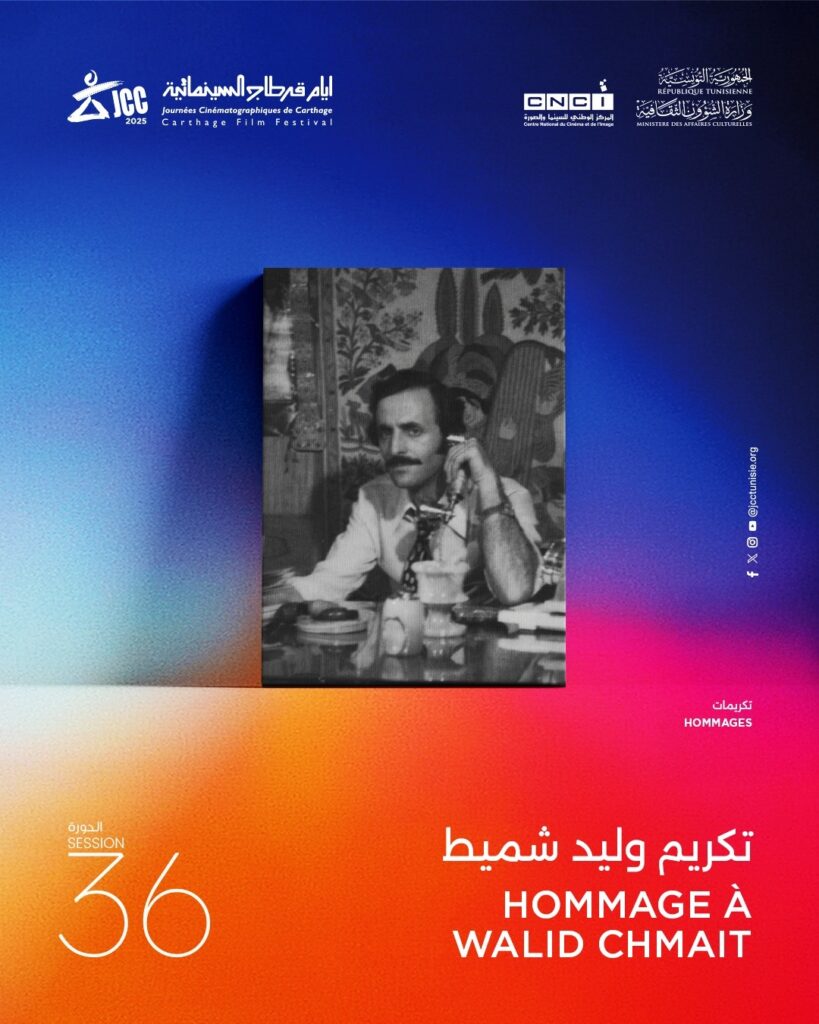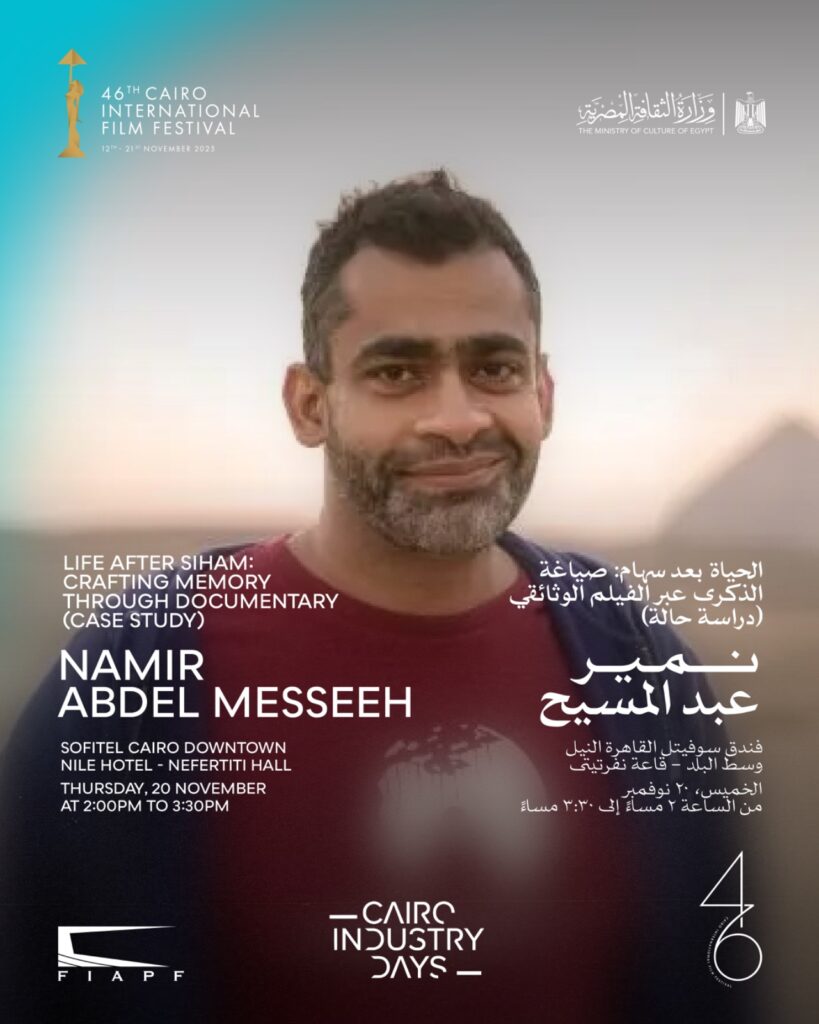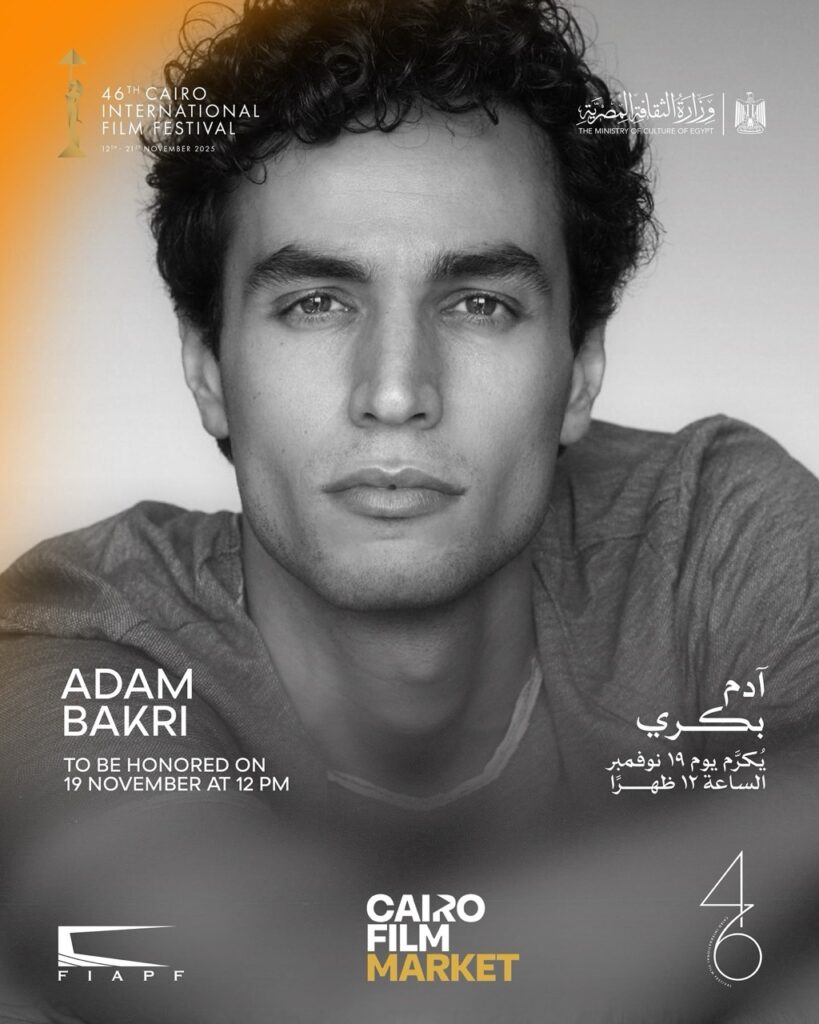CIFF 2025 – Le Grand Musée Égyptien et le cinéma : entre mémoire et immortalité
Le Festival international du film du Caire (CIFF) a cette année offert à ses invités une expérience singulière : une visite du Grand Musée Égyptien, ouvert au public une dizaine de jours avant l’ouverture du CIFF. Organisée pour les journalistes, réalisateurs, acteurs et professionnels du cinéma, cette excursion n’était pas un simple à-côté, mais le prolongement naturel de la programmation du festival : célébrer la mémoire, explorer le récit, transmettre par l’image.
Dans ce musée encore neuf, où les salles colossales respirent la pierre et le silence, le lien entre l’Égypte ancienne et le cinéma s’imposait avec évidence. L’un et l’autre cherchent à rendre visible ce qui ne doit pas disparaître. Pierre gravée et pellicule filmée participent du même combat contre le temps.
Une ouverture qui annonçait déjà le musée
Dès la cérémonie d’ouverture du CIFF, cette filiation entre l’art ancien et l’art moderne était apparue clairement. La vidéo inaugurale, liée à l’affiche officielle du festival, s’ouvrait sur la surface d’un mur de temple ancien. La texture de la pierre, à la fois brute et travaillée, occupait l’écran comme une matière vivante. Peu à peu, une pellicule s’y animait, glissant sur les hiéroglyphes, donnant vie aux signes antiques. Puis une colombe traversait lentement l’image, avant que la scène entière ne se fonde dans les couleurs de l’affiche de cette édition. (cliquez pour voir la vidéo ici)
Cette séquence condensait une idée forte : l’Égypte, avant d’être un décor, est une terre d’images. Les Égyptiens anciens avaient déjà inventé le récit visuel, racontant en images ce que les mots ne suffisaient pas toujours à dire. La pierre devenait le premier écran, la gravure le premier scénario, la lumière le premier projecteur. La vidéo affirmait ainsi que le cinéma n’est pas une invention étrangère à cette terre, mais une évolution naturelle de son art millénaire. Lorsque les invités se sont retrouvés devant les murs du Grand Musée Égyptien, ce prologue visuel jouait comme une préparation du regard : passer de la pierre filmée à la pierre réelle, du temple projeté à la pierre exposée.
Le musée : une première mondiale archéologique
Le Grand Musée Égyptien se déploie comme une œuvre monumentale dont l’architecture dialogue avec les pyramides de Gizeh. Volumes vastes, lumière naturelle, perspectives calculées : tout rappelle la grandeur de la civilisation qu’il abrite et associe solennité et modernité, comme un film restauré qui retrouve sa splendeur.
La visite offrait aux invités un privilège rare : découvrir des objets jamais exposés auparavant. Des trésors enfouis depuis des siècles, exhumés des réserves, apparaissaient pour la première fois. Pour des journalistes et des cinéastes habitués aux premières mondiales de films, l’émotion était familière : ici aussi, il s’agissait d’une véritable “première mondiale”, non plus cinématographique mais archéologique. Le musée devenait un espace de révélation.
Deux regards sur la mémoire : les journalistes et les réalisateurs
Parmi les visiteurs, les journalistes étaient les plus rapides. Caméras et téléphones en main, ils filmaient sans relâche, à la recherche de matière pour leurs articles, reportages ou émissions. Leur regard était celui du documentariste : saisir, enregistrer, accumuler les instants et les images.
Les réalisateurs, eux, prenaient davantage leur temps. Ils interrogeaient les guides, observaient la lumière sur la pierre, la place d’une statue dans l’espace, la façon dont un visage gravé semblait déjà cadré. Là où les uns collectaient des séquences, les autres imaginaient des plans. Le musée devenait ainsi le lieu de rencontre de deux écritures — journalistique et cinématographique — réunies par le même désir : transformer ce qu’elles voient en récit.
La monumentalité comme langage
Au fil de la visite, la cohérence entre la forme du musée et le fond de ce qu’il expose s’imposait. Son architecture répond au langage de la civilisation qu’il célèbre : monumentalité, verticalité, hiérarchie, équilibre. Chaque salle fonctionne comme un plan séquence, imposant un rythme, une progression, une montée vers la lumière. Le musée est construit comme un film : ouverture, tension, révélation.
Cette monumentalité n’est pas un simple effet de grandeur ; elle devient une manière de raconter. Les visiteurs, marchant entre colosses et vitrines, semblaient pris dans un récit dont ils étaient les figurants. C’est là l’une des parentés les plus évidentes entre le musée et le cinéma : tous deux utilisent l’art de la mise en scène pour transmettre une émotion et inscrire le spectateur dans un mouvement. Ici, la mise en scène n’est pas une illusion mais une architecture réelle, dans le prolongement des artistes anciens qui organisaient déjà tombes et temples comme des scénographies.
L’immortalité, un fil millénaire
Peu à peu, au fil des salles, une idée s’imposait avec une clarté presque bouleversante : l’immortalité.
Tout, dans la civilisation pharaonique, tend vers cette quête. Les anciens Égyptiens gravaient leurs noms pour qu’ils ne soient pas effacés, peignaient leurs visages pour qu’ils soient reconnus, racontaient leurs vies pour qu’elles soient transmises. Leur rapport à la mort n’était pas une fin, mais une continuité. La tombe, loin d’être un lieu de clôture, était une œuvre : un livre de pierre destiné à raconter ce que fut l’existence.
Cette volonté de durer, de survivre au temps, trouve dans le cinéma un écho presque parfait.
Les cinéastes, eux aussi, cherchent à préserver. Par leurs films, ils fixent des visages, des voix, des gestes et des émotions, immortalisant ce qui, sans eux, s’effacerait. Comme les hiéroglyphes sur la pierre, les images sur la pellicule sont des messages adressés à l’avenir.
Dans les salles du musée, ce parallèle devenait évident. Devant une statue au sourire intact, devant un relief encore coloré, on ne pouvait s’empêcher de penser à la persistance d’un plan, à la survie d’un visage sur un écran. L’art ancien et l’art moderne partageaient le même désir : ne pas disparaître.
Les artistes d’aujourd’hui, héritiers des artistes d’hier
Cette continuité n’a rien d’abstrait. Elle se lit dans la matière même.
En observant les sculptures, les fresques, les objets, on retrouvait la même obsession du détail, la même recherche de l’expression juste, la même volonté de mise en scène.
Les artistes de l’Égypte ancienne étaient des narrateurs visuels. Ils savaient diriger le regard, composer un plan, jouer avec la lumière naturelle. Ils mettaient déjà en œuvre, avec d’autres moyens, ce que le cinéma égyptien a su perpétuer : l’art de raconter en images.
Les réalisateurs d’aujourd’hui, d’une certaine manière, sont leurs descendants.
Héritiers de cette tradition de la représentation, ils la modernisent, la transforment, mais n’en perdent jamais l’esprit. Cette filiation invisible se lit dans l’histoire même du cinéma égyptien, qui fut longtemps la capitale du cinéma arabe. Cette vocation à raconter, à transmettre, à faire image, n’a jamais quitté le pays.
La Momie : la mémoire face au pillage
S’il est un film qui éclaire de manière presque directe la visite du Grand Musée Égyptien, c’est La Momie (1969) de Shadi Abdel Salam. Chef-d’œuvre du cinéma égyptien, le film prend pour sujet central le pillage des tombes pharaoniques. Il raconte l’histoire d’une tribu vivant de la revente clandestine d’antiquités, et celle d’un jeune homme qui découvre que la survie de sa communauté repose sur le vol organisé des morts. Derrière le récit, une question lancinante traverse tout le film : que devient une civilisation quand elle laisse sa propre mémoire être dispersée, bradée, détruite ?
Ce thème, au cœur de La Momie, trouvait un écho saisissant dans les salles du Grand Musée Égyptien. Une grande partie du patrimoine pharaonique a été pillée au fil des siècles, que ce soit par des voleurs agissant dans l’ombre ou par des prélèvements plus “officiels”, à une époque où l’archéologie et l’appropriation se confondaient souvent. Les objets exposés aujourd’hui sont, pour beaucoup, ceux qui ont réussi à échapper à cette disparition, ou que l’on a pu retrouver et préserver. Là où le film de Shadi Abdel Salam met en scène la perte et la culpabilité, le musée en offrait la réponse matérielle : sauver, conserver, protéger, pour que l’histoire reste accessible à tous.
La collection consacrée à Toutankhamon rend cette tension encore plus visible. Sa tombe, l’une des plus petites de la Vallée des Rois, a donné naissance à la plus vaste collection connue. Ce paradoxe s’explique par son histoire : après avoir été fermée, la tombe a été pillée une fois. Les intrus n’ont cependant pas pu emporter grand-chose ; elle a été refermée, puis est restée scellée jusqu’à sa “redécouverte” en 1922 par Howard Carter. Si elle est aujourd’hui au cœur du musée, c’est précisément parce qu’elle a échappé, en grande partie, au sort de tant d’autres tombes vidées de leurs trésors au fil des siècles.
Face à ces vitrines, La Momie prenait une résonance nouvelle. Le film raconte la dispersion des objets, la complicité silencieuse de ceux qui profitent du pillage ; le musée, lui, est le lieu où s’exerce l’effort inverse : celui de rassembler, de restaurer, de redonner un contexte. L’un et l’autre, chacun à leur manière, parlent de la même chose : ce qui est perdu, ce qui est sauvé, et ce que signifie, pour un pays, reprendre possession de sa propre mémoire.
La malédiction et la fascination : Toutankhamon au cinéma
Au cœur du musée, la collection la plus impressionnante reste celle de Toutankhamon.
Elle fascine par sa richesse et par le mystère qui entoure son nom. Très vite après la découverte de sa tombe en 1922, la mort de plusieurs membres de l’équipe de fouilles, amplifiée par la presse internationale, a nourri ce qui deviendra la célèbre “Malédiction du Pharaon”.
L’idée qu’un pharaon défendrait sa tombe au-delà de la mort n’a aucun fondement historique, mais elle a enflammé l’imaginaire collectif.
Le cinéma s’est emparé de cette légende dès les années 1930 : films d’horreur inspirés par les momies vengeresses, aventures exotiques des années 1950, puis relectures contemporaines mêlant science-fiction, archéologie et mystère.
Le premier et le plus marquant reste The Mummy de Karl Freund (1932), avec Boris Karloff dans le rôle d’Imhotep, directement inspiré par la découverte de la tombe de Toutankhamon. Ce film a façonné pour des générations l’image de la momie ressuscitée, vengeresse et immortelle, et a donné naissance à toute une série d’œuvres, des productions gothiques britanniques des années 1960, comme The Curse of the Mummy’s Tomb, jusqu’aux superproductions hollywoodiennes modernes, telles que The Mummy de Stephen Sommers (1999) et sa relecture de 2017.
Toutes ces variations, qu’elles relèvent de l’horreur, de l’aventure ou du fantastique, témoignent d’une même fascination pour la survie des morts et la peur de profaner un monde qui devait rester scellé.
Si cette “malédiction” appartient avant tout à l’imaginaire occidental, elle révèle surtout la fascination universelle que suscite l’Égypte ancienne : le désir de percer ses secrets, mais aussi la peur de toucher à ce qui devait demeurer sacré.
Face à la salle consacrée à Toutankhamon, on ne pouvait s’empêcher de penser à cette double vie du pharaon : momie réelle et personnage de fiction.
L’histoire archéologique et l’histoire filmée se répondaient comme deux miroirs, l’une enracinée dans la terre, l’autre projetée sur l’écran.
Cleopatra et les films restaurés : la mémoire du cinéma projetée au Caire
Un autre film prolongeait ce dialogue entre l’Égypte ancienne, le musée et le festival : Cleopatra de Joseph L. Mankiewicz (1963). Cette fresque monumentale de Hollywood, longtemps associée à ses excès de production, a retrouvé une nouvelle vie grâce à sa version restaurée et rediffusée en 2024 dans la section Cairo Classics du CIFF.
Ce n’était pas un simple “coup” de programmation, mais le reflet d’une conviction : la restauration d’un film relève du même geste que celle d’une œuvre archéologique — préserver, réparer, transmettre.
En projetant Cleopatra dans une copie restaurée, le CIFF redonnait au public la possibilité de revoir l’Égypte antique telle qu’Hollywood l’a rêvée, dans des conditions respectueuses de l’œuvre originale.
Ce dialogue entre le musée et la salle de projection s’imposait avec évidence : ici comme là, il s’agit de sauver des images — qu’elles soient sculptées, peintes ou filmées — du risque d’effacement.
L’Émigré : entre foi, identité et transmission
Cette année, un autre film venait rappeler la puissance symbolique de l’Égypte ancienne : L’Émigré de Youssef Chahine, projeté dans la section Cairo Classics. Grand film sur la quête spirituelle et l’identité, L’Émigré raconte l’histoire d’un jeune homme inspiré de la figure biblique de Joseph. Youssef Chahine y met en scène l’Égypte antique non pas comme décor, mais comme miroir de la conscience moderne. À travers ce récit, il interroge la transmission, la foi, la liberté et la responsabilité des artistes face à leur héritage.
Cette redécouverte du film prenait une dimension particulière cette année : le festival rendait hommage à son acteur principal, Khaled El Nabawy, lauréat du Prix Faten Hamama d’excellence.
Lors de la rencontre avec le public, il a évoqué avec émotion ce rôle fondateur, expliquant combien il avait marqué sa carrière et sa manière d’aborder le cinéma.
Revoir L’Émigré dans Cairo Classics, puis écouter Khaled El Nabawy parler de cette expérience, prolongeait la visite du musée sous une autre forme : celle d’une transmission vivante, d’un dialogue entre passé et présent.
Dans cette filiation entre les artistes d’hier et ceux d’aujourd’hui, L’Émigré agit comme un pont. Youssef Chahine y explore avec une liberté artistique l’héritage pharaonique, prolongeant le geste des artisans pharaoniques : raconter en images, interroger le sens du monde.
Et en marchant dans les galeries du musée, où les statues semblaient regarder ceux qui les contemplaient, on percevait combien le film et le lieu dialoguaient silencieusement : là où les sculpteurs anciens façonnaient la pierre pour qu’elle survive au temps, Youssef Chahine et Khaled El Nabawy animaient ce même passé par le cinéma, lui redonnant souffle et regard.
Le festival, le musée, et l’idée d’immortalité
En sortant du musée, un sentiment d’unité s’imposait. Le Festival du Caire et le Grand Musée Égyptien semblaient liés par une même énergie : la préservation de la mémoire. L’un expose des films, l’autre des objets ; mais tous deux racontent l’histoire d’un peuple à travers ses images. Le CIFF, en organisant cette visite, affirmait que la culture n’est pas un spectacle, mais une continuité : celle d’un regard qui se transmet de génération en génération.
L’immortalité, dans ce contexte, n’est pas une abstraction métaphysique. C’est une pratique concrète : filmer, graver, exposer, transmettre.
L’art ancien et le cinéma égyptien partagent cette même obstination à durer.
Et c’est peut-être pour cela que cette excursion a tant marqué ses participants : elle leur rappelait que leur métier, au fond, consiste à faire ce que les Égyptiens faisaient déjà il y a quatre mille ans — raconter le monde pour ne pas qu’il disparaisse.
Et si un film naissait de cette visite ?
Cette visite du Grand Musée Égyptien n’était donc pas un simple événement protocolaire du CIFF. Elle s’inscrivait dans la logique profonde du festival : celle de faire dialoguer le passé et le présent, le visible et le raconté.
Et, au-delà de la découverte des trésors, elle éveillait une curiosité : parmi ces réalisateurs présents, l’un ou l’une d’entre eux aura-t-il eu l’intuition d’un film ? Une idée a-t-elle germé dans le silence d’une salle ? Quelque chose naîtra-t-il de cette rencontre entre pierre et pellicule ?
Peut-être qu’un jour, sur un écran, apparaîtra un plan inspiré de cette visite : un visage, une lumière, un souvenir. Et l’on pourra dire alors que, du musée au festival, l’histoire n’aura jamais cessé de s’écrire.
Neïla Driss
L’article CIFF 2025 – Le Grand Musée Égyptien et le cinéma : entre mémoire et immortalité est apparu en premier sur webdo.