« Métiers vivants, patrimoine durable » : exposition à Dar El Bey pour valoriser les artisans de la médina de Sousse
 La médina de Sousse vient d’accueillir la cérémonie de clôture de la première phase du projet d’intégration des stratégies de conservation, du tourisme et des moyens de subsistance locaux sur les sites du patrimoine mondial, dans le cadre du programme de l’UNESCO “Gestion des sites du patrimoine mondial post-Covid-19”. Financé par le Fonds japonais de développement et mis en œuvre depuis 2023 par l’Institut National du Patrimoine (INP), en partenariat avec le Bureau régional de l’UNESCO pour le Maghreb et plusieurs institutions tunisiennes, ce projet vise à renforcer les métiers d’art comme levier essentiel de revitalisation économique, culturelle et patrimoniale de la médina de Sousse, classée patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1988. Une exposition dédiée aux artisans, à leurs créations et aux résultats de cette première phase se tient à Dar El Bey du 24 novembre au 24 décembre 2025.
La médina de Sousse vient d’accueillir la cérémonie de clôture de la première phase du projet d’intégration des stratégies de conservation, du tourisme et des moyens de subsistance locaux sur les sites du patrimoine mondial, dans le cadre du programme de l’UNESCO “Gestion des sites du patrimoine mondial post-Covid-19”. Financé par le Fonds japonais de développement et mis en œuvre depuis 2023 par l’Institut National du Patrimoine (INP), en partenariat avec le Bureau régional de l’UNESCO pour le Maghreb et plusieurs institutions tunisiennes, ce projet vise à renforcer les métiers d’art comme levier essentiel de revitalisation économique, culturelle et patrimoniale de la médina de Sousse, classée patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1988. Une exposition dédiée aux artisans, à leurs créations et aux résultats de cette première phase se tient à Dar El Bey du 24 novembre au 24 décembre 2025.
A cette occasion, le directeur général de l’INP et l’ambassadeur du Japon en Tunisie ont présidé la cérémonie de clôture dans la médina de Sousse, en présence notamment des représentants du Bureau régional de l’UNESCO pour le Maghreb, du secrétaire général chargé de la gestion de la municipalité de Sousse, de la directrice générale de l’Office national de l’artisanat, ainsi que de nombreux cadres de l’INP, des institutions partenaires et de représentants de la société civile.
L’INP, à travers la division de la Sauvegarde des Monuments et Sites et l’Inspection régionale du Sahel, a commencé à mettre en œuvre ce projet en 2023. L’objectif est d’intégrer les stratégies de préservation, de promotion touristique et de développement des moyens de subsistance locaux dans la gestion de la médina de Sousse avec l’ambition de contribuer à la préservation du caractère vivant de la médina, en soutenant des activités artisanales et en ouvrant de nouvelles perspectives économiques pour les communautés locales.
L’idée du projet repose sur une approche intégrée qui dépasse la simple restauration physique du tissu historique, favorisant la durabilité des pratiques culturelles et économiques qui animent la médina. En renforçant les compétences des artisans participants, le projet valorise leurs savoir-faire, stimule leur créativité tout en maintenant des activités en harmonie avec le caractère patrimonial du site.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la dynamisation de la médina de Sousse, témoignage exceptionnel de l’urbanisme arabo-musulman en Méditerranée. Cependant, la valeur patrimoniale de la médina ne réside pas seulement dans la monumentalité de ses édifices, mais également dans la vitalité de ses activités, où l’artisanat, mêlant traditions ancestrales et innovations modernes, constitue un moteur social et économique.
Dans le contexte de cette clôture, une exposition artistique “Métiers vivants, patrimoine durable” inaugurée au centre culturel de Dar El Bey, a offert l’occasion de rencontrer les artisans participants et de découvrir les résultats de la première phase, mettant en lumière leurs créations dans des domaines variés tels que les bijoux, le cuir, la résine, le design, l’artisanat lapidaire, la céramique, la tapisserie, le moulage, le macramé, l’artisanat de poupées…une exposition qui a donné à admirer des œuvres, où chaque pièce est un témoignage vivant d’un lieu qui respire, qui inspire et qui vit, invitant le visiteur à re/découvrir cette médina autrement.
L’article « Métiers vivants, patrimoine durable » : exposition à Dar El Bey pour valoriser les artisans de la médina de Sousse est apparu en premier sur WMC.
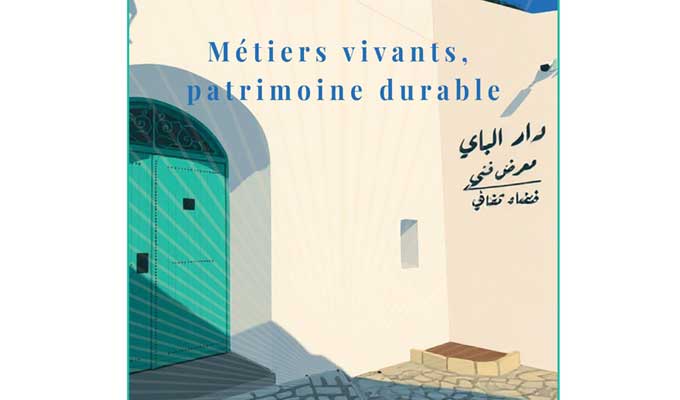 La Première exposition sur les “Métiers vivants, patrimoine durable” qui fait partie d’un projet de l’UNESCO visant l’intégration des stratégies de conservation, de tourisme et des moyens de subsistance locaux sur les sites du patrimoine mondial après la pandémie de COVID-19″ aura lieu 24 novembre au 24 décembre 2025 à Dar El Bey à Sousse.
La Première exposition sur les “Métiers vivants, patrimoine durable” qui fait partie d’un projet de l’UNESCO visant l’intégration des stratégies de conservation, de tourisme et des moyens de subsistance locaux sur les sites du patrimoine mondial après la pandémie de COVID-19″ aura lieu 24 novembre au 24 décembre 2025 à Dar El Bey à Sousse.