Comment reconstruire une alternative écosociale ?
Dans presque tous les pays démocratiques, un même paysage politique s’installe : la droite avance, se durcit, se divise en courants toujours plus identitaires ou nationalistes. L’extrême droite, longtemps confinée aux marges, devient un acteur central ; elle gouverne déjà dans plusieurs pays européens, influence les agendas politiques ailleurs, bouscule les débats nationaux partout. En parallèle, la gauche de gouvernement semble épuisée, fracturée, parfois incapable d’articuler un projet social crédible. Quant aux partis écologistes, malgré leur dynamisme, ils ne parviennent pas à incarner une alternative majoritaire. Faut-il en conclure que la gauche est entrée dans une longue phase crépusculaire ? Ou qu’une autre voie est possible, à condition de repenser ce que pourrait être, au XXIᵉ siècle, une alternative écosociale ?
Zouhaïr Ben Amor *
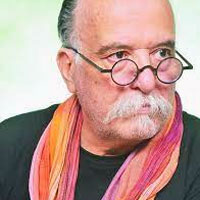
Ce débat, loin d’être théorique, interroge le cœur même des démocraties contemporaines. Car lorsque l’horizon politique se réduit à la confrontation entre une droite radicalisée et une gauche désorientée, l’ensemble du champ démocratique se trouve fragilisé. Cet article propose un éclairage journalistique sur les raisons de cette recomposition et esquisse les contours d’une refondation possible.
Pourquoi la droite radicale progresse ?
La première explication est socio-économique. Depuis plus de vingt ans, les rapports de l’OCDE et de nombreux politistes francophones décrivent l’enracinement d’une insécurité sociale durable. Le sociologue français Didier Eribon, dans ‘‘Retour à Reims’’ (2009), éclairait déjà ce basculement : une partie du monde ouvrier, jadis bastion électoral de la gauche, s’est sentie délaissée, ignorée, voire méprisée par les partis progressistes traditionnels. Ce sentiment n’est pas qu’une réalité française : on le retrouve en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Suède, ou encore au Canada.
Dans des ouvrages comme La France périphérique (2014), Christophe Guilluy développe une thèse similaire : la mondialisation, les métropoles attractives et les transitions économiques ont laissé derrière elles des territoires «désindustrialisés», où la fermeture des gares, des écoles, des maternités, des postes et des usines alimente une colère sourde. Que ce diagnostic soit parfois contesté importe moins que sa résonance : la droite radicale y trouve un espace où capter frustrations, rancœurs et sentiment d’abandon.
Le mécanisme est connu : lorsque les services publics reculent, lorsque les protections sociales se réduisent, lorsque les salaires stagnent mais que les prix augmentent, les discours simplificateurs trouvent un écho puissant. L’extrême droite identifie des coupables — migrants, élites, étrangers, institutions supranationales — et propose des réponses rapides, émotionnelles, symboliquement fortes.
À cette insécurité matérielle s’ajoute un malaise politique. Le politologue belge Jean-Yves Camus, spécialiste des droites extrêmes, souligne dans plusieurs conférences récentes que les partis d’extrême droite prospèrent particulièrement dans les pays où la confiance envers les institutions est faible. Or les enquêtes du Cevipof en France, de l’UCLouvain en Belgique ou de Sciences Po Grenoble montrent une chute spectaculaire de cette confiance depuis les années 2000.
Les parlementaires sont perçus comme distants ; les partis traditionnels, comme des appareils ; les gouvernements, comme des gestionnaires sans vision. D’où un désir de rupture.
L’extrême droite arrive alors comme une force «anti-système», même lorsqu’elle participe depuis longtemps au système politique. Elle canalise une demande de rupture plutôt qu’une adhésion doctrinale.
La droite radicale avance aussi sur le terrain culturel. Sur les questions identitaires, religieuses, mémorielles, elle impose son récit : celui d’une nation menacée, d’une culture en péril, d’une cohésion qui se dissoudrait sous les effets de l’immigration ou du multiculturalisme.
Des essayistes comme Alain Finkielkraut, dans un autre registre que l’extrême droite, ont contribué à installer dans le débat public l’idée d’une «crise identitaire». Ces discours, combinés à une amplification médiatique parfois sensationnaliste des faits divers, nourrissent l’idée que l’insécurité serait omniprésente — même lorsque les chiffres officiels montrent une réalité plus nuancée.
Pourquoi la gauche s’essouffle ?
Une large littérature sociologique francophone, de Louis Chauvel à Bruno Amable, documente la fragmentation de la gauche. Elle ne parvient plus à rassembler salariés, fonctionnaires, enseignants, classes populaires, jeunes diplômés, ouvriers et employés — chacun de ces groupes ayant désormais des intérêts divergents, voire opposés.
Le politologue français Thomas Piketty propose une lecture particulièrement éclairante : l’émergence de la «gauche brahmane», une gauche des diplômés, plus progressiste sur les questions culturelles que sur les questions économiques (Piketty, ‘‘Capital et idéologie’’, 2019). Ce déplacement sociologique a profondément modifié le discours de la gauche, parfois perçu comme trop moral, trop urbain, trop éloigné des réalités quotidiennes des classes populaires.
La philosophe Nancy Fraser, bien qu’américaine mais largement traduite en français, a exercé une grande influence dans les milieux intellectuels francophones. Elle parle de «néolibéralisme progressiste» pour désigner ces coalitions politiques qui mêlaient : 1- modernisation économique, dérégulation, réformes du marché du travail; 2- défense des minorités et des droits individuels.
Ce mélange a donné l’impression que la gauche avait délaissé les enjeux économiques pour se réfugier dans le symbolique. Les électeurs populaires, sentant leur vie se précariser, ont cessé de croire à la gauche comme force protectrice.
Enfin, la gauche souffre d’un déficit narratif. Elle ne propose plus un horizon collectif clair. Là où la droite radicale raconte une histoire simple (la nation menacée à défendre), la gauche peine à formuler un récit qui parle au cœur autant qu’à la raison.
Les mobilisations sociales existent — retraites, climat, santé — mais elles ne s’articulent pas toujours en projet global.
L’écologie peut-elle remplacer la gauche ?
Les partis écologistes ont progressé dans les urnes, surtout dans les métropoles. Ils ont imposé la question climatique au centre du débat public. Mais ils souffrent de deux limites : 1- un ancrage sociologique restreint : beaucoup de leurs électeurs sont urbains, diplômés, issus des classes moyennes supérieures ; 2- une perception sociale défavorable dans certains territoires : l’écologie est perçue comme une contrainte, une «punition», notamment lorsque les mesures touchent au carburant, au chauffage ou au coût du logement.
Les analyses de Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l’Ifop, confirment ce clivage : l’écologie gagne dans les centres urbains aisés mais peine en périphérie.
La sociologue Sophie Dubuisson-Quellier, dans ‘‘La consommation engagée’’ (2020), met en garde contre une écologie réduite à des gestes individuels (tri, bio, vélo). Ce discours, moral, culpabilisant, oublie la dimension collective et structurelle des crises écologiques.
Sans une perspective sociale, l’écologie reste minoritaire.
Une partie des politiques dites «vertes» se limite à verdir l’existant : voitures électriques hors de prix, compensation carbone, finance verte. Le tout reposant sur des marchés sans régulation.
Les économistes Gaël Giraud (ancien chef économiste de l’AFD) et Alain Grandjean dénoncent cette impasse : le capitalisme vert ne suffit pas à contenir la catastrophe écologique et produit souvent de nouvelles inégalités.
L’écologie seule ne peut donc pas remplacer la gauche. Mais sans l’écologie, la gauche n’a plus d’avenir. D’où la nécessité d’une synthèse : l’écosocialisme.
L’urgence d’une alternative écosociale
Le point de départ d’une refondation est simple : on ne convaincra pas les classes populaires de la nécessité d’une transition écologique si celle-ci augmente leurs factures, leur fatigue ou leur isolement. Comme l’écrit le politologue Paul Magnette dans ‘‘Écosocialisme’’ (2020), «il n’y aura pas de transition écologique si elle n’est pas socialement juste».
Une alternative crédible devrait proposer : un État social renforcé, garantissant santé, éducation, mobilité, logement ; des investissements massifs publics dans les transports propres, la rénovation thermique, l’énergie ; une fiscalité progressiste, où les plus pollueurs payent davantage ; une transformation du modèle agricole, vers des cultures moins dépendantes des pesticides et de l’eau.
L’écosocialisme n’est pas une utopie : c’est une politique réaliste si l’on prend au sérieux le réchauffement climatique, la biodiversité et les fractures sociales.
L’extrême droite prospère sur l’impuissance ressentie. Une alternative doit donc redonner la maîtrise : budgets participatifs ; assemblées citoyennes ; coopératives énergétiques locales ; démocratie au travail.
C’est la leçon du philosophe Pierre Rosanvallon, pour qui la démocratie ne survit que si elle implique réellement les citoyens.
La gauche ne renaîtra pas sans renouer avec le monde du travail : ouvriers, infirmières, enseignants, agriculteurs, employés de la logistique, aides-soignants…
Ces métiers essentiels doivent être placés au cœur du projet politique, non dans les notes de bas de page des programmes.
L’écologie ne doit pas dire : «il faut consommer moins» mais «il faut produire autrement, financer mieux, protéger plus».
Un nouveau récit pour un nouveau siècle
L’écosocialisme a un avantage stratégique : il propose un récit mobilisateur. Ce récit pourrait tenir en trois phrases : 1- protéger les gens : salaires dignes, droits sociaux solides, accès universel aux services publics ; 2- protéger la vie : air respirable, eau saine, climat vivable, villes verdies ; 3- protéger la démocratie : participation citoyenne réelle, égalité des droits, lutte contre les oligarchies économiques.
Comme le rappelait Cornelius Castoriadis, une société existe tant qu’elle peut «s’instituer elle-même». La gauche a perdu cette capacité. L’écosocialisme peut la lui rendre.
La montée de la droite radicale n’est pas un accident historique. Elle est le produit d’un double abandon : social et politique. En laissant se déliter les protections sociales, les services publics et la confiance démocratique, nos sociétés ont créé le terreau idéal pour les forces de colère.
L’écologie, prise isolément, est trop étroite pour être une réponse. La gauche, sans l’écologie, est trop nostalgique pour faire face au siècle qui vient. Seule une refondation écosociale peut offrir une alternative crédible : populaire, protectrice, démocratique et consciente de la finitude du monde.
La question n’est donc plus :«La droite monte, que faire ? » Mais :«Qui, dans nos sociétés, aura le courage d’articuler justice sociale et survie écologique pour proposer un avenir commun ?»
* Universitaire.
Bibliographie francophone :
- Bruno Amable, L’illusion du bloc bourgeois, Paris, Raisons d’agir, 2021.
- Castoriadis, Cornelius, La montée de l’insignifiance, Paris, Seuil, 1996.
- Dubuisson-Quellier, Sophie, La consommation engagée, Paris, Seuil, 2020.
- Eribon, Didier, Retour à Reims, Paris, Fayard, 2009.
- Fourquet, Jérôme, L’archipel français, Seuil, 2019.
- Fraser, Nancy, Le vieil ordre meurt et le nouveau tarde à naître, Paris, Lux, 2020 (trad. fr.).
- Giraud, Gaël, Transition écologique, Paris, LLL, 2014.
- Guilluy, Christophe, La France périphérique, Paris, Flammarion, 2014.
- Magnette, Paul, Écosocialisme, Paris, La Découverte, 2020.
- Piketty, Thomas, Capital et idéologie, Paris, Seuil, 2019.
- Rosanvallon, Pierre, Le siècle du populisme, Paris, Seuil, 2020.
- Żuk, Piotr, « Écologie pour les riches ? », Revue Capitalisme, Nature, Socialisme (trad. fr.), 2024.
L’article Comment reconstruire une alternative écosociale ? est apparu en premier sur Kapitalis.