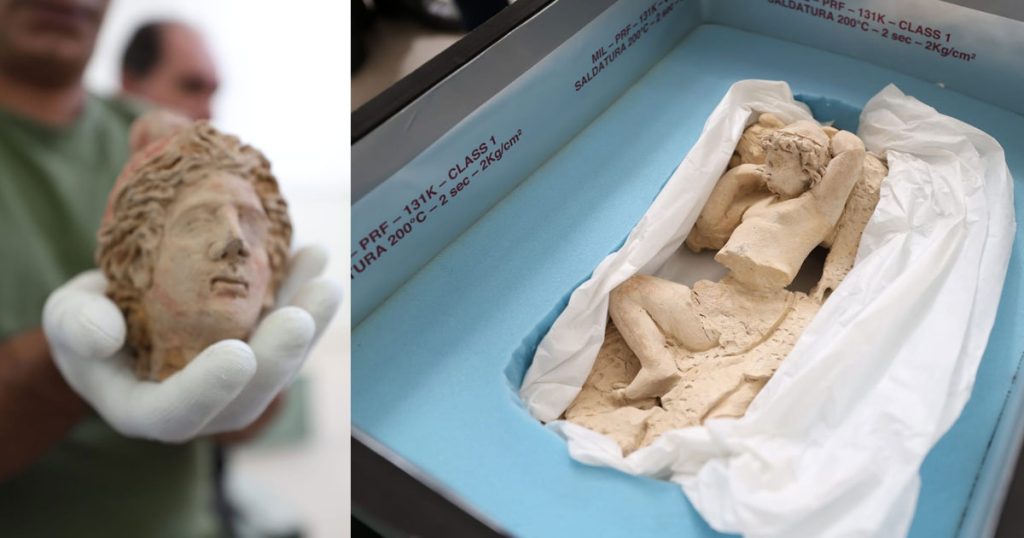Dans son livre ‘‘Écrits pour la liberté et le progrès’’, publié par les éditions Nirvana en 2025, Hichem Skik rassemble ses articles publiés en français dans le journal Attarik Al Jadid entre 2001 et 2014, date de la disparition de ce journal d’opposition, porte-parole du Parti communiste tunisien (PCT), et de ses différentes évolutions et ouvertures (Mouvement Ettajdid, Parti Al Massar).
Mehdi Jendoubi *
De fait c’est le tome 2 d’un livre publié en 2021 par le même auteur et chez la même maison d’édition sous le titre ‘‘Kitaabaat ala attarik’’ (كتابات على الطريق), qui rassemble l’essentiel des articles d’opinion publiés en arabe dans le même journal, entre 1981, année de sa création, et 2014.
Avec ces deux ouvrages, Hichem Skik nous offre ses écrits journalistiques complets, soit 80 articles en arabe et 50 en français. Si cette pratique est bien ancrée en littérature, dans le journalisme, cette tradition est loin d’être assise en Tunisie.
Dans ses mémoires intitulées ‘‘Al-massira wal-massar’’ (le parcours et voie), publiées en 2022 en arabe aux éditions Dissonances, Ahmed Nejib Chebbi rapporte qu’à son arrivée à Paris en 1964, alors jeune étudiant, il a entendu parler d’un club d’étudiants communistes animé par un certain Hichem Skik. Ce témoignage m’est revenu à l’esprit en écoutant ce dernier, en 2024, lors d’une séance de lancement d’un des livres publiés dans la collection Mountada Ettajdid aux éditions Nirvana, dirigée par lui-même. Entre les deux dates, soixante années se sont écoulées, que d’eau a coulé sous les ponts ! Mais le militant politique est toujours fidèle au poste, celui d’un implacable agitateur d’idées.
Une tradition de prise de parole publique
Hichem Skik perpétue une tradition bien connue chez les élites tunisiennes depuis le début du vingtième siècle, où le journalisme d’opinion est investi par les militants de toutes obédiences, et transformé en terrain de combat et en arme de lutte.
La liste serait longue à établir depuis les journaux Ezzohra (1890-1959), Le Tunisien (1907-1912), L’Action tunisienne (1932-1988), dans sa phase militante avant l’indépendance, Er-Raï (1978 -1987), El Mawqef (1984-2011), et bien d’autres titres.
Nous avons plus que jamais besoin de rappeler cette soif de prise de parole publique qui a toujours animé nos élites, et au-delà les expériences personnelles de personnalités très différentes et même souvent opposées, dans des contextes historiques variés.
Il faut saisir le message fondamental, transmis comme une flamme éclairante, de génération en génération. Ceux qui détiennent le pouvoir, et l’imposent parfois par la force, ne peuvent pas avoir le monopole de la parole publique. Les idées ne peuvent pas être mises en prison, même si les personnes qui les portent peuvent être, elles, aux arrêts.
Si cela était valable avec des journaux papier qu’on pouvait facilement suspendre, que dire aujourd’hui avec les multiples outils de communication qu’offre le 21e siècle. Les idées ne peuvent être combattues que par des idées, une évidence certes, mais elle mériterait d’être rappelée aux oublieux.
D’une génération à une autre
Le militant nationaliste Tahar Sfar, dans son ‘‘Journal d’un exilé. Zarzis 1935’’, publié aux éditions Bouslama en 1960, a bien saisi ce fil d’Ariane entre des générations qui parfois s’ignorent ou s’opposent et se critiquent les unes les autres, mais contribuent toutes à une œuvre historique commune qui les dépasse : «Bach Hamba, Thaâlbi, M’hamed Ali, Habib Bourguiba et tous ceux de leurs groupes, ne nous apparaissent-ils pas dans cette échelle ascensionnelle, comme autant de points de repères qui en marquent les sinuosités et en décèlent le progrès constant.(…) Et ainsi dans le chemin de la vie, semé d’obstacles et de fossés, où les culbutes sont inévitables et nécessaires, où les retours en arrière sont parfois utiles, et les haltes fécondes, toutes les générations doivent tendre la main en un rang ininterrompu et compact ; et c’est cela qui donne la foi, le courage et la voie d’œuvrer. Sentir qu’on est soutenu et épaulé par les générations qui ont précédé, que les morts sont présents et vivent dans notre activité, qu’ils agissent avec nous au travers de nous, (…) c’est cela et rien que cela qui fait grand le travail humain, qui console de l’effort et de la peine, qui fait supporter le sacrifice et la privation et qui, en un mot, donne tout son prix et son plein sens à l’évolution, qui partout s’accomplit et nulle part ne s’achève » (pages 18-20) .
C’est aussi de ce message transgénérationnel que Hichem Skik est acteur et témoin, à travers ses écrits journalistiques, mais aussi à travers la collection qu’il dirige ‘‘Montada Ettajdid’’ riche de 11 titres, qui vise à faire connaître le «patrimoine de la pensée de la gauche tunisienne et internationale et de le diffuser dans la société et en particulier auprès des jeunes». Nous pouvons ne pas partager ses priorités, mais comment ne pas être saisi par sa forte conviction, par sa constance et par l’intelligence investie dans cette œuvre de vie !
La main tendue de Bourguiba en 1981
Il faut être disciple d’Elyssa, pour voir se dessiner un État dans une peau de bœuf selon la légende populaire. L’art de voir grand, quand tout semble petit, étroit et désespérant. L’œuvre journalistique de Hichem Skik, comme celle de ses compagnons de lutte, bien au-delà de son propre parti, est pétrie d’histoire et de rapports de forces, arrachée mot par mot et phrase par phrase à la vigilance d’une censure que les moins de trente ans ne peuvent pas connaître, eux qui ont entendu des journalistes traiter le président de la république après la révolution de «Tartour» («Tartempion»), sans être inquiétés. Avant 2011 des carrières et des vies ont été brisées pour moins que ça !
Il faut remonter aux années charnières de la fin de années 1970 et le début des années 1980, pour trouver les clés d’une nouvelle grammaire politique, dans laquelle s’inscrivent les ‘‘Écrits pour la liberté et le progrès’’, de Hichem Skik.
Le pouvoir personnel de Bourguiba, servi par un charisme indiscutable, par son rôle dominant dans la lutte nationale et par une vision réformiste de l’État et de la société, concrétisée dès les premières années de l’indépendance, encaisse échecs et défis : l’échec d’une politique économique résumée abusivement par le terme collectivisation, le fort courant «indépendantiste» au sein de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), la centrale syndicale, qui débouchera sur la crise du «Jeudi noir» du 26 janvier 1978, qui voit s’effondrer la politique de «dialogue social» conçue par le premier ministre Hédi Nouira, l’attaque de Gafsa en 1980 menée par de jeunes tunisiens mobilisés et armés par la Libye et l’Algérie, ci-devant sœurs et voisines, une jeunesse de plus en plus en rupture avec le pouvoir et dont l’élite politisée est séduite par les idées de l’«extrême gauche» et de l’«islamisme politique», et une forte contestation estudiantine, et la maladie du président.
Affaibli, Bourguiba tend la main aux opposants et ouvre une nouvelle période politico-médiatique, qui fera l’objet de plusieurs études universitaires. Abdelkrim Hizaoui a étudié en profondeur le volet médiatique dans sa thèse intitulée ‘‘Le pluralisme de la presse en Tunisie, 1982’’). Larbi Chouikha a qualifié cette période d’«embellie» causée par la faiblesse du régime soucieux de renouveler sa légitimité, qu’il a analysé brillamment dans son ouvrage récent ‘‘Médias tunisiens. Le long chemin de l’émancipation (1956-2023)’’, publié par Nirvana éditions en 2024.
La modération comme arme de lutte
Les leaders du mouvement démocratique tunisien (Ahmed Mestiri, Ahmed Nejib Chebbi, Mohamed Harmel et d’autres), qui acceptent la main tendue de Bourguiba, jouent gros. Comment ne pas «perdre son âme» et une crédibilité chèrement acquise, parfois au prix de l’exil et de la prison, en faisant des compromis que d’autres considèrent comme une «compromission», de fait.
L’«opposition de décor» est une accusation à laquelle les plus vaillants opposants doivent alors faire face, et cela est d’autant plus dur à assumer que la confusion est facile à faire entre hommes politiques visionnaires qui feront de la modération et du compromis, même en cas de flagrant déséquilibre des forces, un choix politique réaliste et éthique – la politique étant l’art du possible – et qui n’hésiteront pas à accepter, conjoncturellement, d’assumer des responsabilités quand ils le jugent utile; et une armada d’ambitieux «fatigués de militantisme», qui n’hésitent pas à marchander un poste au «prix du marcher». Faire la part des choses, dans ce cas, n’est pas aisé.
Hichem Skik s’inscrit dans la tradition du PCT, qui a forgé le concept de «soutien critique» pour résumer sa position vis-à-vis de la politique conçue par le leader syndicaliste Ahmed Ben Salah, appelé par Bourguiba, dès le début des années soixante, à jouer un rôle très important au sommet de l’État et du Parti destourien au pouvoir.
Sans reprendre cette expression de manière explicite, elle est de fait mise en pratique entre les années 1980/2010, aussi bien sous Bourguiba, que sous Ben Ali. La «modération» est subtilement détournée en arme de combat. L’espace étroit et incertain permis par le pouvoir, qui fonctionne selon la logique incertaine des sables mouvants, sera donc le terrain de jeu imposé de l’action politique qui a généré les écrits journalistiques de Hichem Skik, qui est en charge au sein du bureau politique de son parti, de l’animation du journal Attariq Al Jadid, autorisé à paraître avec la levée d’interdiction du PCT en 1981, soit deux décennies après son interdiction en 1963.
«Mettre en mots la politique de son parti», s’exprimer à titre personnel quand l’actualité le permettait, motiver des collaborateurs non partisans à publier dans le journal du parti, relire et faire rectifier le tir des critiques de ses collaborateurs, faire vivre un journal avec très peu de moyens financiers (y compris en tenant compte des subsides que l’État pouvait fournir à quelques journaux) et surtout éviter de tomber sous le coup d’une interdiction à paraître (car continuer à exister est une performance en soi), ont constitué pour de longues années une des multiples facettes de la vie politique de Hichem Skik.
Résister par les mots
Au fil des textes de ce corpus des 130 ‘‘Écrits pour la liberté et le progrès’’, réédités pour la partie en arabe en 2021 et pour la partie en français en 2025, une pensée politique, née sous la pression de l’action se dessine, qui fera l’objet les prochaines années de longues études et recherches pour tous ceux qui s’intéresseront à l’histoire de la pensée politique en action, en Tunisie.
Bien servie par les subtilités stylistiques d’un spécialiste de littérature, doublé d’un chercheur en linguistique et par un militant qui n’a jamais rompu avec son parti depuis sa première adhésion en 1963 «en réaction à l’interdiction du parti», comme cela a été le choix de bien d’autres intellectuels, même s’il reconnaît être passé par «une longue éclipse, motivée par mon désaccord avec la ligne du parti, particulièrement timide avec le régime dans les années 1990», comme il l’écrit dans l’introduction de son livre.
Les thèmes et les analyses qui y sont abordés sont certes importants, mais plus encore c’est cet art d’arracher par la pensée, le droit d’exister politiquement, quand tout ou presque, joue contre vous et que toute personne «sensée» est tentée de s’installer confortablement dans un fauteuil face à la télévision. Résister par des mots peut déstabiliser ton adversaire. Belle leçon que nous donne Hichem Skik.
* Universitaire.
L’article Hichem Skik ou la modération comme arme de lutte est apparu en premier sur Kapitalis.