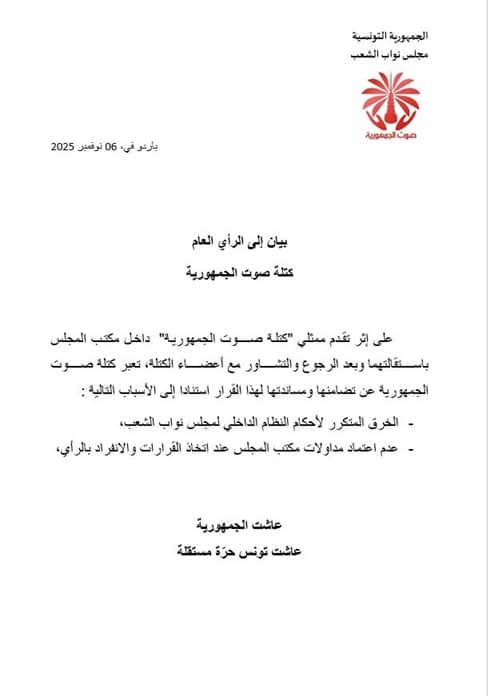Gaza : scepticisme face à la force internationale approuvée par l’ONU
La résolution du Conseil de sécurité de l’ONU soutenant le plan américain pour Gaza, incluant un cessez-le-feu permanent et le déploiement d’une force internationale de stabilisation, suscite à Gaza un accueil largement sceptique. Sur le terrain, de nombreux Palestiniens perçoivent cette force non pas comme un mécanisme de protection, mais comme un dispositif sécuritaire imposé sans leur consentement.
Une population méfiante face au mandat annoncé
Selon les témoignages recueillis à Gaza City et rapportés par Al Jazeera, l’idée d’une force internationale est associée à la crainte d’un nouveau système de contrôle. Le mandat prévu — comprenant des fonctions de police, de sécurité frontalière et de démilitarisation — nourrit la perception d’une présence intrusive davantage centrée sur l’ordre public que sur la reconstruction ou l’aide humanitaire.
Dans un contexte où l’hiver aggrave la situation des déplacés, les autorités locales rappellent que 300 000 tentes supplémentaires sont nécessaires pour faire face à l’urgence. Beaucoup s’interrogent sur la capacité réelle de cette force à empêcher de nouvelles frappes israéliennes ou à améliorer les conditions humanitaires.
Hamas rejette, l’Autorité palestinienne approuve
Les réactions politiques sont contrastées.
Hamas, au pouvoir à Gaza, a rejeté la résolution, qu’il juge insuffisante et biaisée. Le mouvement estime que confier à une force internationale la mission de désarmer les groupes armés revient à « favoriser l’occupation » et à retirer toute neutralité au dispositif.
À l’inverse, l’Autorité palestinienne, basée à Ramallah, a salué le texte. Dans un communiqué relayé par l’agence Wafa, elle affirme que la résolution pose les bases d’un cessez-le-feu durable, garantit l’accès de l’aide humanitaire et réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Le gouvernement se dit prêt à coopérer avec l’ONU et Washington pour la mise en œuvre du plan.
Une force internationale non onusienne
Selon Daniel Forti, analyste à l’International Crisis Group, la force approuvée par le Conseil de sécurité ne sera pas une mission de Casques bleus. Elle ne sera pas dirigée par l’ONU, mais par une coalition volontaire bénéficiant de la légitimité du Conseil. Le financement, le déploiement des troupes et les règles d’intervention dépendront des États contributeurs, et non des procédures onusiennes habituelles.
Des ONG actives à Gaza soulignent toutefois qu’une telle mission devrait disposer d’un mandat clair lui permettant de maintenir l’ordre dans un territoire profondément dévasté.
Les critiques de Pékin et Moscou
Plusieurs membres du Conseil ont justifié leur vote en faveur de la résolution.
- Le Royaume-Uni a évoqué la nécessité d’ouvrir tous les points de passage et d’accélérer l’aide.
- La France a mis en avant les efforts de paix et la priorité humanitaire.
- La Corée du Sud a salué le retour de l’aide et la structure de gouvernance prévue.
- La Slovénie a souligné que le texte représente la meilleure chance d’avancer vers une paix durable.
- Le Danemark a insisté sur la réunification future de Gaza et de la Cisjordanie sous une Autorité palestinienne réformée.
- La Chine a soutenu l’objectif d’un cessez-le-feu permanent mais a exprimé des réserves sur le mécanisme de la force internationale, appelant à garantir son impartialité et à éviter toute mesure susceptible d’alimenter les tensions. Pékin a insisté sur la nécessité de protéger les civils et de respecter le droit international.
- La Russie, de son côté, a critiqué le plan américain, estimant qu’il ne répond pas suffisamment aux besoins humanitaires urgents et risque de légitimer des arrangements sécuritaires imposés. Moscou a dénoncé un texte qu’elle juge déséquilibré mais n’a pas bloqué son adoption, tout en appelant à un rôle international plus neutre et réellement multilatéral.
Selon les autorités sanitaires de Gaza, 69 483 Palestiniens ont été tués et 170 706 blessés depuis octobre 2023. La situation humanitaire reste extrêmement critique, avec des infrastructures largement détruites et des besoins croissants.
Lire aussi:
Gaza : Des milliers en route, des plaies à jamais ouvertes !
L’article Gaza : scepticisme face à la force internationale approuvée par l’ONU est apparu en premier sur webdo.