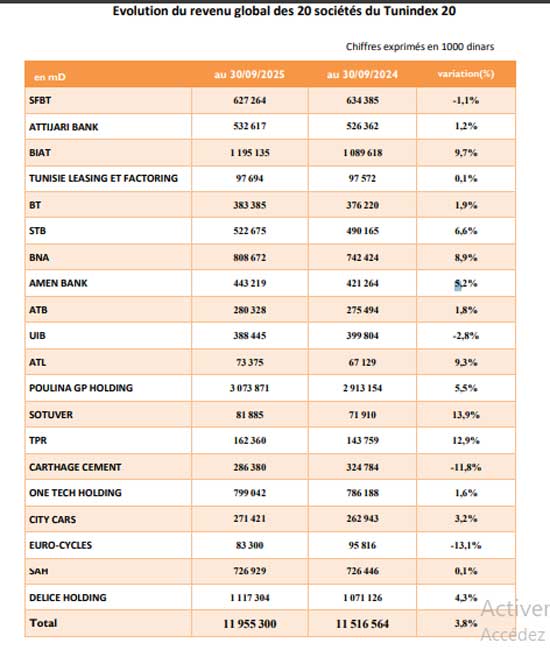ECLAIRAGE – Tunisie : Déficit, austérité et justice sociale … pour quoi et pour qui ?
Le débat sur le déficit budgétaire en Tunisie ressurgit à chaque loi de finances, souvent réduit à une opposition simpliste entre la rigueur et la dépense. Pourtant, la véritable question n’est pas de savoir si le déficit est bon ou mauvais en soi, mais bien à quoi il sert et à qui il profite. C’est cette question fondamentale, éclipsée par le dogme néolibéral, qui détermine la trajectoire économique et sociale du pays.
Le faux dilemme du déficit : entre l’offre et la demande
Le discours dominant, importé des orthodoxies néolibérales des années 1980, oppose mécaniquement la politique de l’offre — favorable à la compétitivité et à la rentabilité des entreprises — à celle de la demande, jugée inflationniste et inefficace. Ce raisonnement, appliqué aujourd’hui à la Tunisie, conduit à considérer le déficit budgétaire comme une faute de gestion, et non comme un outil économique stratégique.
Or, l’histoire récente rappelle une vérité dérangeante : les plus grands défenseurs du néolibéralisme — Ronald Reagan et Margaret Thatcher — ont pratiqué un keynésianisme sélectif, dissimulé derrière le discours du marché libre. Sous leurs gouvernements, les déficits publics ont explosé non pas pour soutenir les ménages ou les services publics, mais pour financer des dépenses militaires, des subventions massives aux entreprises et des baisses d’impôts pour les plus aisés.
Ce paradoxe invite à poser la question centrale : le problème n’est pas le déficit, mais sa destination. En Tunisie, où le déficit dépasse encore les 5 % du PIB, le même dilemme se pose : les ajustements budgétaires servent-ils à corriger des déséquilibres structurels ou à transférer les coûts de la crise vers les classes moyennes et populaires ?
Les plus grands défenseurs du néolibéralisme — Ronald Reagan et Margaret Thatcher — ont pratiqué un keynésianisme sélectif, dissimulé derrière le discours du marché libre. Sous leurs gouvernements, les déficits publics ont explosé non pas pour soutenir les ménages ou les services publics, mais pour financer des dépenses militaires, des subventions massives aux entreprises et des baisses d’impôts pour les plus aisés.
L’austérité contre la productivité sociale
Les politiques d’austérité imposées au nom de la stabilité budgétaire et de la maîtrise de la dette ont, partout dans le monde, eu des effets économiques dévastateurs à long terme. En réduisant les dépenses d’éducation, de santé publique, d’infrastructures et de sécurité sociale, les États hypothèquent les investissements les plus productifs pour l’avenir.
La Tunisie n’échappe pas à cette logique. Depuis plusieurs années, les dépenses d’investissement public stagnent, tandis que les dépenses de fonctionnement et le service de la dette absorbent plus de 80 % du budget de l’État. Les infrastructures se dégradent, les hôpitaux manquent de moyens, les écoles rurales se vident, et la productivité globale de l’économie s’en trouve affaiblie.
La Tunisie n’échappe pas à cette logique. Depuis plusieurs années, les dépenses d’investissement public stagnent, tandis que les dépenses de fonctionnement et le service de la dette absorbent plus de 80 % du budget de l’État…
C’est un cercle vicieux : la réduction des dépenses sociales affaiblit la demande intérieure, freine la croissance, accentue les inégalités et, paradoxalement, alourdit la dette publique à moyen terme. Ce que les économistes du développement enseignent depuis des décennies reste valable : les dépenses sociales sont un investissement, pas une charge.
Un keynésianisme socialement orienté pour la Tunisie
Face à l’échec des politiques de rigueur et à la montée du chômage, la Tunisie doit repenser le rôle de son déficit budgétaire. L’objectif ne devrait pas être de réduire le déficit à tout prix, mais de le rendre productif socialement et économiquement.
Cela signifie orienter les dépenses publiques vers des secteurs à effet multiplicateur élevé : l’éducation, la santé, les infrastructures locales et la transition énergétique. Ce sont ces investissements qui stimulent la productivité, soutiennent la consommation et renforcent la cohésion sociale.
Face à l’échec des politiques de rigueur et à la montée du chômage, la Tunisie doit repenser le rôle de son déficit budgétaire. L’objectif ne devrait pas être de réduire le déficit à tout prix, mais de le rendre productif socialement et économiquement.
Un tel choix implique aussi une redéfinition du contrat social tunisien. Les classes moyennes, lourdement taxées, ne peuvent continuer à supporter le poids de la consolidation budgétaire tandis que les rentes, les niches fiscales et l’économie informelle prospèrent sans réelle contribution au bien commun. Le déficit, s’il doit exister, doit servir à corriger ces déséquilibres, non à les perpétuer.
Le danger d’une société duale
Les leçons des années Reagan-Thatcher sont claires : le néo-keynésianisme néolibéral, fondé sur la réduction des droits sociaux et l’extension du marché, produit une société duale — un monde où coexistent une minorité intégrée et une majorité marginalisée. La Tunisie en porte déjà les stigmates : chômage massif des jeunes diplômés, informalité endémique, exode des compétences, et perte de confiance dans les institutions publiques.
Cette dualisation nourrit un terreau de désespoir et de désengagement politique, où se multiplient les discours populistes et les tentations autoritaires. Une telle dynamique n’est pas seulement économique : elle menace la cohésion nationale.
Cette dualisation nourrit un terreau de désespoir et de désengagement politique, où se multiplient les discours populistes et les tentations autoritaires. Une telle dynamique n’est pas seulement économique : elle menace la cohésion nationale.
Pour un déficit au service de la justice sociale
La question du déficit en Tunisie ne doit plus être posée en termes de morale comptable, mais de choix de société. Faut-il maintenir un État qui subventionne les rentes et sacrifie les services publics, ou un État qui investit dans le capital humain, l’innovation et la solidarité ?
Un déficit orienté vers la justice sociale n’est pas une menace pour la stabilité, mais une condition de sa pérennité. À l’heure où le pays prépare son budget 2026, le véritable courage politique serait de faire du déficit un instrument de développement inclusif, non un fardeau à fuir.
Car au fond, la question reste la même : un déficit, oui — mais pour quoi et pour qui ?
La question du déficit en Tunisie ne doit plus être posée en termes de morale comptable, mais de choix de société. Faut-il maintenir un État qui subventionne les rentes et sacrifie les services publics, ou un État qui investit dans le capital humain, l’innovation et la solidarité ?
===============================
* Dr. Tahar EL ALMI,
Economiste-Economètre.
Ancien Enseignant-Chercheur à l’ISG-TUNIS,
Psd-Fondateur de l’Institut Africain
D’Economie Financière (IAEF-ONG)
L’article ECLAIRAGE – Tunisie : Déficit, austérité et justice sociale … pour quoi et pour qui ? est apparu en premier sur Leconomiste Maghrebin.