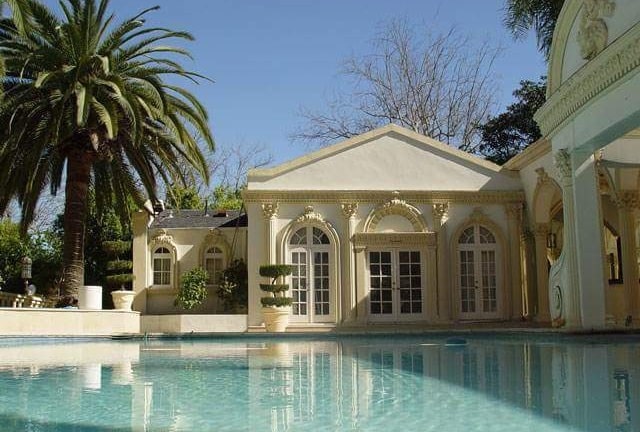Zied Bakir | «La naturalisation, c’est une question de liberté plus que d’identité»
Candidat au Prix de la Littérature arabe 2025, Zied Bakir revient avec son nouveau roman ‘‘La Naturalisation’’ (Grasset, 2025), poursuivant avec humour et gravité sa réflexion sur l’exil, la mémoire et l’appartenance. L’auteur tunisien, déjà remarqué pour ‘‘On n’est jamais mieux que chez les autres’’ et ‘‘L’Amour des choses invisibles’’, explore ici les zones d’ombre de l’identité postcoloniale à travers Elyas, un narrateur tiraillé entre deux mondes, deux langues, deux fidélités. Sous une plume ironique et élégante, Bakir interroge les faux-semblants de l’intégration et la quête inépuisable d’une liberté intérieure.
Entretien réalisé par Djamal Guettala
Kapitalis : ‘‘La Naturalisation’’ s’ouvre sur une phrase à double tranchant : intime et politique à la fois. Pourquoi avoir choisi de relier la circoncision du narrateur à la fin de Bourguiba ?
Zied Bakir: Ma petite enfance a été marquée par ces deux évènements douloureux, deux amputations que l’on ressent dans sa chair — du moins la circoncision. Quant à la fin du règne de Bourguiba, j’en subirai les conséquences plus tard, ayant vécu sous la «douce dictature» de Ben Ali. Il y a un début dans la vie, celui d’un enfant anonyme, et une fin, celle du grand Bourguiba. Dans les deux cas, se mêlent violence et fatalité. Je voulais ancrer le narrateur dans une réalité culturelle et politique, montrer d’où il vient. Et puis, cette concomitance produit un effet comique : elle donne le ton du livre.
Ce titre, ‘‘La Naturalisation’’, sonne administratif. Pourtant, votre roman parle d’exil, de filiation, de langue, d’appartenance. Qu’est-ce que cela signifie vraiment, pour vous, «être naturalisé» ?
Pas grand-chose, en réalité. Au moment d’écrire ce livre, j’ai moi-même demandé la naturalisation, pour des raisons pratiques — la liberté de circuler, l’assurance vie, etc. Dans le roman, c’est un prétexte narratif, une porte d’entrée vers un itinéraire initiatique.
On peut y voir une métaphore ironique : contrairement aux animaux qu’on naturalise à leur mort, les immigrés le sont de leur vivant. Les premiers gardent l’apparence du vivant, les seconds celle de quelque chose qui a peut-être disparu… Mais arrêtons là les comparaisons — cela n’engage que moi (rire).
Elyas vit entre deux mondes, deux langues, deux fidélités. Quelle part de vous se glisse dans ce miroir ?
Elyas est un indifférent, presque un fumiste, affranchi des fictions identitaires. Il incarne une philosophie du non-agir, inspirée de Lao Tseu : être en phase avec le cours des évènements. Ce n’est pas un exilé tragique mais un observateur ironique. Elyas est un double littéraire, un miroir déformant. Son «exil» est surtout une quête de soi.
Vous mêlez réel et imaginaire avec liberté. Pourquoi faire dialoguer Bourguiba et Victoria Ocampo, rencontre pourtant fictive ?
Parce qu’elle aurait pu avoir lieu ! Tous deux partageaient la francophilie et une ambition démesurée. Cette scène me permettait surtout de souligner un paradoxe : Ocampo, argentine, aimait Drieu La Rochelle, collaborationniste notoire, tandis que Bourguiba, militant pour l’indépendance tunisienne, demeurait fidèle à la France. Ce contraste en dit long, surtout pour un lecteur français.
Le roman traverse Paris et Tunis, les années 1920 et 1987. Qu’est-ce qui relie ces deux moments-clés de l’histoire tunisienne ?
Ils dessinent une boucle : Bourguiba passe de la Sorbonne à Carthage, du rêve d’indépendance à la chute. Mon narrateur, lui, fuit la grandeur pour éviter la chute. Ces deux temporalités mettent en lumière l’héritage franco-tunisien et interrogent le rapport entre histoire personnelle et histoire nationale.
Votre écriture allie ironie douce et regard tragique. Est-ce votre manière d’aborder la gravité sans pathos ?
Oui. Parler de choses graves avec légèreté — et inversement — est un style que j’explore. L’ironie est un remède contre l’absurde. Comme le dit un proverbe tunisien : «Kothr el hamm y dhahak» — «trop de chagrin fait rire». Et s’il fallait un slogan, ce serait celui des Beatles : «Take a sad song and make it better». Tout est là.
Vous décrivez la nuit du 7 novembre 1987 avec une précision quasi cinématographique. Pourquoi revenir sur cet instant ?
Parce que c’est un moment fondateur de notre histoire. Une délivrance qui s’est transformée en dictature plus bête et dévastatrice que celle du «despote éclairé» Bourguiba.
En 2011, la révolution tunisienne a suscité la même illusion d’aube. Aujourd’hui, le constat est amer : nos pays semblent condamnés à faire un pas en avant, deux en arrière. J’interroge cette fatalité.
La langue française est à la fois arme et refuge dans votre roman. Comment vivez-vous cette dualité ?
Une langue appartient à ceux qui la parlent et l’enrichissent. L’«autre» n’existe pas : Romain Gary, Cioran, Assia Djebar, Kateb Yacine, François Cheng… tous ont fait du français une langue sans frontières. Habiter une terre, c’est d’abord habiter une langue. Et écrire, c’est habiter le monde.
L’exil, chez vous, semble apaisé. Est-ce une blessure ou une condition nécessaire à la création ?
Je parle plutôt d’«anti-exil». Je ne viens pas chercher refuge, ni remplacer, ni profiter (quoique !). J’avance, tout simplement. La naturalisation n’est pas une fin, mais un moyen d’être plus libre — et la liberté, c’est la condition première de la création.
Elyas dit qu’il faut «guérir de l’amour de Paris». Vous partagez cette idée ?
Oui, avec ironie. C’est une variation sur un vers de Mahmoud Darwich : «Comment guérir de l’amour de la Tunisie ?» Mon personnage aime Paris d’un amour non réciproque. Tout amour est illusion, parfois piège — mais nécessaire. Paris aussi vaut le détour.
Vos trois romans semblent liés par une même veine : mémoire et filiation. Une continuité assumée ?
Peut-être. J’écris toujours à partir du vécu et de l’observation. J’ai parfois peur d’écrire le même livre sous des formes différentes — mais peut-être faut-il se répéter pour être entendu.
Enfin, si un jeune lecteur tunisien ou maghrébin devait lire ‘‘La Naturalisation’’, qu’aimeriez-vous qu’il y trouve ?
Une liberté, avant tout. La lecture, comme l’écriture, est un exercice de liberté. Et si certains y trouvent aussi une mémoire, une leçon, ou même un sourire, ce sera déjà beaucoup.
L’article Zied Bakir | «La naturalisation, c’est une question de liberté plus que d’identité» est apparu en premier sur Kapitalis.