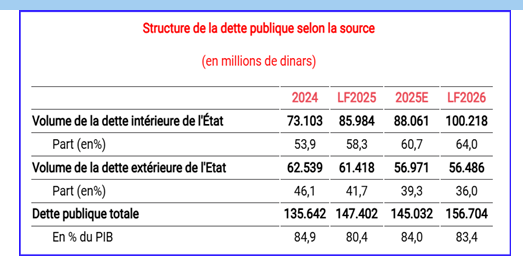ECLAIRAGE – Le cri d’un citoyen tunisien : symptôme d’une économie à bout de souffle
Il arrive qu’un simple témoignage vaille mieux qu’un rapport officiel. Ces derniers jours, la vidéo d’un citoyen tunisien exprimant sa détresse face à la flambée des prix et à la dégradation du quotidien a bouleversé les réseaux sociaux. L’émotion qu’elle a suscitée dépasse la dimension individuelle : elle révèle, dans sa sincérité brute, le visage d’une crise économique et sociale devenue systémique. Ce cri du cœur, loin d’être isolé, s’inscrit dans une réalité nationale marquée par l’érosion du pouvoir d’achat, la raréfaction des produits, la désillusion politique et la perte de confiance envers l’État.
Un choc du coût de la vie et une érosion du pouvoir d’achat
Lorsque ce citoyen affirme que « les prix ont flambé et la vie est devenue insupportable », il ne s’agit pas d’une hyperbole (1 fest). Le constat est étayé par la tendance inflationniste persistante que connaît la Tunisie depuis plus de deux décennies. Avec une inflation qui oscillait autour de 6,7 % en 2024, et une hausse particulièrement marquée des prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité, le pouvoir d’achat réel des ménages s’est considérablement contracté (1).
Les hausses successives des prix des légumes, des fruits et du poisson, évoquées dans le témoignage, traduisent les tensions structurelles dans les circuits de distribution et dans la chaîne de valeur agricole (2). Ces tensions sont alimentées par la dépendance aux importations, la hausse des coûts de production (carburant, intrants agricoles, alimentation animale) et le désengagement progressif de l’État des mécanismes de régulation des prix. Le résultat est clair : le panier du consommateur moyen s’est appauvri, et le marché s’est segmenté entre une minorité solvable et une majorité qui survit.
Les hausses successives des prix des légumes, des fruits et du poisson, évoquées dans le témoignage, traduisent les tensions structurelles dans les circuits de distribution et dans la chaîne de valeur agricole. Ces tensions sont alimentées par la dépendance aux importations, la hausse des coûts de production (carburant, intrants agricoles, alimentation animale) et le désengagement progressif de l’État des mécanismes de régulation des prix.
Une économie sans moteur productif
Le diagnostic formulé par le citoyen — « l’État a abandonné son rôle dans la production » — rejoint celui de nombreux économistes. Le modèle de développement tunisien, centré sur la consommation et l’endettement, s’est essoufflé. L’investissement productif privé stagne, l’investissement public recule, et les politiques industrielles et agricoles manquent de cohérence (3).
Le diagnostic formulé par le citoyen — « l’État a abandonné son rôle dans la production » — rejoint celui de nombreux économistes. Le modèle de développement tunisien, centré sur la consommation et l’endettement, s’est essoufflé. L’investissement productif privé stagne, l’investissement public recule, et les politiques industrielles et agricoles manquent de cohérence.
Le pays importe désormais une part croissante de ses besoins alimentaires, tandis que la productivité agricole décline sous l’effet combiné du manque d’eau, de la vétusté des équipements et du retrait progressif des soutiens publics. L’agriculture, autrefois pilier de la souveraineté économique, se trouve fragilisée. Dans ce contexte, les importations deviennent vitales mais pèsent lourdement sur des finances publiques sous tension, accentuant le déséquilibre de la balance commerciale et la pression sur les réserves en devises (4).
L’État, réduit à un rôle de gestion courante, peine à garantir l’approvisionnement du marché. La pénurie de certains produits essentiels n’est pas seulement le résultat d’une spéculation ponctuelle, mais d’une incapacité structurelle à planifier, produire et réguler. Cette impuissance économique nourrit le sentiment d’abandon et alimente la défiance sociale.
La crise de la gouvernance et la faillite de la planification
Le citoyen le dit sans détour : « Les responsables sont prisonniers d’un système sans vision ni stratégie ». Ce jugement traduit une crise de gouvernance profonde. Depuis plusieurs décennies, la Tunisie fonctionne sans véritable planification économique intégrée. Les politiques publiques se succèdent au rythme des urgences, sans coordination entre les ministères, sans priorités claires, et sans mobilisation du secteur privé productif.
Cette absence de stratégie a des effets visibles : une croissance molle (autour de 2 % en moyenne sur les cinq dernières années), un taux de chômage élevé (supérieur à 15 %, et dépassant 35 % chez les jeunes diplômés), et une désindustrialisation progressive. La politique budgétaire, contrainte par le service de la dette, se contente de mesures palliatives, tandis que la politique monétaire, focalisée sur la stabilité des prix, a peu d’impact sur l’investissement et la création d’emplois.
Dans ce contexte, la lutte contre la spéculation — souvent présentée comme un axe majeur — devient un argument politique plus qu’une politique économique. Le citoyen le souligne : « Si les spéculateurs existent, qu’on les montre ». Cette phrase dénonce l’usage rhétorique du terme pour masquer la faiblesse de l’appareil d’État. La spéculation n’est qu’un symptôme d’un marché désorganisé, d’une économie informelle florissante et d’une absence d’autorité régulatrice efficace.
Cette absence de stratégie a des effets visibles : une croissance molle (autour de 2 % en moyenne sur les cinq dernières années), un taux de chômage élevé (supérieur à 15 %, et dépassant 35 % chez les jeunes diplômés), et une désindustrialisation progressive. La politique budgétaire, contrainte par le service de la dette, se contente de mesures palliatives, tandis que la politique monétaire, focalisée sur la stabilité des prix, a peu d’impact sur l’investissement et la création d’emplois.
Le délitement social et la perte du contrat civique
Derrière les difficultés économiques, ce témoignage met en lumière une crise sociétale : celle de la confiance. « Quand quelqu’un réussit, on l’accuse d’avoir volé », déplore-t-il. Ce constat illustre une fracture morale : dans une économie stagnante, la réussite devient suspecte, et la solidarité s’effrite. Le tissu social tunisien, autrefois fondé sur une forte cohésion communautaire, se délite sous l’effet combiné de la pauvreté, de la méfiance et du repli sur soi.
Le citoyen, enseignant de son état, évoque aussi la faillite du système éducatif : « On ne forme plus des générations capables de penser ou de construire ». Là encore, le constat rejoint les analyses de terrain : un système éducatif déconnecté du marché du travail, figé dans des programmes obsolètes, et incapable de promouvoir la créativité ou l’esprit d’entreprise. Ce déclin éducatif alimente un cercle vicieux : chômage, fuite des compétences, démotivation, et perte de productivité nationale.
Entre populisme et impuissance : un État en perte de crédibilité
Ce témoignage, dans sa virulence, est aussi une critique implicite du populisme ambiant. Les slogans officiels — « lutte contre la corruption », « redressement national », « autosuffisance » — apparaissent creux lorsqu’ils ne s’accompagnent d’aucune amélioration concrète du quotidien. La gouvernance actuelle, concentrée entre les mains de l’exécutif, peine à convaincre d’une vision claire de sortie de crise.
L’État tunisien vit aujourd’hui dans une tension permanente entre le discours et la réalité : il promet la souveraineté alimentaire mais réduit les subventions agricoles ; il prône la justice sociale mais laisse l’inflation ronger les revenus fixes ; il annonce la relance mais gèle les recrutements publics. Cette incohérence mine la légitimité du pouvoir et alimente une colère sociale devenue chronique.
L’État tunisien vit aujourd’hui dans une tension permanente entre le discours et la réalité : il promet la souveraineté alimentaire mais réduit les subventions agricoles ; il prône la justice sociale mais laisse l’inflation ronger les revenus fixes ; il annonce la relance mais gèle les recrutements publics. Cette incohérence mine la légitimité du pouvoir et alimente une colère sociale devenue chronique.
Un cri qui résonne comme une alerte nationale
Ce citoyen, en exprimant son désarroi, ne fait pas que témoigner — il diagnostique. Son cri traduit ce que les institutions peinent à reconnaître : la Tunisie traverse une crise de modèle, pas seulement une crise de conjoncture. Une économie sans vision productive, un État sans planification, un peuple sans espoir — telle est la trilogie du malaise national.
Mais dans ce cri réside aussi une leçon : celle d’un peuple qui refuse de se taire. Derrière la colère, il y a encore une exigence de dignité, un appel à la rationalité économique et à la responsabilité politique. La Tunisie n’a pas besoin de nouveaux slogans, mais d’un nouveau contrat économique et social, fondé sur la production, la compétence et la justice.
Car comme le dit le citoyen : « Les marchés sont pleins, mais les poches sont vides ». Et tant que cette phrase demeurera vraie, aucune réforme ne sera crédible.
Mais dans ce cri réside aussi une leçon : celle d’un peuple qui refuse de se taire. Derrière la colère, il y a encore une exigence de dignité, un appel à la rationalité économique et à la responsabilité politique. La Tunisie n’a pas besoin de nouveaux slogans, mais d’un nouveau contrat économique et social, fondé sur la production, la compétence et la justice.
===============================
Références :
(1) : FEST : https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/14391.pdf
(2) : INS : https://www.ins.tn/publication/indice-des-prix-la-consommation-septembre-2025
(3) : ITCEQ: http://www.itceq.tn/files/tableaux-de-bord/conjoncture/2025/tbord-mars2025.pdf
(4) : BCT : https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Conjoncture_fr.pdf
===============================
* Dr. Tahar EL ALMI,
Economiste-Economètre.
Ancien Enseignant-Chercheur à l’ISG-TUNIS,
Psd-Fondateur de l’Institut Africain
D’Economie Financière (IAEF-ONG)
L’article ECLAIRAGE – Le cri d’un citoyen tunisien : symptôme d’une économie à bout de souffle est apparu en premier sur Leconomiste Maghrebin.