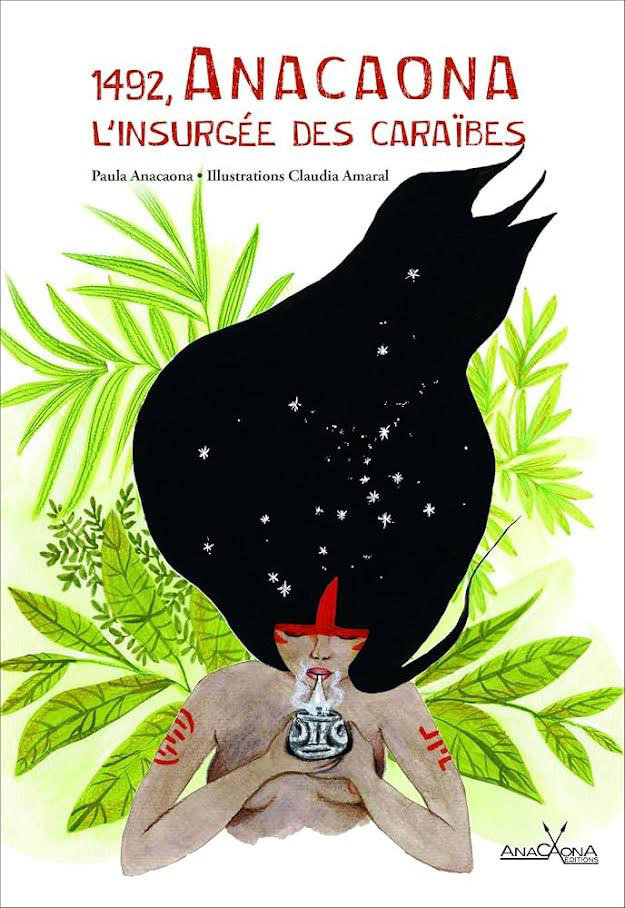Entre les déclarations et discours officiels qui affirment que l’économie tunisienne a connu en 2025 un «redressement économique tangible» et a entamé une phase de «croissance durable» et se félicitent même du succès, selon ces responsables, de la «stratégie du compter sur soi» mise en œuvre par le gouvernement sous l’impulsion et les directives du Président Kais Saïd pour sortir l’économie de l’impasse où elle trouve depuis des années d’un côté, et les difficultés de plus grandes que rencontrent au quotidien les ménages et les opérateurs économiques de l’autre côté, où se trouve la vérité ? La réponse d’un économiste universitaire et expert international pour éclairer ce débat*
Dr Sadok Zerelli
Lors de sa récente participation aux assemblées annuelles de la Banque Mondiale et du FMI à Washington, le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, a déclaré, devant les représentants de plusieurs banques et institutions financières internationales, que «la Tunisie traverse une phase de redressement économique tangible, illustrée par les résultats réalisés en 2025», qui illustre, selon lui, «la résilience de l’économie tunisienne» et «la capacité de la Tunisie à maintenir une croissance durable».
Le première remarque à faire est qu’en faisant de telles déclarations, M. Nouri est tout à fait dans son rôle de Gouverneur d’une banque centrale, dont la première mission est de rassurer les investisseurs et les bailleurs de fonds et rétablir la confiance dans les institutions et la politique économique et financière de son pays.
La deuxième remarque est que ces déclarations, qui, le moins qu’on puisse dire, sont «optimistes» pour ne pas dire «euphoriques», peuvent passer et être crues si elles sont faites à un média audiovisuel local à destination de l’opinion publique tunisienne, dont la culture économique et financière laisse malheureusement beaucoup à désirer, mais peuvent faire sourire des experts d’institutions internationales qui savent lire les chiffres et analyser les équilibres structurels d’une économie.
Qu’en est-il vraiment et dans quelle mesure les déclarations du gouverneur de notre banque centrale sont justifiées et crédibles ou peuvent être considérées comme telles par un auditoire d’experts internationaux chevronnés ?
Pour répondre objectivement à cette question, je vais reprendre un à un les arguments que le gouverneur de la BCT avance pour justifier ses déclarations et analyser leurs significations et portées réelles.
Parallèlement et en vue de faciliter la lecture des chiffres par un public non spécialisé, je vais indiquer quelques comparaisons internationales avec des pays dont la taille et la structure économique sont similaires à ceux de la Tunisie.
Croissance du PIB en 2025
C’est le premier argument sur lequel le gouverneur de la BCT fonde ses déclarations.
Il est vrai que la BM a révisé son taux de croissance de l’économie tunisienne, qui était estimé à 1,9%, pour le porter à 2,6% pour l’année 2025. Cette «embellie» relative de la croissance économique attendue pour l’exercice 2025 est due principalement à une bonne saison touristique et une bonne récolte agricole, ainsi qu’à une conjoncture internationale exceptionnellement favorable (baisse du prix du pétrole et baisse du dollar).
Il est vrai aussi que, comparé aux maigres 1,4% de croissance réalisés en 2024, un tel résultat représente une «performance» qui ne peut que réjouir tous les Tunisiens, moi inclus.
Mais ce que M. Nouri oublie ou feint d’oublier, mais que tous les experts internationaux qui l’écoutaient savent certainement, est que le FMI prévoit une croissance de 2,1 % en 2026 et pas plus que 1,4% de 2027 à 2030, soient des taux de croissance extrêmement faibles et légèrement plus élevés que le taux de croissance démographique (1,1%). Cela signifie, que même si l’inflation sera nulle, il ne faut pas s’attendre jusqu’à l’horizon de 2030 au moins à une amélioration significative du niveau de vie de la population, puisque l’accroissement de la production nationale suffira à peine à nourrir les nouvelles populations.
D’autre part, un taux de croissance économique nettement plus faible que le taux d’inflation qu’une économie génère (5% en glissement annuel au mois de septembre 2025, voir plus loin) signifie une dépréciation continue de la valeur de la monnaie nationale et donc une baisse de la compétitivité de nos entreprises, un plus grand déficit commercial, un plus grand endettement, etc.
Enfin comparé aux 3,6% selon la BM et 4,4% voire 4,6% selon d’autres sources, attendus pour le Maroc en 2025 par la BM ou aux 7,1% attendus selon le FMI pour le Rwanda durant la même année, le moins qu’on puisse dire est qu’avec 2,6% attendus par la Tunisie pour 2025, il n’y a vraiment pas lieu de pavoiser et de parler de «capacité de la Tunisie à maintenir une croissance durable», si on veut être pris au sérieux par une assistance formée d’experts internationaux
Maîtrise de l’inflation
Il y a quelque chose de pathétique à voir les responsables de la BCT se précipiter chaque début de mois pour s’attribuer les mérites d’une baisse même infime de l’indice de l’Indice des prix à la consommation (IPC) publié par l’INS. Il en a été ainsi lorsqu’il est passé en glissement annuel de 5,3% en juillet, à 5,1% en août et à 5% en septembre, soit une baisse de quelques déciles de point à chaque mois.
Ce faisant, les responsables de la BCT passent sous silence l’inflation galopante que leur politique monétaire trop restrictive et catastrophique pour les investissements et la croissance économique (en raison d’un taux directeur très élevé et injustifié de 8% pendant plus de deux ans et de 7,5% actuellement) a engendré : +8,3% en 2022; +9,3% en 2023; +7,0% en 2024 et +6,1% attendus pour 2025, soit une inflation cumulée et donc une perte du pouvoir d ‘achat des ménages de 30,7% en trois ans seulement !
Par ailleurs, le gouverneur de la BCT, économiste de formation et même «professeur des universités», n’ignore pas que l’IPC constitue un indice de l’inflation partielle et non pas globale puisqu’il qui ne prend en compte que l’évolution des prix des biens et services consommés par les ménages, à l’exclusion des biens et services utilisés par les entreprises et les producteurs (par exemple, l’augmentation des prix des aliments pour bétail n’est pas prise en compte dans le calcul de l’IPC alors que c’est elle qui explique que le prix des viandes rouges avoisine les 60 dinars et celui des viandes blanches les 20 dinars, ou celle des semences et fertilisants utilisés par les agriculteurs qui explique que le prix d’un kilo de pomme de terre avoisine les 3 dinars).
D’autre part, s’agissant d’un indice statistique composé du type «Laspeyres», les prix sont pondérés par des poids qui sont loin de refléter la structure réelle des dépenses des ménages (par exemple, le poids des dépenses d’alimentation n’est que de 28%, de sorte que même si les prix des produits alimentaires frais augmentent considérablement (22,3% au mois de septembre dernier), leur impact sur la valeur finale de l’IPC se trouve minimisé (voir mon dernier article dans Kapitalis : «Baisse de l’inflation : un mensonge d’Etat»)
Enfin, M. Nouri n’ignore pas que l’INS ne dispose pas d’un appareil qui lui permet de mesurer avec une précision scientifique et au centième ou millième près l’inflation. En fait, il procède par estimation statistique sur la base de milliers d’informations recueillies mensuellement (33 000 selon un responsable de l’INS) collectées par des milliers d’enquêteurs dans des centaines de points de vente, marchés, épiceries, etc. Or, toute estimation basée sur des techniques statistiques comporte forcément une marge d’erreur qui est la somme de deux sources d’erreur possibles : les erreurs de relevés sur le terrain et les erreurs de saisies et traitement des données recueillies.
Bref, pour un statisticien ou un économiste qui se respecte, la baisse d’un pour mille observée entre août et septembre ou de deux pour mille observée entre juillet et août n’est statistiquement pas significative d’une baisse réelle et rentre dans la marge d’erreur de ce genre d’estimation par échantillonnage. En tirer des leçons pour affirmer qu’elle traduit une baisse réelle de l’inflation et l’attribuer même à «l’efficacité de la politique monétaire menée par la BCT», comme le fait le gouverneur de notre BCT, n’est pas sérieux et n’est pas digne d’un homme de sciences comme l’est M. Nouri.
En termes de comparaisons internationales, le triomphalisme en matière de lutte contre l’inflation affiché par le gouverneur de la BCT sur la base des 5% d’inflation enregistrés au mois de septembre 2025 est d’autant plus déplacé que le Maroc a enregistré 0,4% et la Jordanie 2,6% pour le même mois de septembre 2025, sans parler de l’Algérie qui, avec -0,28% enregistrés durant le même mois, a pu éradiquer totalement l’inflation et entamer même un processus de déflation.
Remboursement de la dette extérieure
Il y a quelques semaines, l’agence Tap, pourtant une agence gouvernementale qui est censée ne publier que les informations officielles et de sources fiables, a rapporté que la Tunisie a remboursé 125% de l’encours de sa dette extérieure pour l’année 2025, y compris vis-à-vis du FMI. Vérification faite auprès du FMI, notamment par Sadok Rouai, ex-représentant de la Tunisie au FMI en retraite et ex-cadre de la BCT, il s’avère qu’il s’agit d’une «fake news» puisque la Tunisie doit encore rembourser 309 millions de dinars au FMI, comme le prouve une copie d’un document interne du FMI.
Plus encore, le remboursement des échéances de la dette extérieure de 2025, qui est certes à saluer et ne peut que nous réjouir tous, s’est fait malheureusement au détriment de l’importation d’un certain nombre de produits de base, tels que les médicaments, et au prix d’une baisse inquiétante des réserves en devises détenues par la BCT : le nombre de jours d’importation, qui était de 130 il y a quelques mois a atteint 105 actuellement et devrait même baisser jusqu’à 91 jours d’ici la fin de l’année 2025, selon une étude récente de l’IACE.
En réalité, et selon le ministère des Finances, le volume total de la dette de l’État à la fin de l’année 2026 n’a pas baissé et devrait même augmenter à 156 704 MDT, contre 145 032 MDT en 2025, soit une augmentation de 11 672 MDT. Cette hausse est attribuable au financement du déficit budgétaire (11 015 MDT – voir plus loin) et en raison de l’impact des taux de change (650 MDT), précise le rapport du ministère relatif au projet de budget de l’État pour l’année 2026.
En termes de pourcentage par rapport au PIB, la dette de l’État devrait atteindre 83,41% à la fin de l’année 2026 contre 84,02% prévus pour l’année 2025 et 84,9% enregistrés en 2024.
Là encore et comme pour l’indice de l’inflation, une amélioration d’à peine de 1% du niveau d’endettement de l’Etat n’est pas vraiment significative d’un redressement réel des finances publiques. Ce sont des niveaux d’endettement qui restent alarmants et sont supérieurs à ceux des pays voisins tels que l’Algérie (50% du PIB en 2024), ou le Maroc (70% du PIB) en 2024.
Ce qui est encore plus inquiétant pour la solvabilité du pays est que, selon le ministère des Finances même, une hausse de 1% des taux de change des devises étrangères par rapport au dinar entraînerait une augmentation du volume de la dette de l’État d’environ 593 MD, soit 0,32% du PIB. Lorsqu’on sait que 60% de la dette publique totale est libellée en euros et en dollars, ces chiffres illustrent la vulnérabilité des finances publiques, car une dépréciation du dinar, même modérée, suffit ainsi à alourdir mécaniquement le poids du service de la dette, qui absorbe déjà une part importante du budget de l’État.
En tout état de cause, les chiffres officiels de la dette publique, que les experts internationaux connaissent certainement, ne vont pas dans le sens d’un «redressement économique tangible», ni d’une «résilience» de l’économie tunisienne, que le gouverneur évoque dans son discours à Washington
Accroissement du déficit commercial
C’est un des déséquilibres structurels de notre économie que le gouverneur de la BCT s’est bien gardé d’évoquer mais que les experts internationaux à qui il s’adressaient doivent avoir bien présent en tête. En effet, depuis toujours et de plus en plus, la balance commerciale de la Tunisie enregistre un déficit courant de plus en plus élevé. Ainsi, durant les neuf premiers mois de 2025, le déficit commercial a atteint -16 728 MD, contre -13 497 MD sur la même période en 2024, soit une augmentation de +23,9%. Le taux de couverture (exportations/importations) décline également, baissant à 73,5 % à fin septembre 2025 contre 77,5 % un an auparavant.
Cela veut dire une chose très simple à comprendre : nous continuons à être tributaires des importations parce que nous continuons à consommer davantage que ce que nous produisons, et même de plus en plus.
En termes de pourcentage du PIB, le déficit commercial attendu pour l’année 2025 est estimé à 11,5%, contre 5,9%en 2020.
Face à ces chiffres de source INS, parler de redressement et de résilience de l’économie tunisienne devant une assemblée d’experts internationaux et de représentants des bailleurs de fond qui ne les connaissent que trop bien est pour le moins «téméraire», pour ne pas employer d’autres mots blessants pour notre gouverneur.
La BCT, vache à lait de l’Etat
Le projet de loi des finances pour l’année 2026 (PLF2026) prévoit un déficit budgétaire de 11,015 milliards DT, soit 4,9% du PIB, un taux largement supérieur à la norme en matière de bonne gestion des finances publiques, qui s’élève, selon l’Union européenne (UE), à 3% du PIB (critère de Maastricht).
Plus grave encore, en vertu de l’article 12 de cette LPF2026, la totalité de ce déficit budgétaire sera financé par la BCT sous forme de facilités de trésorerie à accorder sans intérêt au Trésor, remboursables sur 15 ans, dont 3 ans de grâce (en plus des 19 milliards DT d’emprunts intérieurs, et 6,8 milliards DT d’emprunts extérieurs prévus pour satisfaire les besoins de financement de l’Etat, soit 27 milliards de DT) C’est exactement ce qu’on appelle le «mécanisme de la planche à billet» qui est un processus hautement inflationniste puisqu’il consiste à créer, après un jeu d’écriture comptable, une nouvelle quantité de monnaie sans aucune contrepartie réelle (accroissement de la production ou des exportations ou des flux invisibles).
A ce sujet, j’ai été l’un des rares économistes du pays à défendre dans plusieurs articles publiés dans Kapitalis, l’idée de révision de la loi 35 de 2016 relative au statut d’indépendance de la BCT, dont l’article 25 lui interdisait de souscrire aux bons du trésor lancé par l’Etat pour couvrir son déficit budgétaire et l’obligeait à passer par les banques commerciales, qui prélèvent au passage des taux de rémunération exorbitants (jusqu’à 9,75% pour les titres à échéance de dix ans). J’avais même publié un article pour féliciter le chef de l’Etat lorsqu’il a eu la lucidité économique et le courage politique de réformer le statut de la BCT en établissant une nette distinction entre son «autonomie» administrative et financière et son «indépendance de décision» en tant qu’institution publique qui doit être au service de la stratégie de développement économique et social décidé par l’Etat, avant toute autre considération ( Voir : «Plaidoyer en faveur de l’amendement de la loi sur l’indépendance de la BCT»)
Mais mes recommandations incluaient la mise en place de garde-fous, sous forme d’un pourcentage maximum du déficit budgétaire à financer directement par la BCT sous forme d’avances au Trésor (j’avais proposé entre 5% et 10%), proposition qui malheureusement n’a pas été retenue puisque dans la PLF 2026, la BCT est appelée à financer 100% du déficit budgétaire et devenir en quelque sorte la vache à lait de l’Etat : il peut financer par ce biais toutes les dépenses qu’il veut, justifiées ou non.
C’est un virage de politique économique et financière très dangereux non seulement en termes d’accroissement de la dette publique et d’aggravation des déséquilibres macro-économiques, mais aussi en termes de justice sociale : l’Etat reprend de la main gauche sous forme d’inflation, qui est un impôt déguisé qui se traduit par une baisse du pouvoir d’achat, ce qu’il a accordé de la main droite sous forme de salaires et de dépenses sociales supplémentaires.
Le gouverneur de la BCT croit-il à ses propres déclarations ?
La question mérite à mon sens d’être posée, parce que le gouverneur est réputé pour être un économiste compétent, du moins selon les médias audiovisuels dont il était «le chouchou» et sur lesquels il intervenait presque tous les jours pour commenter l’actualité économique, avant qu’il ne soit nommé à la tête de la BCT. En tant que tel, il aurait été mieux inspiré de parler d’ «accalmie» ou de «stabilisation des déséquilibres macroéconomiques» dont souffre l’économie tunisienne, ce qui est vrai, plutôt que de parler de de «redressement économique tangible» ou de «la capacité de la Tunisie à maintenir une croissance durable», ce que l’analyse des chiffres officiels que j’ai effectuée plus haut ne confirme pas et que les experts internationaux dont je fais partie savent certainement.
Une des raisons qui me fait douter de la sincérité des déclarations de notre gouverneur est qu’en matière d’inflation par exemple, la baisse annoncée de celle-ci ne s’est pas traduite par une baisse du taux directeur de la BCT, alors qu’en toute logique, elle devrait l’être puisque le taux d’intérêt réel (différence entre taux directeur et taux d’inflation) est devenu encore plus positif.
L’explication que je trouve est que les responsables de la BCT ne croient pas eux-mêmes à une baisse réelle et irréversible de l’inflation malgré la baisse de l’IPC et n’excluent pas qu’elle puisse reprendre de plus belle sous l’effet de chocs extérieurs ou même intérieurs tels que le financement à 100% du déficit budgétaire par le mécanisme de la planche à billet.
Mon sentiment personnel est qu’il n’a fait qu’obéir aux instructions du chef de l’Etat qui l’avait reçu avant son départ pour Washington et qui a manifestement «un compte à régler» avec le FMI dont il avait refusé l’aide pour la remplacer par sa stratégie du «compter sur soi» dont il tient à montrer au monde entier le succès ou ce que le gouverneur de la BCT lui avait présenté comme tel.
Une autre explication possible est que, pour garder son poste à la tête de la BCT, le gouverneur a fait de telles déclarations volontairement triomphalistes afin de montrer à ses pairs et en particulier au chef de l’Etat, qui est juriste de formation et ne maîtrise donc pas les mécanismes complexes d’évaluation de l’équilibre macro-économique d’un pays, que depuis qu’il préside la BCT, l’économie du pays se porte beaucoup mieux et tous les indicateurs sont au vert.
Mais, que la vérité se trouve dans l’une ou l’autre explication, une chose est certaine : de tels discours qui enjolivent la réalité et ne sont pas confirmés par les chiffres réels affectent la crédibilité des discours politiques tenus par tous les responsables et la confiance de la population dans ses gouvernants.
* Economiste universitaire et consultant international.
L’article Embellie de l’économie de la Tunisie | Le vrai du faux est apparu en premier sur Kapitalis.