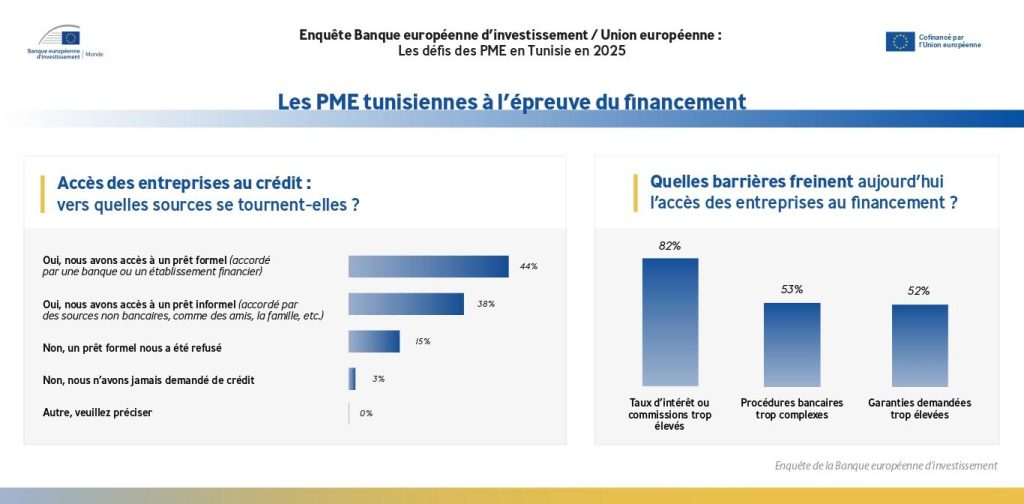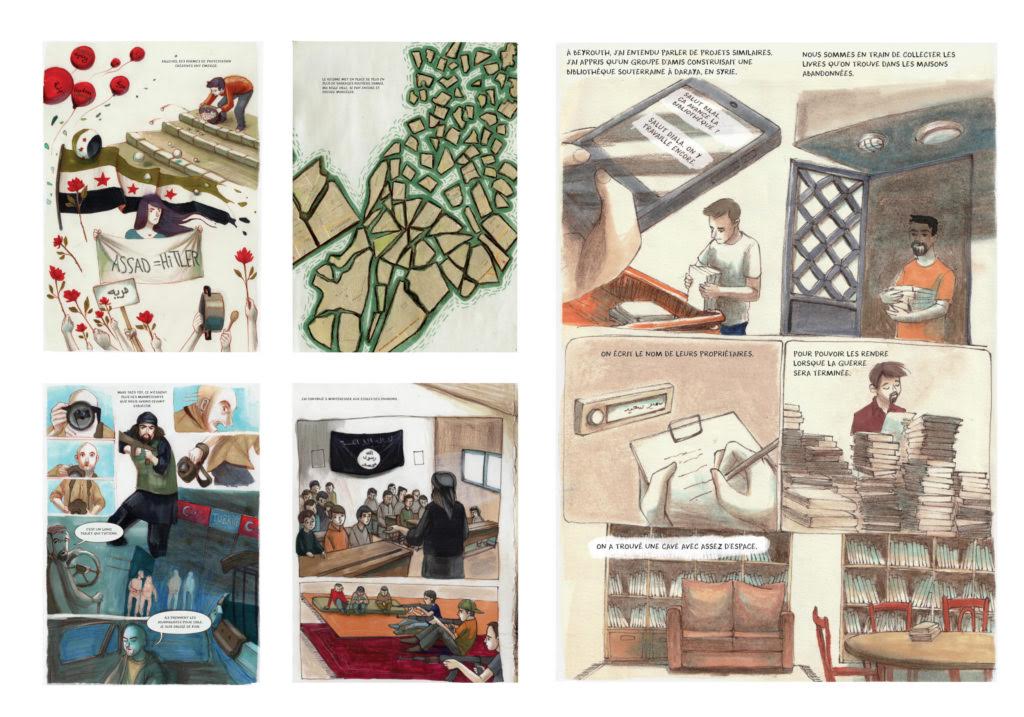Énorme perte en temps et en effort en 6 ans. C’est Fitch-Solutions qui le confirme, preuve à l’appui, dans son plus récent rapport intitulé ‘‘Consommation et revenus des ménages tunisiens’’ publié le 22 octobre 2025). L’arbre se juge à ses fruits…
Moktar Lamari *
L’agence londonienne annonce que le pouvoir d’achat moyen des Tunisiennes et Tunisiens a fortement reculé depuis 2019, malgré toutes les annonces et promesses gouvernementales voulant axer ses politiques sur le social et le bien-être des laissés-pour-compte, les couches dites défavorisées, souvent illettrées et habitées par la confiance aveugle.
Que disent les chiffres ?
Dans son rapport de 44 pages (réservé aux abonnés et publié uniquement en anglais), l’année de 2019, celle de l’élection de Kaïs Saïed, est utilisée comme année de référence. Pas de hasard de calendrier, tout est calculé, et soupesé à la virgule près. Et cela permet de livrer plusieurs indicateurs de rendement sur les impacts des politiques des 6 gouvernements constitués, et qui ont tous gouverné la Tunisie, sous les directives indicatives d’un président élu en 2019 et réélu en 2024.
On fait la synthèse de ce rapport en 5 points complémentaires.
1- Pouvoir d’achat. Comparativement à 2019, le pouvoir d’achat réel de 2025 (hors inflation) a baissé de 11,1% par rapport à 2019. Fitch doute du réalisme des promesses présidentielles relatives à la mise en place de politiques publiques axées sur le social et les couches vulnérables.
Pis, Fitch prévoit que si rien ne changera avant à la fin du deuxième mandat du président Saïed en 2028, la Tunisie ne retrouverait pas la moyenne du pouvoir d’achat réel d’il y a 6 ans (base 100 en 2019). Un constat qui appelle à des actions concrètes et urgentes sur ce front.
2- Consommation versus croissance. Un autre constat majeur apporté par ce rapport concerne une anomalie économique structurelle : un taux de croissance annuel global moyen du PIB qui croit d’environ 2%, alors que le taux de croissance de la consommation des ménages croit annuellement de 3,8%.
C’est dire que le pays vit au-dessus de ses moyens. Et qu’au final, la propension moyenne de la consommation (rapportée au revenu) évolue plus vite et plus fort que la propension moyenne à l’épargne.
3- Chômage. Les niveaux de chômage, 6 ans après l’élection présidentielle de 2019, sont plus élevés qu’ils ne l’étaient avant 2019. C’est un autre constat sans appel quant aux prétentions des politiques publiques d’avoir mis le social au cœur de ses préoccupations.
Ce constat en dit long sur l’absence de vision stratégique dans les processus budgétaires, la faiblesse des incitations fiscales pour la création d’entreprises et d’emplois. Le projet des entreprises communautaires prôné par le président Saïed est à l’évidence inapproprié, ou mal conçu et mal réfléchi depuis sa mise en chantier en 2021.
4- Dépenses non essentielles. Le rapport de Fitch décrit la structure des dépenses des ménages tunisiens, et arrive à des résultats différents de ceux de l’Institut national de la statistique (INS). On apprend que les dépenses non essentielles (tabac, alcool, restaurant et internet) frôlent ensemble les 9% des dépenses des ménages.
A titre comparatif, Fitch estime les dépenses des ménages en éducation ne dépassent les 1,2% du total des dépenses. Dans les dépenses des ménages, le tabagisme engloutit 4,9 milliards de dinars tunisiens en 2025. Ce poste de dépenses croit à 11% par an.
Un poste de dépenses atypique : les chaussures. Fitch trouve trop élevées les dépenses en chaussure per capita qui est de 463 dinars par an. Selon, cette estimation, une famille de 4 personnes dépenserait presque 2000 dinars par an en chaussure. Il faut le faire, surtout quand on connaît les autres urgences et priorités.
5- Pauvreté. Les auteurs du rapport ont aussi décrit le revenu disponible des ménages selon 3 intervalles. Ils ont recensé un total de 3334 ménages en Tunisie, avec 2,5 actifs occupés par ménage.
Le revenu moyen par ménage est de 30 765 dinars par an en moyenne. En revanche, le revenu disponible (après imposition et prélèvements estimés à 7%) tombe à 10 092 dinars per capita en 2025.
La classe ayant un revenu disponible annuel moyen par ménage (inférieur à 10 000$ par an) a grimpé jusqu’à 95% du total des ménages. Les plus riches, avec un revenu annuel disponible supérieur à 50 000$ par an constituent 2% du total des ménages.
Les plus pauvres (revenu inférieur à 5 000 dollars par ménage et par an) constituent presque 20% du total des ménages (666 000 ménages, ou 2 400 000 personnes).
A se demander si les politiques sociales prônées par le président Saïed arrivent à cibler et à lister de manière crédible et efficace ces populations indigentes et précaires pour les sortir de leur indigence.
Les personnes âgées, les personnes en perte de mobilité, les femmes et surtout celles de la GenZ sont les plus impactées par ces inégalités et déséquilibres socio-économiques. Des enjeux qu’on ne peut pas gérer par la répression, ni par les discours ou autres juridismes caduques et inefficaces.
* Economiste universitaire.
Blog de l’auteur : E4T.
L’article Le pouvoir d’achat réel des Tunisiens a baissé de 11% depuis 2019 est apparu en premier sur Kapitalis.