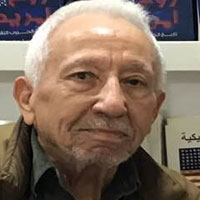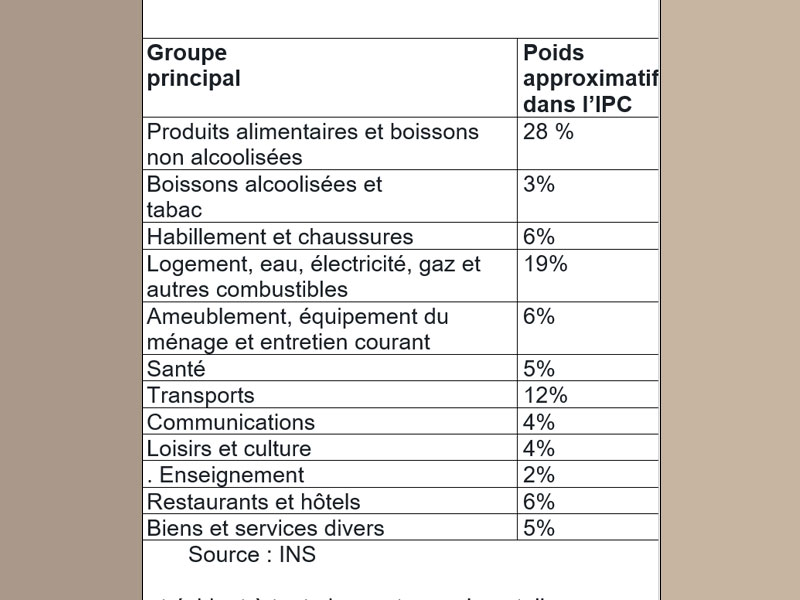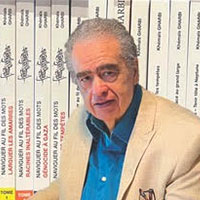Fin de la démocratie | Vers une gouvernance algorithmique ?
Depuis deux mille cinq cents ans, le mot démocratie incarne l’idéal politique par excellence. Héritée d’Athènes, elle fut pensée comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple — une définition que Lincoln a reprise à son compte en 1863. Mais à l’ère du numérique, les jeunes génies de la Silicon Valley, baignés dans la culture des data et des algorithmes prédictifs, remettent en cause cette conception. À leurs yeux, la démocratie représentative est lente, irrationnelle et inefficace face à des crises globales (écologiques, économiques, sanitaires) qui exigent des réponses rapides et fondées sur des données massives.
Zouhaïr Ben Amor *
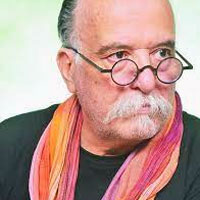
L’idée d’une gouvernance algorithmique, bien que futuriste, est déjà présente dans les travaux de chercheurs tels que Shoshana Zuboff (The Age of Surveillance Capitalism, 2019) et Yuval Noah Harari (Homo Deus, 2015), qui envisagent un monde où la donnée devient un nouvel instrument de pouvoir. Cette «technocratie numérique» n’est plus une fiction, mais un horizon politique envisagé dans les laboratoires californiens, entre une réunion chez OpenAI et un colloque chez Palantir.
I. Le procès de la démocratie
Pour les jeunes ingénieurs de la Silicon Valley, la démocratie est malade. Les taux d’abstention records, la polarisation idéologique, la lenteur législative et la désinformation sur les réseaux sociaux en sont les symptômes les plus visibles. Le politologue Pierre Rosanvallon (La légitimité démocratique, 2008) avait déjà diagnostiqué cette crise de confiance, montrant comment la démocratie représentative s’érode sous le poids de la défiance et du populisme.
Ces nouveaux techno-réformateurs considèrent que la «voix du peuple» exprimée par le vote est obsolète face à la puissance des algorithmes capables de capter nos comportements en continu. Le philosophe Bernard Manin (Principes du gouvernement représentatif, 1995) rappelait pourtant que l’élection repose sur une confiance symbolique, non sur la pure rationalité. Or les Jeunots Génies veulent substituer à cette confiance une mesure permanente des désirs collectifs, comme s’il suffisait d’observer pour comprendre.
Leur critique n’est pas sans fondement : les scandales de corruption et la manipulation électorale (Cambridge Analytica, 2018) ont montré les limites d’un système vulnérable à la désinformation. Mais en voulant remplacer la délibération par la modélisation, ces ingénieurs risquent de réduire la politique à un problème d’optimisation mathématique, oubliant que, selon Hannah Arendt (La Condition de l’homme moderne, 1958), la politique est avant tout un espace d’action et de parole, non de calcul.
II. Une gouvernance par l’algorithme
Le projet des Jeunots Génies est clair : créer une gouvernance où l’intelligence artificielle (IA) remplace la représentation. Chaque citoyen serait un flux de données – ses achats, ses déplacements, ses interactions – analysé pour produire une image fidèle de la volonté collective. L’IA deviendrait un arbitre omniscient, garantissant la justice et l’efficacité.
Cette vision s’inscrit dans la logique du dataïsme décrite par Harari (Homo Deus, chap. 11) : la croyance selon laquelle les données représentent mieux la réalité que les récits humains. En s’appuyant sur des technologies comme la blockchain et l’apprentissage profond (deep learning), l’IA pourrait proposer des politiques fiscales, écologiques ou sanitaires « optimales », basées sur des indicateurs en temps réel.
Mais cette idée rejoint la cybernétique politique imaginée par Norbert Wiener dès 1948, où le contrôle des flux d’information remplace le débat humain. Evgeny Morozov (To Save Everything, Click Here, 2013) met pourtant en garde contre cette illusion du solutionnisme technologique : croire que la technologie peut résoudre les problèmes politiques en les dépolitisant.
Le danger est que cette IA devienne non plus un outil, mais un souverain algorithmique. Qui programmera ses valeurs ? Qui contrôlera ses priorités ? Comme l’a souligné Nick Bostrom (Superintelligence, 2014), une IA dotée d’un pouvoir de décision pourrait rapidement échapper au contrôle humain, transformant la gouvernance en une forme inédite de despotisme numérique.
III. Utopie ou dystopie ?
Le rêve d’une rationalité parfaite se heurte à la question du libre arbitre. Si la machine devine nos désirs avant nous, que devient la liberté ? L’éthique de l’IA, développée notamment par Luciano Floridi (The Ethics of Information, 2013), rappelle que toute donnée est une interprétation : elle n’est ni neutre ni objective. L’IA reproduit les biais de ses concepteurs (bias-in, bias-out).
L’élimination du débat public, de la contradiction et du conflit risquerait d’abolir ce qui fonde la démocratie : la pluralité. Jacques Rancière (La Mésentente, 1995) montre que la démocratie est précisément l’espace du désaccord, où la parole du peuple surgit contre l’ordre établi. La remplacer par un consensus algorithmique reviendrait à instaurer une police des comportements.
De plus, la gouvernance algorithmique pourrait accentuer les inégalités de pouvoir. Comme l’a démontré Cathy O’Neil (Weapons of Math Destruction, 2016), les algorithmes prétendument neutres renforcent souvent les discriminations qu’ils sont censés éliminer. L’utopie d’une justice automatisée vire ainsi à la dystopie technocratique.
IV. Vers un modèle hybride ?
Face à ces dérives potentielles, certains chercheurs envisagent une voie médiane : une démocratie augmentée par l’IA, mais non remplacée par elle. Ce modèle rejoint les réflexions d’Antoinette Rouvroy et Thomas Berns (Le gouvernement algorithmique et la politique des affects, 2013), selon lesquels l’IA peut contribuer à la décision publique, à condition que la transparence et la responsabilité soient assurées.
L’IA deviendrait alors un auxiliaire : elle simule les scénarios, aide à anticiper les crises, éclaire les citoyens. Les élus deviendraient des médiateurs entre le savoir algorithmique et la volonté populaire. Ce modèle rappelle le concept d’«intelligence collective» cher à Pierre Lévy (L’intelligence collective, 1994), où la technologie amplifie la réflexion humaine sans la remplacer.
Mais un tel projet exige une révolution éducative et éthique. Comme le souligne Timnit Gebru (2020), cofondatrice de Black in AI, sans diversité culturelle et contrôle citoyen, aucune IA ne peut prétendre servir l’humanité. L’éducation au raisonnement critique et à la donnée deviendra alors un pilier de la citoyenneté numérique.
Conclusion
Les Jeunots Génies ont raison sur un point : la démocratie athénienne, dans sa forme actuelle, ne suffit plus à gérer la complexité du monde. Cependant, vouloir substituer la machine à l’homme revient à oublier que la démocratie n’est pas une méthode de calcul, mais un projet moral. Claude Lefort (L’invention démocratique, 1981) rappelait que la démocratie repose sur un vide symbolique : nul ne détient le pouvoir en propre, il se négocie en permanence. Or, l’algorithme, en prétendant incarner la vérité, referme cet espace du vide et du débat.
Ainsi, entre l’idéalisme athénien et le pragmatisme algorithmique, la voie à inventer est celle d’une démocratie éclairée par la technologie, mais guidée par des valeurs humaines : liberté, pluralité, responsabilité. La question n’est pas de savoir si l’IA remplacera la démocratie, mais comment elle peut l’aider à se réinventer sans la trahir.
Bibliographie sélective :
- Arendt, H. La Condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy, 1958.
- Bostrom, N. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, Oxford University Press, 2014.
- Floridi, L. The Ethics of Information, Oxford University Press, 2013.
- Harari, Y. N. Homo Deus, Albin Michel, 2017.
- Lefort, C. L’invention démocratique, Fayard, 1981.
- Manin, B. Principes du gouvernement représentatif, Flammarion, 1995.
- Morozov, E. To Save Everything, Click Here, PublicAffairs, 2013.
- O’Neil, C. Weapons of Math Destruction, Crown, 2016.
- Rancière, J. La Mésentente, Galilée, 1995.
- Rosanvallon, P. La légitimité démocratique, Seuil, 2008.
- Rouvroy, A. & Berns, T. Le gouvernement algorithmique et la politique des affects, Presses Universitaires de Namur, 2013.
- Wiener, N. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine, MIT Press, 1948.
- Zuboff, S. The Age of Surveillance Capitalism, Profile Books, 2019.
L’article Fin de la démocratie | Vers une gouvernance algorithmique ? est apparu en premier sur Kapitalis.