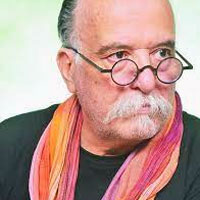Gaza ou l’éternel retour des Palestiniens
La défense civile de Gaza a affirmé vendredi 10 octobre 2025 que près de 200 000 personnes étaient revenues dans le nord du territoire palestinien depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. Fabuleux peuple palestinien, magnifique Gaza, qui plie mais ne rompt pas. Détruite, rasée, assassinée mais restée debout, digne et fière pour avoir tenu en échec l’ignoble machine de guerre du raciste et corrompu Benjamin Netanyahu, maître d’œuvre du génocide des Palestiniens.
Abdelaziz Dahmani
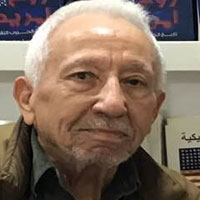
Heureux jour, le vendredi 10 octobre 2025, cessez-le-feu ou paix «provisoire» (car rien n’est durable ou définitif avec l’Etat d’Israël), le peuple palestinien, et notamment celui de Gaza, respire de bonheur, après 730 jours au cours desquels il a connu toutes les horribles facettes de l’enfer sur terre…
Admirables Palestiniens, exceptionnels, réduits à toutes les misères, exposés à tout instant à la faim, à la soif et à la mort, ils sont restés debout, réduits à la mendicité, sans toit, ni travail, ni de quoi manger, ni médecin pour se soigner, ni école pour les enfants…, mais debout et fiers. Même si les seuls chemins permis aux survivants sont ceux des cimetières collectifs, avec juste des numéros plantés dans le sable, pour désigner leurs morts.
Israël, devenu, encore plus raciste, plus sanguinaire, voulait réduire Gaza à rien, à la disparition même de l’Histoire, de son passé, de sa culture et de son identité. Cette ville millénaire, Israël voulait la réduire en poussière. Ce dessein, qui a germé dans la tête pourrie de Itamar Ben G’vir et autres monstres sionistes, n’a pu être réalisé… Car le peuple palestinien reste grand et admirable de courage, de dignité, d’honneur.
Ce peuple de Palestine et, surtout, de Gaza, réduit à presque à rien, n’a pas mis en échec seulement Israël. Il a mis en échec aussi les soutiens occidentaux de cet Etat factice et belliqueux qui sème la haine et la mort au Moyen-Orient depuis 1948. Ces soi-disant puissances occidentales qui croient avoir droit de vie et de mort sur le reste de l’humanité. Et à leur tête un Donald Trump plus déconcertant que jamais, qui, après avoir armé Israël et attisé la violence dans la bande de Gaza, se veut, aujourd’hui, maître de cérémonie d’une improbable paix.
La déportation des Palestiniens est une «ligne rouge»
En réalité, c’est Trump que le peuple de Gaza a mis en échec. Rappelez-vous, les débiles déclarations du président américain, lors de son intronisation à la tête des États Unis, en janvier de cette année, lorsqu’il a formé le vœu de déporter les deux millions de Gazaouis vers l’Egypte et la Jordanie, de vider Gaza de sa population et d’y construire une Riviera sur la côte orientale de la Méditerranée, une sorte de club de riches, son jardin privé, son parcours de golf… Mais les Gazaouis lui ont résisté et n’ont pas abandonné leur terre, et là, il faudrait aussi rendre hommage à l’Egypte, qui a fait de la déportation des Palestiniens une «ligne rouge»…
On ne le dira jamais assez, mais dans cette affaire de Gaza, c’est le fasciste Netanyahu qui a subi son plus grand échec politique en n’atteignant aucun de ses objectifs, malgré l’ampleur inégalée des massacres et des destructions infligés aux Palestiniens et à son propre peuple.
Souvenez-vous, après le drame du 7 octobre 2023, Netanyahu s’est donné pour mission de briser le Hamas en peu de temps et libérer aussi rapidement les otages israéliens. Que s’est passé ? Deux ans après, le Hamas est certes fortement secoué, affaibli, muselé, mais il n’a pas été battu et n’a pas rendu les armes. Et la résistance palestinienne, avec ou sans le Hamas, restera toujours debout.
La leçon d’abnégation et de résilience du peuple palestinien
Avec les inhumaines destructions qu’il a provoquées, Israël s’est vengé d’une façon ignoble sur les Palestiniens, simples citoyens, assassinant plus de 20 000 bébés et enfants. Et par un retour de manivelle, il a rendu la cause de la libération de la Palestine visible dans le monde entier. Et a fait d’Israël un pays hors-la-loi, banni, haï et stigmatisé lors des innombrables et immenses manifestations propalestiniennes dans le monde entier et, surtout, dans les pays occidentaux, principaux alliés de l’Etat hébreu, où le drapeau palestinien n’a jamais été aussi visible dans les rues.
Certes, Gaza est détruite par la force brutale et la haine destructrice d’un Etat voyou, aujourd’hui mis au ban de l’humanité. Mais Gaza est toujours debout et son peuple, admirable de courage, donne une leçon d’abnégation et de résilience au reste du monde, y compris à nos régimes arabes, riches et moins riches, soumis à leurs maîtres occidentaux, repliés sur leurs médiocres problèmes internes et empêchant leurs peuples de respirer…
Un dernier mot : avant le 7 octobre 2023, la cause palestinienne était presque morte et enterrée… La voilà aujourd’hui plus vivante que jamais, malgré les malheurs et les destructions… Et c’est l’ignoble Netanyahu, aveuglément soutenu par les extrémistes juifs, qui met aujourd’hui l’existence d’Israël en danger, en tout cas dans la conscience des hommes justes !
* Journaliste.
L’article Gaza ou l’éternel retour des Palestiniens est apparu en premier sur Kapitalis.