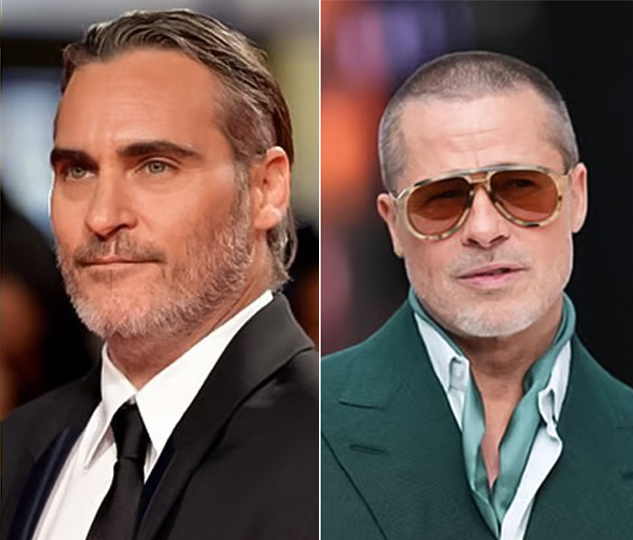Parution – « La chorégraphie comme thérapie de l’âme et du corps dans le milieu scolaire » de Walid Ksouri : Vers une nouvelle approche inclusive
Un socle théorique s’incarne dans une série de propositions concrètes. L’auteur va au-delà du discours conceptuel en suggérant des activités applicables en contexte scolaire : ateliers de danse expressive, exercices de mouvement thérapeutique, dispositifs corporels adaptés à l’âge des apprenants…
La Presse — L’ouvrage de Walid Ksouri propose une réflexion ambitieuse et originale sur l’intégration de la chorégraphie dans l’espace éducatif. Sa lecture peut être articulée autour de trois axes essentiels : la méthodologie, l’apport cognitif et la valeur pratique, auxquels s’ajoute une appréciation globale de sa portée académique.
Dès les premières pages, l’auteur affirme une intention claire : relier la chorégraphie — envisagée comme art du mouvement et de la structuration corporelle — au cadre scolaire, lieu par excellence de transmission et de formation.
Pour ce faire, il adopte une démarche interdisciplinaire, croisant les arts de la scène (danse et théâtre), les sciences de l’éducation et la psychologie. Ce positionnement méthodologique place l’ouvrage au carrefour de recherches contemporaines qui explorent des outils alternatifs pour enrichir l’enseignement.
Il en découle une approche à la fois originale et légitime du point de vue académique.
Prolongeant ce cadre méthodologique, l’auteur approfondit la dimension cognitive et théorique de son sujet. Il redéfinit la chorégraphie non seulement comme un art esthétique, mais aussi comme un outil thérapeutique et éducatif, capable de développer simultanément le corps et l’esprit.
Dans cette optique, Ksouri propose une mise en perspective historique et philosophique du concept de chorégraphie, en l’articulant avec des notions telles que la thérapie par le mouvement, l’éducation physique ou encore la thérapie psycho-corporelle.
Il plaide ainsi pour une intégration pleine et entière de cette pratique dans les programmes scolaires, considérant ses bénéfices sur des fonctions cognitives clés : la concentration, l’imagination et la capacité d’expression — tant individuelle que collective.
Ce socle théorique s’incarne ensuite dans une série de propositions concrètes. L’auteur va au-delà du discours conceptuel en suggérant des activités applicables en contexte scolaire : ateliers de danse expressive, exercices de mouvement thérapeutique, dispositifs corporels adaptés à l’âge des apprenants…
Ces éléments traduisent une véritable volonté d’opérationnaliser la réflexion, en mettant en lumière les vertus pédagogiques de la chorégraphie : développement moteur, bien-être psychologique, amélioration de l’estime de soi, stimulation de la créativité.
Un accent particulier est mis sur le rôle que peut jouer la pratique corporelle dans la redéfinition de l’espace scolaire public, conçu comme un lieu d’expression libre, en rupture avec les cadres traditionnels.
Enfin, l’ouvrage se distingue également par sa portée scientifique. Il s’inscrit dans le champ des recherches contemporaines sur l’éducation par les arts, tout en venant combler une lacune dans le corpus arabe.
Les études traitant de la chorégraphie sous un angle à la fois éducatif et thérapeutique y sont en effet rares.
Ksouri enrichit sa réflexion par des références philosophiques (Nietzsche, Laban, Bachelard…) et s’appuie sur des expériences artistiques internationales, renforçant la dimension intellectuelle et comparative de son propos.
Par son originalité, sa rigueur méthodologique et son ouverture interdisciplinaire, l’ouvrage de Walid Ksouri s’impose comme une contribution majeure aux études arabes sur l’éducation et les arts.
Il défend une vision innovante de la chorégraphie, envisagée comme outil thérapeutique et éducatif au sein de l’école contemporaine. Sa force réside dans l’articulation fine entre philosophie, art et pédagogie, ainsi que dans la formulation d’alternatives concrètes à l’enseignement traditionnel.
En cela, cet ouvrage pourrait devenir une référence incontournable pour les chercheurs et praticiens intéressés par l’éducation artistique, les pratiques corporelles et la thérapie par le mouvement.