Pour la deuxième fois, Saeed Roustaee quitte le Festival de Cannes sans figurer au palmarès officiel, et cela demeure difficilement compréhensible. En 2022, son remarquable Leila et ses frères avait certes remporté le Prix FIPRESCI, mais n’avait reçu aucune récompense du jury officiel. Cette année, avec Woman and Child, le cinéaste iranien livre pourtant un nouveau film puissant, parfaitement maîtrisé, qui aurait largement mérité une reconnaissance à la hauteur de son audace et de sa profondeur.
Présenté en sélection officielle au 78ème Festival de Cannes, Woman and Child (Zan o Bacheh, en version originale) a immédiatement marqué les esprits lors de sa première au Grand Théâtre Lumière. Accueilli par une longue standing ovation, ce film bouleversant illustre avec force les tensions sociales et intimes qui agitent l’Iran d’aujourd’hui.
Saeed Roustaee, réalisateur iranien né en 1989 à Téhéran, s’est imposé comme l’un des cinéastes les plus pertinents de sa génération. Diplômé de l’Université Soore de Téhéran, il est connu pour ses œuvres incisives telles que Life and a Day (2016) et La Loi de Téhéran (2019), qui explorent les fractures sociales et les violences au sein de la société iranienne. Saeed Roustaee est aussi un artiste dont la liberté d’expression a été mise à rude épreuve. Son film Leila et ses frères (2022), présenté à Cannes sans l’aval des autorités iraniennes, lui a valu des démêlés judiciaires importants, avec une condamnation à six mois de prison avec sursis pour « propagande contre le régime ».
Woman and Child se concentre sur le parcours de Mahnaz, interprétée avec une intensité remarquable par Parinaz Izadyar, une infirmière veuve qui élève seule ses enfants dans le Téhéran contemporain, avec l’aide de sa mère chez laquelle elle vit. Alors qu’elle s’apprête à refaire sa vie avec Hamid, son fiancé joué par Payman Maadi, un drame familial survient : le fils de Mahnaz est renvoyé de l’école, et bientôt, un accident tragique vient bouleverser le fragile équilibre familial. Ce choc intime devient le révélateur de tensions plus larges, sociales et politiques, qui traversent la société iranienne.
Le synopsis pourrait sembler classique à première vue, mais c’est dans la manière dont Saeed Roustaee construit cette histoire qu’émerge toute la force du film. La narration est subtile, entre suspense et émotion brute, et jamais le réalisateur ne cède à la facilité. Le film déroute par ses nombreux retournements narratifs, ces twists qui bousculent notre compréhension des personnages et de leur réalité, tout en maintenant une tension dramatique jusqu’à la dernière minute. Cette construction complexe, digne d’un thriller psychologique, épouse brillamment la montée d’une tension sociale palpable dans l’Iran d’aujourd’hui.
L’une des grandes forces du film réside dans son portrait d’une femme iranienne contemporaine, confrontée à une société patriarcale et répressive. Mahnaz est une figure d’indépendance et de résistance, qui lutte pour sa liberté et celle de ses enfants. Mais son combat est aussi celui de toutes les femmes iraniennes, enfermées dans un système rigide où le poids des traditions misogynes, des lois et des normes religieuses, pèse lourdement. À travers elle, Saeed Roustaee donne une voix à une population qui souffre en silence, un cri étouffé mais vibrant. Ce portrait social est d’autant plus fort qu’il est porté par l’interprétation intense et juste de Parinaz Izadyar, saluée à l’unanimité par la critique. Beaucoup ont estimé qu’elle méritait haut la main le Prix de la meilleure interprétation féminine à Cannes, tant son jeu mêle vulnérabilité et force, douleur et rage contenue.

Mais cette œuvre sociale majeure n’a pas échappé à la polémique. Woman and Child a suscité une controverse avant même sa présentation à Cannes. L’Association des cinéastes iraniens indépendants (IIFMA) a accusé Saeed Roustaee de faire de la « propagande » pro-régime, en raison notamment de l’obtention d’un permis de tournage — perçu comme une marque de compromission — et de la représentation de femmes voilées, y compris dans des scènes se déroulant dans la sphère domestique. Selon l’IIFMA, cela constituerait une trahison du mouvement « Femme, Vie, Liberté », né après la mort de Mahsa Amini et qui a profondément bouleversé la société iranienne.
Roustaee a répliqué publiquement en expliquant que l’autorisation officielle n’était qu’une formalité administrative indispensable pour mener à bien le film féministe qu’il avait en tête. Il a revendiqué son œuvre comme relevant d’un « cinéma de résistance », affirmant que le film devait justement parler de l’émancipation féminine depuis l’intérieur du système, afin de pouvoir atteindre le public iranien.
Lors de la conférence de presse qui a suivi la projection, Roustaee a été interrogé sur la question de l’autocensure, notamment à la lumière de l’interdiction en Iran de son troisième film, Leila et ses frères. Il a répondu qu’il ne savait pas exactement si, dans son inconscient, il s’autocensurait. Âgé de 35 ans et vivant en Iran, il connaît bien son cinéma, qui s’inscrit dans la continuité du cinéma social iranien des 45 dernières années. Il ne sait pas jusqu’où il s’autocensure, si c’est le cas, mais il fait des films pour être vus par le public iranien dans les salles du pays. Il admet donc qu’il fait sûrement attention à certains aspects pour que cela soit possible.
D’autres critiques ont rejoint ce débat, cette fois au sein même de la diaspora iranienne. Certains reprochent à Roustaee de ne pas montrer des femmes assez libres ou assez émancipées à l’écran, estimant qu’il reste trop prudent dans sa manière de les représenter. Alors que, dans la réalité iranienne, un nombre croissant de femmes choisissent de ne pas porter le voile dans la sphère publique, certains lui reprochent de montrer des personnages féminins voilés à la maison, ce qui pourrait être interprété comme une forme d’acceptation ou de normalisation d’une norme imposée. D’autres réalisateurs iraniens ont, ces dernières années, cherché à ne pas respecter cette règle : par exemple Mohammad Rasoulof a choisi, dans son film Le Diable n’existe pas (2020), de montrer des femmes non voilées dans la sphère privée ; ou plus récemment encore Jafar Panahi, dont on voit une femme non voilée y compris dans la rue dans son film Un simple accident. Roustaee, par son travail, navigue avec subtilité dans ces eaux troubles, ce qui ne peut que susciter débats et questionnements.

Sur le plan de la direction d’acteurs, le film brille aussi par la complicité entre Saeed Roustaee et Payman Maadi, acteur qu’il considère comme son « acteur fétiche ». Leur collaboration remonte à Life and a Day, et depuis, Maadi incarne souvent des personnages complexes, révélateurs des contradictions de la société iranienne. Dans Woman and Child, son interprétation de Hamid ajoute une couche supplémentaire à la tension dramatique, entre soutien et conflit familial.
L’écriture du film mérite également une mention spéciale. Le scénario, solidement construit, explore de manière subtile mais incisive les thèmes du deuil, de la justice, et de la condition des femmes. Ce qui fait la force du récit, c’est sa capacité à mêler un drame intime et une critique sociale profonde. La tension narrative est savamment orchestrée, chaque scène apportant son lot de révélations et de retournements, ce qui rend la progression du film captivante et parfois déconcertante. Selon moi, Woman and Child aurait mérité un prix du meilleur scénario à Cannes, tant ce travail d’écriture épouse parfaitement la complexité psychologique des personnages tout en reflétant la réalité sociale iranienne.
Le film est donc une œuvre qui témoigne d’un esprit rebelle profond, d’une volonté farouche de faire entendre une voix féminine dans un contexte où celle-ci est souvent réduite au silence. Woman and Child n’est pas seulement le portrait d’une femme isolée : c’est aussi un miroir de la société iranienne contemporaine, où traditions, religion, pouvoir patriarcal et aspirations individuelles s’entrechoquent douloureusement.
Mais au-delà de son sujet immédiat, Woman and Child interroge aussi, en filigrane, la notion même de responsabilité dans une société où les lignes d’autorité sont brouillées. Où commence l’autorité d’un parent ? Jusqu’où s’étend celle de l’État, de la tradition, ou même de la famille élargie ? En abordant la question de la justice et de la garde des enfants, Saeed Roustaee ouvre la voie à une réflexion plus large sur la manière dont les sociétés patriarcales organisent — ou désorganisent — les liens familiaux et sociaux. Dans un pays où la tutelle légale des enfants est encore majoritairement confiée aux hommes, qu’advient-il des femmes lorsqu’elles réclament, non pas un statut, mais un droit à la voix, à la colère, et à l’auto-détermination ?
Par ailleurs, Woman and Child pose en creux une question plus vaste : que peut encore le cinéma face à la censure, à l’oppression, ou à l’indifférence des institutions ? Jusqu’où un cinéaste peut-il résister tout en restant audible ? Jusqu’où peut-il aller pour défendre sa liberté d’expression et de création ? Faut-il aller jusqu’à quitter son pays, comme l’a fait Mohammad Rasoulof ? Faut-il braver la justice, comme l’a fait Jafar Panahi ? Ces interrogations, laissées en suspens, prolongent la portée du film bien au-delà de l’écran — et convoquent, pour les spectateurs comme pour les programmateurs, une réflexion urgente sur le rôle politique et symbolique de l’art.
Neïla Driss

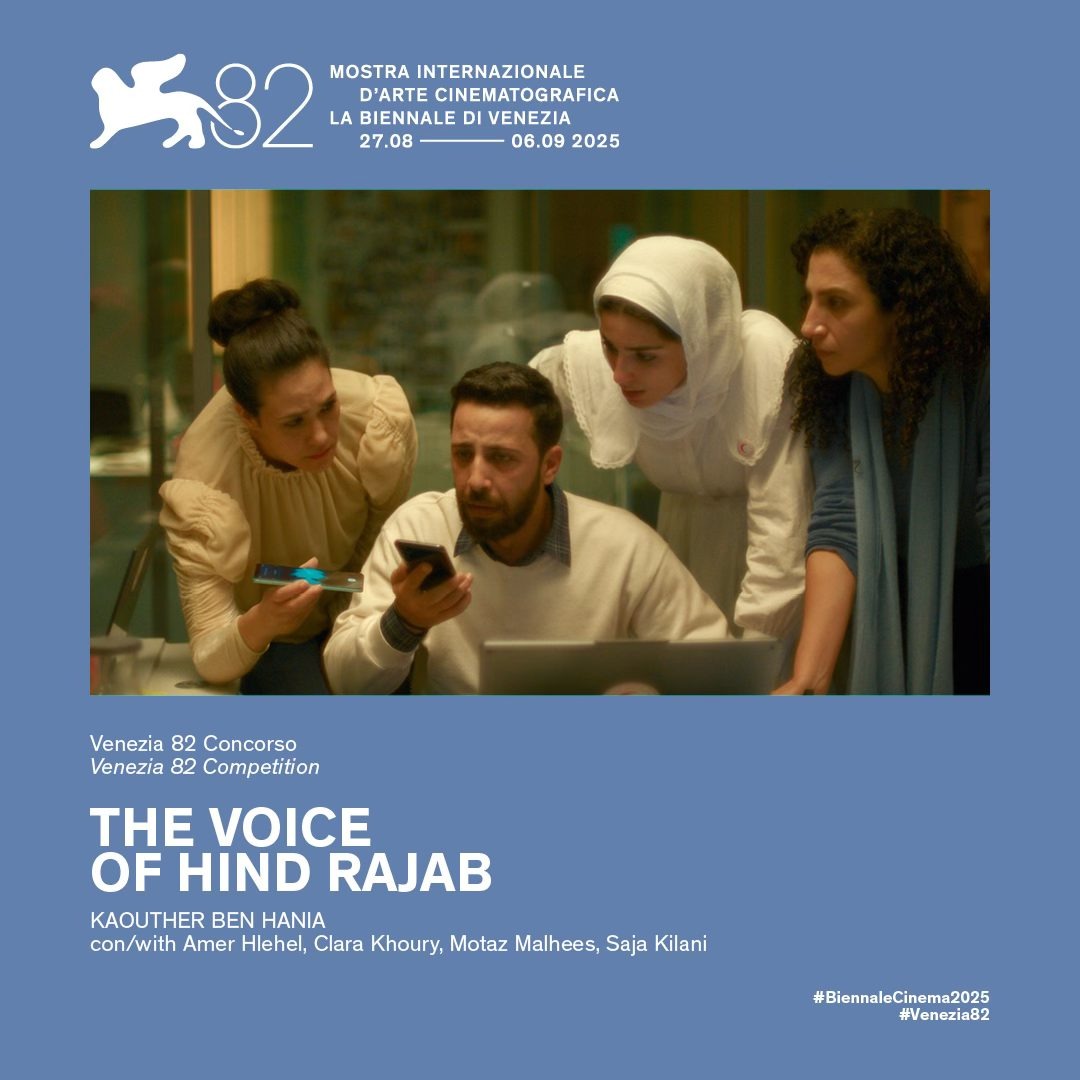












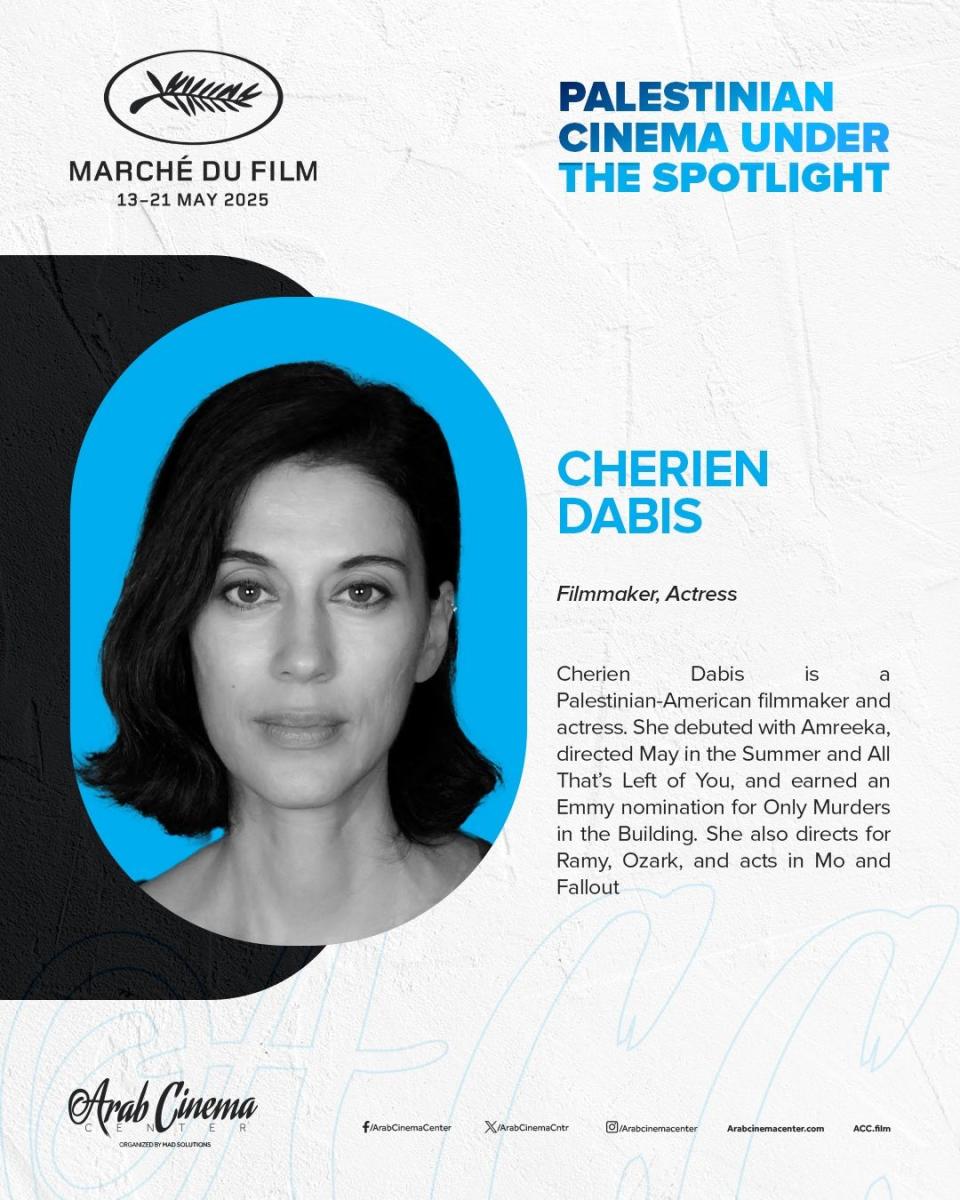

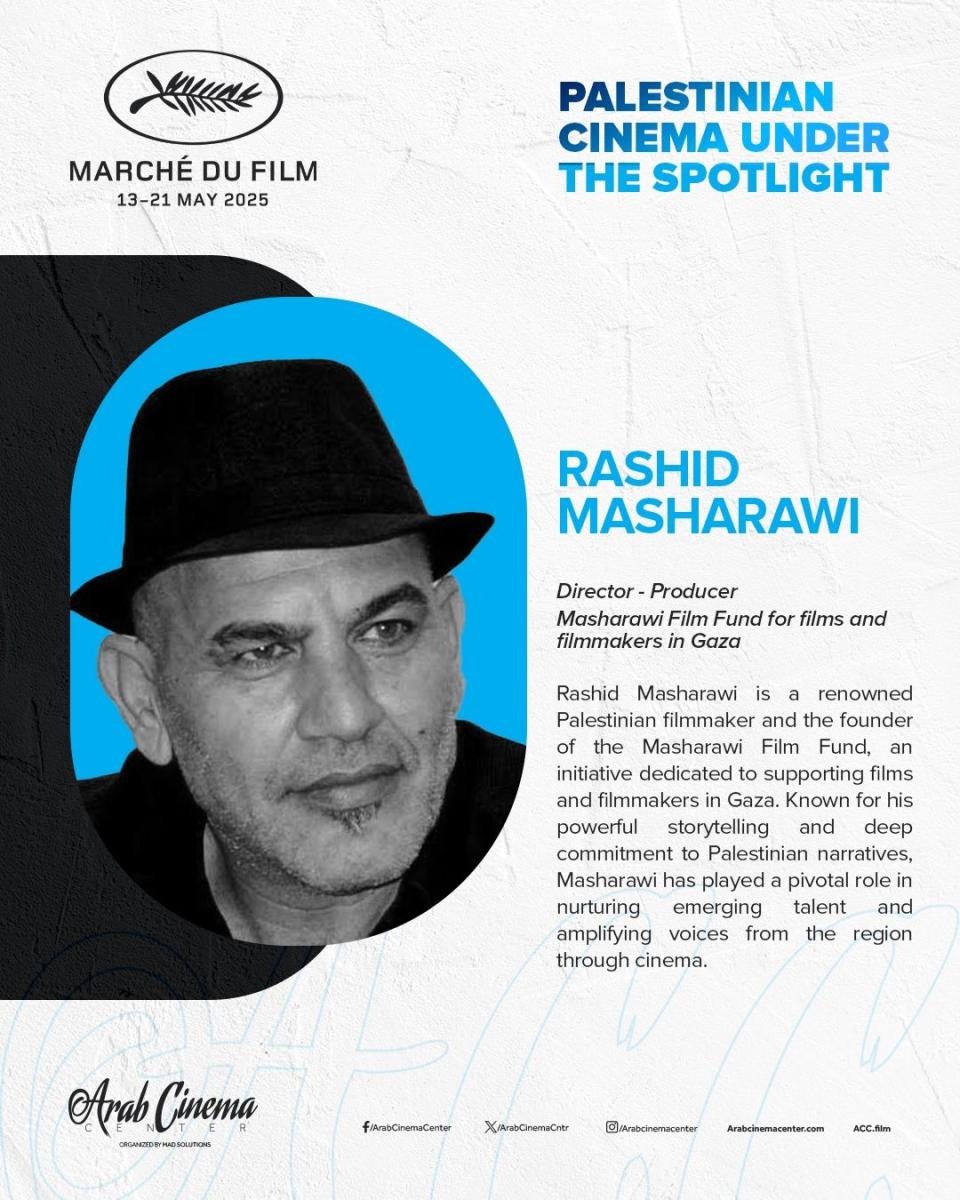

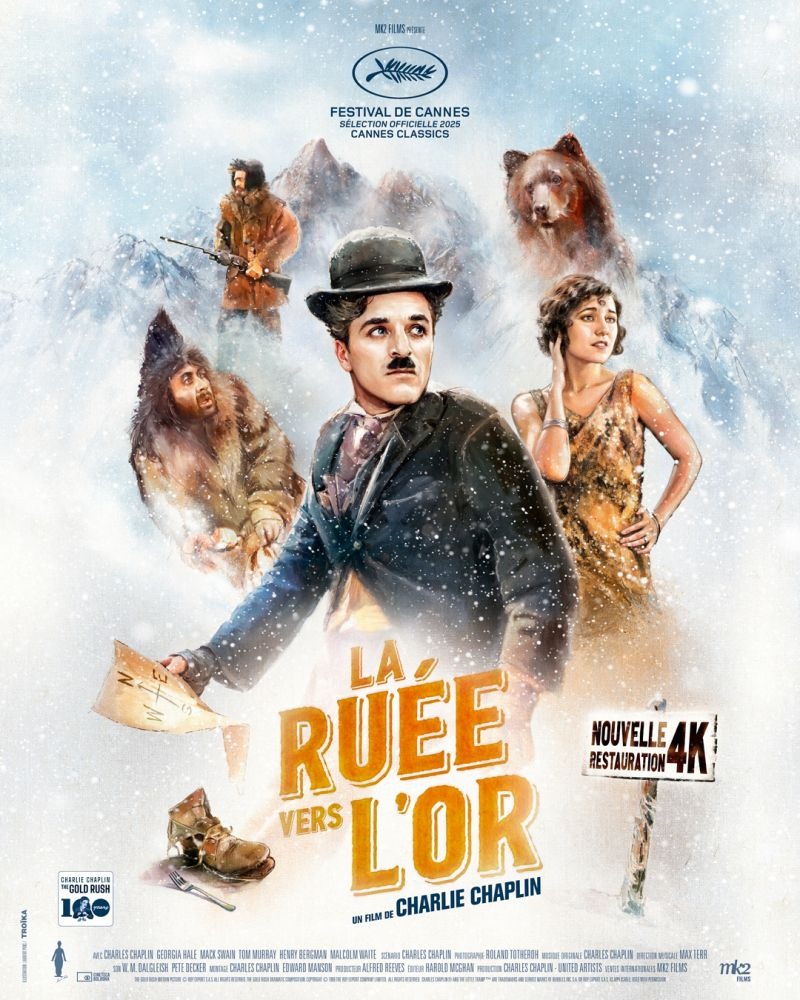
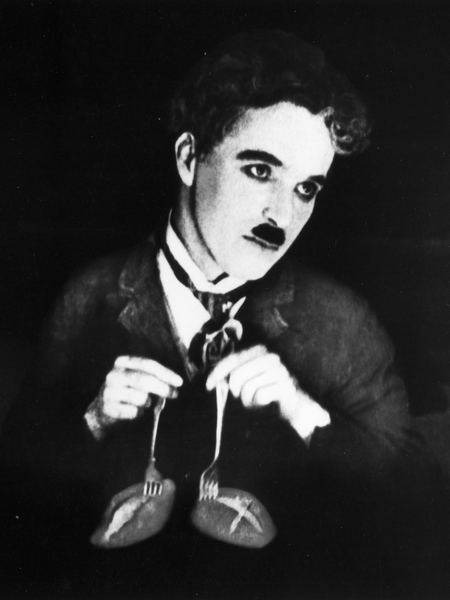
 Le festival international du court métrage Cinétoile revient dans une huitième édition du 24 au 29 août 2025. Ce nouveau rendez-vous cinématographique se déroulera au site archéologique Néapolis, au fort de Hammamet et au Centre culturel Néapolis à Nabeul (Cap Bon).
Le festival international du court métrage Cinétoile revient dans une huitième édition du 24 au 29 août 2025. Ce nouveau rendez-vous cinématographique se déroulera au site archéologique Néapolis, au fort de Hammamet et au Centre culturel Néapolis à Nabeul (Cap Bon). Le comité directeur de la 38ème édition du Festival international du film amateur de Kelibia (FIFAK) a annoncé, sur la page officielle du festival, le report de l’édition 2025, initialement prévue du 16 au 23 août, à une nouvelle période allant du 23 au 30 août.
Le comité directeur de la 38ème édition du Festival international du film amateur de Kelibia (FIFAK) a annoncé, sur la page officielle du festival, le report de l’édition 2025, initialement prévue du 16 au 23 août, à une nouvelle période allant du 23 au 30 août.