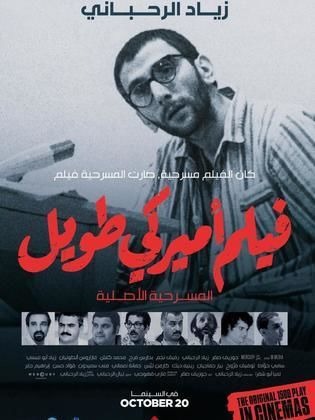Du théâtre militant aux grandes fresques musicales, il a donné une voix à la Tunisie et l’a proposée au monde. L’homme de scène s’en va, laissant derrière lui un héritage que nul ne pourra effacer.
La Presse — Le rideau s’est baissé sur une vie de création. Lundi 11 août 2025, Fadhel Jaziri s’est éteint à l’âge de 77 ans, laissant en deuil une partie de la mémoire culturelle tunisienne. Metteur en scène, auteur, réalisateur et producteur, il a traversé plus d’un demi-siècle d’art en bâtissant des ponts entre les époques, les genres et les publics. Du théâtre militant aux grandes fresques musicales, du cinéma à la redécouverte des traditions populaires, il a façonné un univers où la Tunisie se raconte à elle-même et au monde.
Le dernier acte
Même son départ a porté la signature de l’artiste. Jaziri avait pensé son enterrement comme une véritable mise en scène : il avait demandé à ceux qui l’accompagneraient au cimetière de s’habiller en blanc. Ce jour-là, les femmes étaient présentes, toutes vêtues de blanc, pour lui dire adieu. Un geste fort, à la fois esthétique et symbolique, qui bousculait les codes funéraires habituels.
Il n’a pas fallu longtemps pour que les esprits chagrins s’emparent de l’image, reprochant la présence des femmes au cimetière, sous prétexte que la tradition les en éloigne. C’est oublier que cette interdiction n’est pas absolue, et que les habitudes sociales comme les pratiques religieuses évoluent avec le temps. D’ordinaire, certaines femmes attendent le « sbeh al kbar » — le matin qui suit l’enterrement — pour se recueillir. Ce jour-là, elles ont simplement avancé le rendez-vous, parce que l’instant d’adieu ne pouvait attendre.
Ce dernier tableau, voulu par l’artiste, dit tout de son regard sur la vie et sur l’art : c’est briser les convenances quand elles deviennent de simples carcans, et rappeler que l’essentiel ne réside pas dans les formes extérieures, mais dans ce qui reste dans l’âme.
Les débuts d’un enfant de Tunis
Né en 1949 dans la médina de Tunis, il découvre le théâtre très jeune au Collège Sadiki. Très vite, l’art devient plus qu’une passion mais une promesse faite à lui-même. Ses études le mènent à Londres puis à Paris, où il s’imprègne des expériences artistiques les plus audacieuses de son époque. Mais c’est en Tunisie qu’il veut bâtir.
En 1971, il lance le Festival de la Médina, puis cofonde le Théâtre du Sud de Gafsa. Là, au contact de publics éloignés de la capitale, il comprend que l’art n’a de sens que s’il franchit les frontières sociales et géographiques. Cette démarche, adoptée dès ses débuts, contredit frontalement les critiques de ses adversaires de toujours, qui lui reprochaient ses origines – fils de la médina, enfant du vieux Tunis « beldi ». Pourtant, l’artiste engagé n’a jamais été enfermé dans les cercles clos de la capitale; il a porté l’art là où on ne l’attendait pas. Sa trajectoire contredit sans équivoque ces accusations. Il a formé et accompagné des jeunes venus de toutes les régions, ouvert des scènes à ceux qui n’y auraient jamais accédé, et contribué à la décentralisation culturelle bien avant que le terme ne devienne un mot d’ordre officiel.
Hadhra, la mémoire en musique
Homme de théâtre et de cinéma, le visionnaire culturel change d’échelle et se lance dans de vastes fresques musicales. Nouba (1991) est un vibrant hommage à la musique populaire tunisienne, et Hadhra (1993) l’inscrit définitivement dans l’histoire culturelle du pays. Ce voyage hypnotique au cœur des chants soufis tunisiens devient un chef-d’œuvre intemporel, joué et rejoué pendant plusieurs décennies à l’intérieur et à l’extérieur.
Ses autres créations — Nujum, Mezoued, Ezzaza, Hob Zamen, Mahfel — prolongent cette volonté obstinée : faire dialoguer tradition et modernité, sans jamais trahir ni l’une ni l’autre. Et si aujourd’hui les scènes tunisiennes voient fleurir une multitude de spectacles autour du mezoued ou de la musique soufie, il faut rappeler que leur véritable père fondateur reste Fadhel Jaziri qui a façonné ces œuvres.
Il a ouvert la voie en magnifiant ce patrimoine, en le portant sur les grandes scènes et en y insufflant une mise en scène audacieuse. Il a convoqué la danse contemporaine, osant marier gestes modernes et tenues traditionnelles. On se souvient de ces jeunes, drapés de burnous, de jebbas, ou de kachabia, dansant sur une soulamia transcendée, où chaque mouvement semblait porter la mémoire d’un peuple. Chez lui, le folklore n’était jamais figé, il devenait matière vivante, réinventée à chaque représentation.
À Carthage, le défi de la mise en scène
Cette capacité à transformer le patrimoine en expérience vivante, à marier tradition et modernité, reste la marque de son génie – un contraste saisissant avec les représentations contemporaines que l’on peut observer aujourd’hui, comme lors de la soirée du 11 août 2025 à l’amphithéâtre romain de Carthage.
L’amphithéâtre a vibré au rythme des cultures venues des quatre coins du monde. Dans le cadre du spectacle Ballets folkloriques du monde, l’entrée de la troupe tunisienne des Twayef de Ghbonten a été saluée par des applaudissements nourris et des youyous, sur les premières notes de « Jinek ye Carthage ». Ce groupe de poètes-chanteurs, inscrit depuis 2024 sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l’Unesco, a présenté un morceau de la richesse culturelle tunisienne. Pour autant, si les autres pays participants ont proposé des tableaux chorégraphiques précis, mêlant costumes traditionnels et danses typiques, la prestation tunisienne, sans dévaluer sa valeur intrinsèque, n’était pas adaptée aux circonstances ni au support qu’offre le théâtre de Carthage. Un groupe d’hommes chantait sans que le public puisse toujours saisir les paroles, et agitait des sortes de foulards, créant un contraste avec l’exigence scénique attendue sur une scène aussi prestigieuse.
L’homme qui a transformé la scène tunisienne avait toujours su adapter ses créations à chaque support : chorégraphie, costumes, scénographie et visuel étaient pensés comme un tout, en parfaite harmonie avec l’espace scénique et les spectateurs. La culture, vaste et complexe, exige une vision transversale embrassant toutes les expressions artistiques et culturelles, et non pas une seule discipline étroite. Elle requiert un goût raffiné et la capacité de transformer cette vision en expérience tangible. Réduire ce secteur à la seule portée d’un instrument, aussi noble soit-il, c’est risquer de jouer toujours la même note, alors que la culture a besoin d’un orchestre entier. Sans ces ingrédients, on navigue à vue, et même le patrimoine le plus précieux peut perdre de sa force, comme ce fut le cas dans ce spectacle du 11 août, véritable contretemps artistique, au regard de la richesse patrimoniale et du savoir-faire scénique que la Tunisie détient, mais aussi face à la qualité des prestations présentées par les autres pays invités.
Héritage et responsabilité
Aujourd’hui, ceux qui montent sur scène portent en eux, qu’ils le sachent ou non, un fragment de cet héritage. L’artiste engagé a prouvé qu’un art pouvait être à la fois populaire et exigeant, enraciné dans ses terres et ouvert aux vents du monde.
Il a montré que la Tunisie pouvait se raconter dans sa langue, dans ses gestes, dans ses sons, sans filtre ni traduction, et que cette voix pouvait résonner bien au-delà de ses frontières. Ceux qui créent aujourd’hui ne partent pas d’une page blanche. Ils avancent sur un socle que Fadhel Jaziri a patiemment bâti – un socle de mémoire, d’audace et de fidélité aux racines. Leur mission n’est pas de répéter ses œuvres, mais de les dépasser, d’oser à leur tour, de surprendre comme il a su surprendre.
L’inspirateur des générations d’artistes s’en est allé, mais il ne laisse pas un vide. Il laisse un mouvement. Un élan qu’il appartient désormais à toute une génération de prolonger, de nourrir, de porter plus loin encore. Car créer, c’est ce qu’il a toujours fait. Et c’est ainsi qu’il continuera de vivre à travers ceux qui auront le courage de reprendre le flambeau.
Parmi les leçons que nous laisse cet architecte de la culture, il y a celle-ci : la culture est aussi cruciale que le développement économique. Lui qui, un temps, avait adhéré à un parti politique avant de s’en détourner, déçu, savait que bâtir une société solide passe par la transmission et l’épanouissement artistique. Décentraliser les arts, introduire les matières artistiques dès le plus jeune âge dans les programmes scolaires, ne pas se contenter d’une heure hebdomadaire aléatoire, tels étaient ses combats silencieux mais déterminants.
Inclure les jeunes dans des activités culturelles, c’est leur offrir un espace d’expression, les protéger de la radicalisation, leur transmettre le goût du patrimoine et de l’identité collective. Dans un pays déjà riche de mosquées et d’institutions religieuses, le cap doit désormais être mis sur les centres culturels, les maisons des jeunes et les événements culturels, été comme hiver, pour que l’art irrigue toute la société et prépare les générations futures à créer, à rêver, et à aimer la culture et la vie plutôt que de céder à la colère, à la haine et à la culture de la mort.