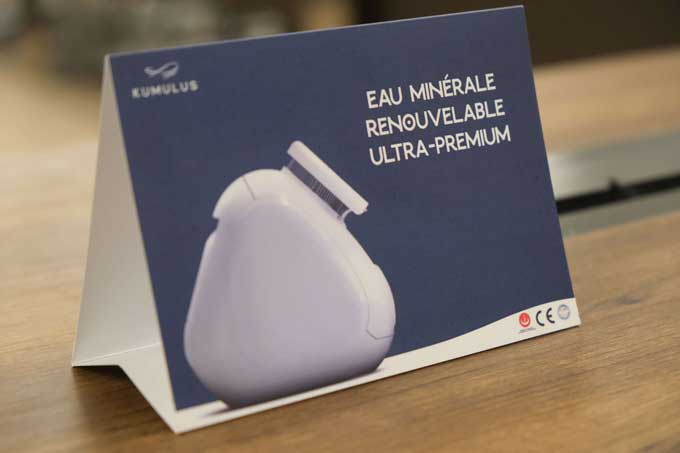Gouvernance : La filiation, le mal qui gangrène le secteur public

La filiation dans l’administration et en entreprise, tendance à se faire succéder automatiquement par un membre de la famille après la retraite ou en cas d’invalidité, serait, selon des observateurs, l’une des entraves majeures à la création de richesses en Tunisie. Ce phénomène freinerait la croissance et perpétuerait des fragilités structurelles telles que les disparités régionales, la pauvreté multidimensionnelle et l’inégalité des chances.
Origines historiques et cadre sociopolitique
Utilisé abusivement depuis l’indépendance par dirigeants et chefs d’entreprises, ce mécanisme — héritage de l’époque makhzenienne ottomane — leur a permis de contrôler le recrutement dans les secteurs public et privé. En l’absence d’État de droit fort et de contre-pouvoirs crédibles, les décideurs, issus de régimes autoritaires, ont massivement recruté des proches. Le tribalisme professionnel et entrepreneurial a ainsi remplacé le tribalisme primaire que Bourguiba voulait combattre.
Tolérance dans le privé, inacceptabilité dans le public
Si la filiation peut se comprendre dans le privé — un chef d’entreprise « family friendly » relayé par ses enfants ou son épouse —, elle est inacceptable dans le secteur public, financé par l’argent des contribuables. Depuis l’indépendance, le pouvoir politique a été mobilisé au profit de certaines castes et régions.
Ampleur et pratiques sectorielles
Aujourd’hui, dans presque tous les secteurs, les jeunes cadres et ouvriers accèdent aux postes grâce à des liens familiaux avec des responsables influents. Le phénomène touche aussi les universités et le corps médical, où l’on retrouve souvent des familles entières dans une même spécialité. Parfois, la filiation bénéficie d’arrangements légaux, conclus avec la complicité de l’UGTT, permettant l’embauche sans concours dans des secteurs comme les banques, l’énergie, les mines ou les établissements publics. Les institutions les plus rémunératrices — Banques, Compagnie des phosphates de Gafsa, Groupe chimique, ETAP, SNDP, STEG… — sont particulièrement concernées.
Impact sur les disparités régionales
La généralisation de la filiation, en toute impunité, a accentué les inégalités entre régions côtières et intérieures. L’indice de développement régional 2025 montre des écarts marqués entre gouvernorats côtiers comme Tunis, Monastir, Ben Arous et Sousse, et régions comme Kasserine, Kairouan, Jendouba et Sidi Bouzid. Ces disparités avaient déjà alimenté les révoltes de 2010–2011.
Transparence et digitalisation : progrès et limites
Depuis, la digitalisation et une volonté politique relative ont permis des avancées, mais les effets restent limités. Des affaires récentes montrent que les fuites aux concours et le copinage persistent, y compris sous la présidence de Kaïs Saïed.
Exemples récents
– Concours des inspecteurs du ministère de l’Éducation : allégations de fuites d’épreuves avant examen, entraînant enquêtes et réactions syndicales.
– Affaire Mohamed Abidi : un bachelier de 18/20 orienté vers une filière non demandée, privant l’accès aux facultés de médecine et de pharmacie. Le problème a été corrigé après médiatisation.
Pratiques sous régimes passés
Sous Bourguiba, Ben Ali et les islamistes, l’orientation universitaire était influencée par l’origine sociale et familiale. Abid Briki a révélé que sous Ben Ali, des enfants de syndicalistes entraient en médecine avec 10/20 de moyenne.
Conséquences économiques
Pour les économistes, la filiation dégrade les performances administratives et entrepreneuriales, plaçant parfois des personnes non qualifiées à des postes stratégiques.
La filiation existe ailleurs mais reste exacerbée en Tunisie. Sa persistance menace la stabilité et appelle des mesures législatives sévères. L’idéal serait une réforme en profondeur de l’État, avec un véritable État de droit, contrôlé par des contre-pouvoirs forts: justice indépendante, syndicats libres, presse libre, parlement légitime.
Abou SARRA
EN BREF
- Pratique : La filiation consiste à faire succéder un proche dans l’administration ou l’entreprise.
- Origine : Héritage de l’époque ottomane, renforcé depuis l’indépendance.
- Impact : Freine la croissance, aggrave les inégalités régionales et sociales.
- Secteurs concernés : Administration, entreprises publiques, universités, corps médical.
- Actualité : Malgré la digitalisation, des affaires récentes révèlent fuites aux concours et copinage persistants.
L’article Gouvernance : La filiation, le mal qui gangrène le secteur public est apparu en premier sur WMC.
 Logiquement, quelle que soit l’issue du bras de fer qui oppose actuellement l’exécutif et l’UGTT, on doit s’attendre, tôt ou tard, à de profonds changements en matière de représentation syndicale des travailleurs. Certains observateurs de la chose tunisienne estiment qu’au regard de la dégradation avancée des rapports entre le régime politique en place et l’UGTT d’une part, et de la défiance criante qui prévaut entre la centrale syndicale et le commun des usagers des services publics (santé, éducation, transport…), d’autre part, le moment semble plus que jamais propice pour refonder le syndicalisme tunisien sur de nouvelles bases mieux adaptées à la réalité socio-économique du pays.
Logiquement, quelle que soit l’issue du bras de fer qui oppose actuellement l’exécutif et l’UGTT, on doit s’attendre, tôt ou tard, à de profonds changements en matière de représentation syndicale des travailleurs. Certains observateurs de la chose tunisienne estiment qu’au regard de la dégradation avancée des rapports entre le régime politique en place et l’UGTT d’une part, et de la défiance criante qui prévaut entre la centrale syndicale et le commun des usagers des services publics (santé, éducation, transport…), d’autre part, le moment semble plus que jamais propice pour refonder le syndicalisme tunisien sur de nouvelles bases mieux adaptées à la réalité socio-économique du pays. Abstraction faite du traumatisme qu’elle a occasionné aux usagers du transport public et à l’ensemble des Tunisiens, la grève générale du transport déclenchée par la Fédération générale du transport relevant de l’UGTT et observée trois jours durant en pleine canicule (30, 31 juillet et 1er août 2025) a été fort instructive sur la gravissime conception que se fait la centrale syndicale actuelle du syndicalisme.
Abstraction faite du traumatisme qu’elle a occasionné aux usagers du transport public et à l’ensemble des Tunisiens, la grève générale du transport déclenchée par la Fédération générale du transport relevant de l’UGTT et observée trois jours durant en pleine canicule (30, 31 juillet et 1er août 2025) a été fort instructive sur la gravissime conception que se fait la centrale syndicale actuelle du syndicalisme. C’est visible, on n’a pas besoin d’un dessin pour le constater : une vive tension règne, actuellement, entre l’exécutif et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). Les frictions entre les deux parties, générées, semble-t-il, par la reprise des grèves et leur corollaire, le blocage d’importants secteurs du pays, ne cessent de se multiplier et de s’accentuer. Au regard de la gravité des accusations échangées, nous pensons qu’à l’horizon, une rupture probable et définitive est en train d’être concoctée entre le gouvernement et l’actuelle direction de la centrale syndicale.
C’est visible, on n’a pas besoin d’un dessin pour le constater : une vive tension règne, actuellement, entre l’exécutif et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). Les frictions entre les deux parties, générées, semble-t-il, par la reprise des grèves et leur corollaire, le blocage d’importants secteurs du pays, ne cessent de se multiplier et de s’accentuer. Au regard de la gravité des accusations échangées, nous pensons qu’à l’horizon, une rupture probable et définitive est en train d’être concoctée entre le gouvernement et l’actuelle direction de la centrale syndicale. En l’absence de stratégies dynamiques et crédibles pour aider les Tunisiens à s’adapter au dérèglement climatique auquel la Tunisie est sérieusement exposée, des ONG s’emploient, par de petites initiatives, à alerter sur l’enjeu de s’y préparer. Il s’agit, particulièrement, d’intensifier la formation des ressources humaines dans les métiers verts ou verdissants.
En l’absence de stratégies dynamiques et crédibles pour aider les Tunisiens à s’adapter au dérèglement climatique auquel la Tunisie est sérieusement exposée, des ONG s’emploient, par de petites initiatives, à alerter sur l’enjeu de s’y préparer. Il s’agit, particulièrement, d’intensifier la formation des ressources humaines dans les métiers verts ou verdissants. L’évènement parlementaire a été, ces derniers jours, le rejet, le 21 juillet 2025, par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) d’une proposition législative portant amnistie générale pour le délit d’émission de chèques sans provision.
L’évènement parlementaire a été, ces derniers jours, le rejet, le 21 juillet 2025, par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) d’une proposition législative portant amnistie générale pour le délit d’émission de chèques sans provision.