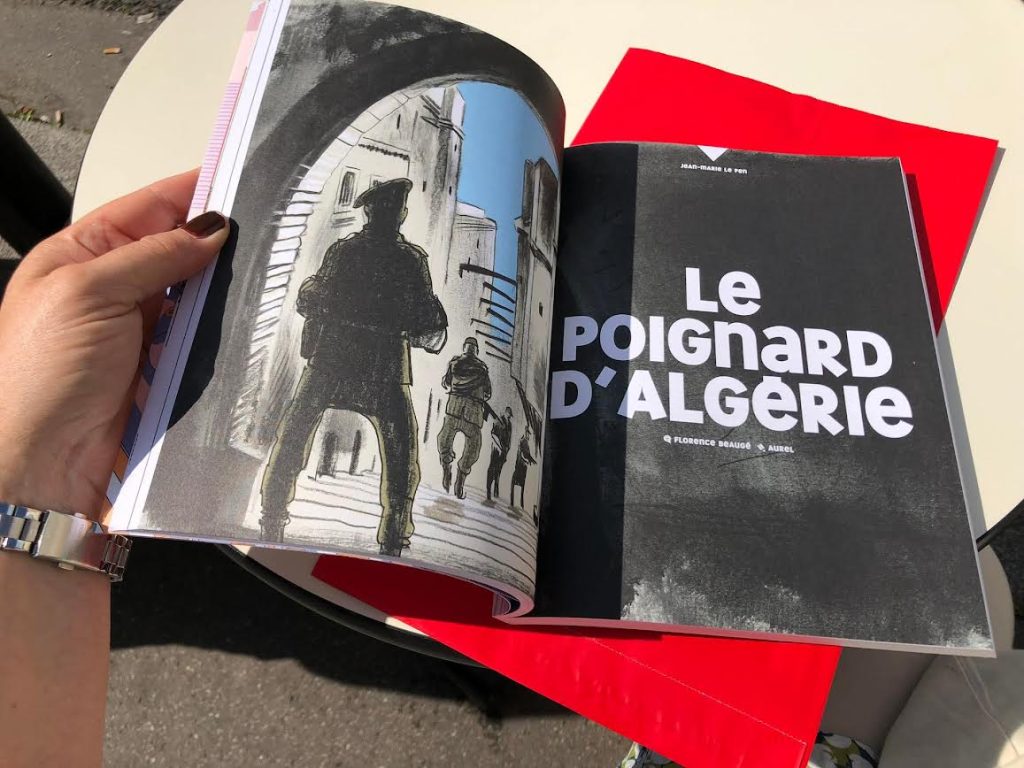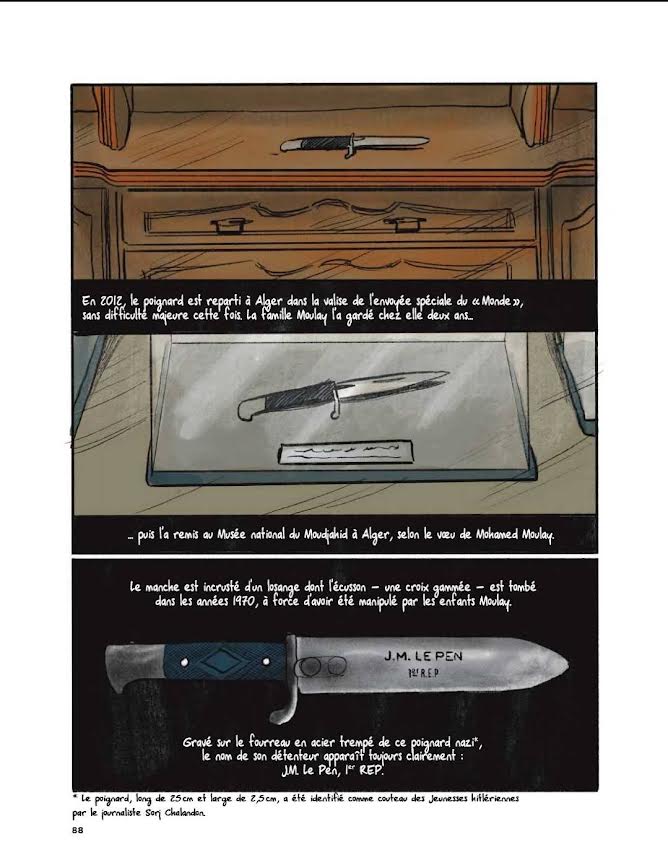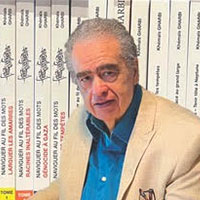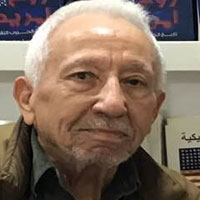Hassen Chalghoumi est un véritable «miracle républicain» français, qu’on croirait droit sorti des manuels scolaires coloniaux pour enseigner le français dans les écoles en Afrique du Nord, la célèbre série des «Bonjour Ali, bonjour Fatima». Un miracle caricatural, pour incarner le rôle de missié Islam de France des médias, la voix autorisée pour tout ce qui touche de près ou de loin à cette religion, surtout quand il s’agit de pourfendre les manifestations de soutien aux Palestiniens.
Sadok Chikhaoui *
Surnommé «l’imam des Lumières», sans doute parce qu’il brille surtout par son absence de pensée, et l’exposition excessive aux sunlights, il s’exprime, s’embrouille, éructe dans un français à faire pâlir tous les comiques, pour rassurer l’opinion et incarner l’islam inoffensif, qui est le sien, compatible avec le récit pro-israélien dominant des médias mainstream. Il incarne à merveille l’image rêvée du «bon musulman» ou plutôt du «bon Arabe», dans son acception la plus coloniale : docile, obséquieux, ânonnant un discours appris, incapable d’articuler une pensée théologique ou politique un tant soit peu construite.
Son apparition sur France Culture, le 15 janvier 2021, dans une émission consacrée à Averroès, aux côtés du philosophe Mohamed Ali Hamadi, universitaire reconnu, fut un sommet d’absurde : Chalghoumi semblait ignorer jusqu’à l’existence d’Averroès, qu’il confondait avec un autre. On aurait cru voir Cyril Hanouna disserter sur Spinoza ou un joueur de pipeau commenter un requiem de Mozart.
Une posture creuse, dictée par le besoin de plaire
Bien sûr, chacun a le droit de s’exprimer, y compris sur des sujets complexes. Un joueur de pipeau peut ressentir un requiem de Mozart, un apprenti cuisinier peut trouver fade un plat de grand chef. Mais ce droit à l’opinion n’exonère pas d’un minimum de compétence, de sincérité, et d’effort de compréhension.
Mais le problème surgit quand l’opinion n’est qu’une posture creuse, dictée par l’intérêt, le besoin de plaire, ou l’instrumentalisation politique sciemment assumée. On ne reproche pas à Chalghoumi d’avoir un avis, mais d’être sans rigueur, sans fond, sans légitimité intellectuelle ou théologique, imposé par un coup de force des médias politiquement orientés, comme une figure représentative de la communauté musulmane en France.
Que l’animatrice Adèle Van Reeth l’ait invité dans une émission sur Averroès soulève une question : ignorait-elle qui est Averroès, malgré son agrégation de philosophie ? Ou ignorait-elle à ce point le niveau de son invité ? Dans les deux cas, c’est inquiétant pour France Culture, pour la République, pour la vérité.
Et pourtant, Chalghoumi est partout : cérémonies officielles, débats sur la laïcité, «vivre ensemble» et autres vitrines républicaines. Autoproclamé imam de Drancy, sans formation théologique reconnue, ni en France ni ailleurs, il s’exprime sur des textes qu’il est censé incarner… et qu’il ne connaît pas.
Peu importe. Il joue à merveille le rôle de «musulman de service» qu’on lui a assigné et qu’il assume avec zèle. Ce rôle, il le joue bien, reconnaissons-lui ça cette compétence.
Le plus grave n’est pas qu’il ridiculise les musulmans. C’est qu’il efface toute la richesse intellectuelle et spirituelle de l’islam. Il recouvre d’un écran de fumée des décennies de travail exigeant mené par des penseurs musulmans ou non qui cherchent à penser l’islam dans sa profondeur et sa complexité son historicité et son adaptation à son temps.
Où sont les Mohammed Arkoun, Abdelwahab Meddeb, Rachid Benzine, Souleymane Bachir Diagne, Fouzia Charfi, Mohamed Bajrafil, Faouzi Bédoui, Reza Shah-Kazemi, Tareq Oubrou ? Invisibles. On ne leur demande pas d’être justes, on leur demande d’être utiles. Chalghoumi, lui, est utile à l’ordre établi.
Un soutien inconditionnel à Israël
Dernier épisode en date : lors d’un récent voyage en Israël, Chalghoumi a tenté d’embrasser la main d’un ministre israélien, qui l’a aussitôt retirée. Geste de soumission ou de confusion ? L’image condense tout ce que ce personnage incarne : une servilité théâtrale, embarrassante même pour ceux qu’elle prétend flatter.
En le promouvant, ce n’est pas seulement l’islam qu’on caricature. C’est l’intelligence qu’on insulte, la République qu’on trahit préférant la médiocrité rassurante à la pensée exigeante.
Né en 1972 en Tunisie, arrivé sans-papiers à la fin des années 1990, il affirme avoir été formé à Damas et à Lahore, sans que son parcours soit vérifiable. Il s’installe à Drancy, puis se rapproche de cercles politiques et communautaires. Rapidement surnommé «l’imam du Crif» **, il fréquente régulièrement ses dîners, affiche un soutien inconditionnel à Israël, condamne les mobilisations propalestiniennes, devenant ainsi un invité idéal pour les médias en quête d’un islam compatible.
Protégé, mis en scène, présenté comme courageux grâce à son escorte sécuritaire, Chalghoumi incarne une figure construite pour marginaliser les voix critiques, éteindre la diversité intellectuelle de l’islam, et étouffer tout discours musulman libre et autonome.
Ce n’est pas seulement une imposture individuelle. C’est le symptôme d’un système qui préfère la caricature au savoir, l’allégeance à la pensée. Ce n’est pas un malaise religieux, c’est un projet politique, qui ne cherche pas à promouvoir un islam républicain par l’intelligence, mais à neutraliser l’exigence de justice, surtout lorsqu’il rappelle que la Palestine n’est pas un détail.
*Enseignant.
** Conseil représentatif des institutions juives de France, une sorte de lobby sioniste pro-israélien en France.
L’article Hassen Chalghoumi | Imposture médiatique au service de manipulations politiques est apparu en premier sur Kapitalis.