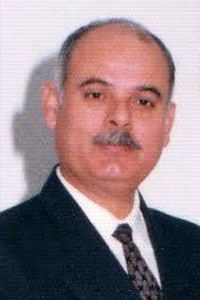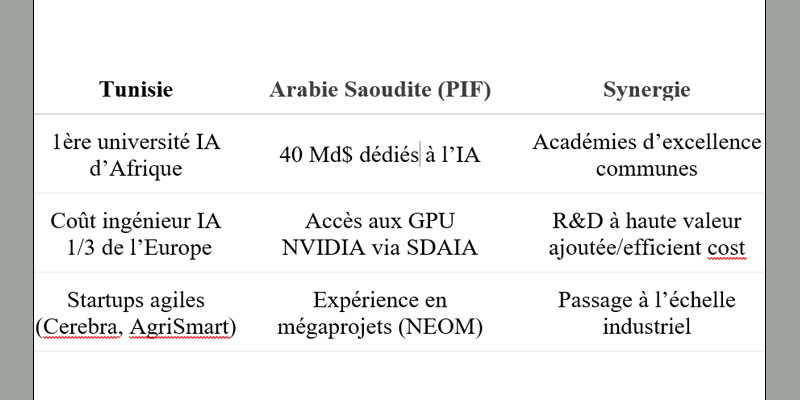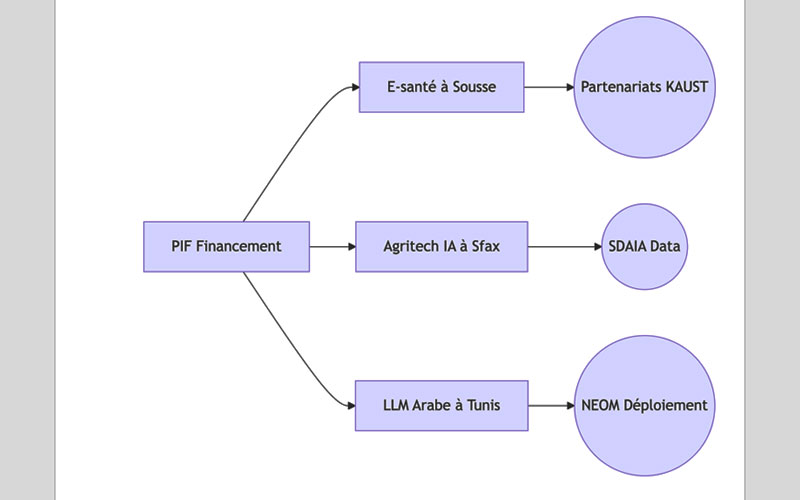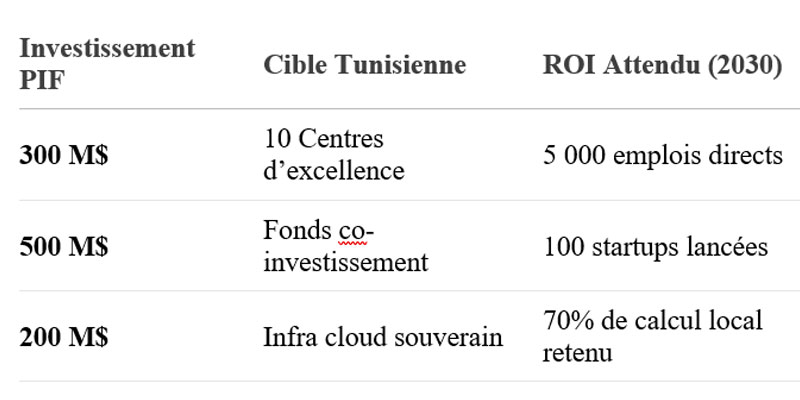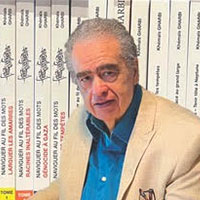Récit de voyage en Tunisie d’un Marocain curieux
L’auteur, spécialiste marocain du tourisme, raconte dans le post Facebook que nous reproduisons ci-dessous, sa découverte d’une Tunisie accueillante, hospitalière et résiliente. Ainsi que la joie de vivre des Tunisiens, «un peuple travailleur qui connaît la valeur de l’effort et l’éducation qui doit impérativement aller avec.» En lisant son récit de voyage, nous nous sommes rappelés du célèbre adage «Quand je me regarde je me désole, quand je me compare je me console». (Photos Rachid Boufous).
Rachid Boufous

Je suis parti en Tunisie il y a un mois à l’invitation d’amis tunisiens. C’était la première fois que je mettais les pieds au pays de Hannibal, Bourguiba et de la Harissa. J’ai eu envie de partager ce périple avec vous, car ce voyage ne m’a pas laissé indifférent. En voici les impressions et le ressenti…
En ce jour béni, je prends ma voiture vers 11h et me dirige vers l’aéroport Mohammed V de Casablanca d’où je dois prendre l’avion vers Tunis aux alentours de 14h. L’aérogare de Casablanca a sévèrement besoin d’être mis à niveau. Le hall est toujours aussi désert. Une odeur d’égouts te prend à la gorge dès l’entrée. Encore des regards d’assainissement mal siphonnés.
La zone internationale a été soignée par contre. Les toilettes aussi. Pour une fois on peut pisser sans que ça sente la rose pourrie… toutefois pour prendre l’avion nous sommes obligés de prendre un bus, les couloirs télescopiques sont réservés à des vols plus «prestigieux» pourquoi donc autant d’investissements pour rien…!
L’aéroport de Tunis est beau mais vieux
Le vol se passe bien. L’avion est complet. Il dure 2h30. Il peut durer moins mais les c… d’Algérie ont décidé de nous emmerder en nous interdisant le survol de leur espace aérien. Pas grave, nos pilotes rattrapent le retard dans le ciel même s’ils sont obligés de traverser une partie de l’Espagne, de la France et de l’Italie. Nous arrivons s à l’heure à Tunis.
Les files sont fluides, la policière me demande tout de même le nom de mon père. À quoi bon ? Le mien de pater il a 85 ans et je ne pense pas que la policière tunisienne lui plaise, vu que c’est un laideron, je connais ses goûts quand même…!
L’aéroport de Tunis est beau mais vieux. Le hall est plein à craquer des gens qui attendent leurs familles.
Je retrouve mon ami Hannibal qui m’attend à la sortie. Il me fait le tour de la côte tunisienne avant de m’emmener m’installer à Gammarth, la station chic de Tunisie. L’autoroute est très bien.
Tunis a besoin d’une bonne mise à niveau urbaine, mais elle reste propre.


Les Tunisiens savent ce qu’est le tourisme
Durant mon séjour j’ai visité plusieurs hôtels. Des 4 et 5 étoiles. 5 au total : 2 hôtels 5* et 3 hôtels 4*, et je peux dire sans exhaustive et juste ce que j’ai vu à Gammarth, à Hammamet, La Marsa et à Tunis, trois villes différentes, nous sommes très loin au Maroc d’atteindre le niveau de services offert en Tunisie en matière d’hôtellerie et de tourisme.
Malgré nos 17 millions de touristes, nous n’arrivons pas au niveau des Tunisiens, malgré leurs problèmes économiques et politiques. Ils n’auraient pas les problèmes conjoncturels actuels, je vous jure qu’ils nous dépasseraient allègrement.
Les Tunisiens savent ce qu’est le tourisme. Ils ont très bien compris ce qu’il faut faire pour accueillir le touriste, vip ou de masse.
D’abord la propreté des chambres, des espaces, des plages et des restaurants. Ensuite le service, impeccable et ne nécessitant pas des armées de gens qui ne savent pas faire grand-chose comme chez nous. Il faut venir en Tunisie pour comprendre, que nous faisons fausse route en matière de tourisme au Maroc.
Chez nous on accueille des millions de touristes, en Tunisie ils les reçoivent au vrai sens du terme. Ça fait mal de dire cela car j’avais l’idée fausse que l’on recevait très bien au Maroc. Un grande fausse idée.
Les Tunisiens ont réussi l’éducation et la citoyenneté
Les Tunisiens ont réussi là où nous avons échoué : l’éducation et la citoyenneté. Sans cela on a beau inventer des concepts hôteliers, ça ne marchera pas. Les gens continueront à venir certes au Maroc, mais ils ne reviendront pas. Les leurres touristiques que sont Marrakech, Agadir ou Tanger ne doivent pas nous éloigner de la réalité touristique de notre pays.
Un exemple : la plage. Les hôtels ont des accès directs à la plage avec le respect des mises à distance réglementaire, mais vous ne voyez pas toute la faune qui vient lécher les espaces hôteliers. Pas de nanas de niqab, ni de vendeurs de glaces frelatés, ni de photographes à chameaux, ni de gilets jaunes, ni de locataires de parasols et de transats. Tu n’as pas de pollution visuelle qui vient te gâcher la vue ou l’environnement.
Je passe une bonne partie de ma vie dans les hôtels au Maroc dans le cadre de mon travail. Je suis habitué à loger dans des hôtels 4 et 5 étoiles et même moins, partout au Maroc en bord de mer, comme dans les villes intérieures. Je voyage aussi pas mal à l’étranger notamment en Europe. J’observe et je vois, mais je préfère comparer que ce qui est comparable. Le Maroc et la Tunisie sont comparables en matière de tourisme. On a démarré au même moment le développement touristique au milieu des années 60. À un moment, la Tunisie a fait le choix du tourisme de masse quand le Maroc a fait le choix du tourisme vip. Mais Djerba est similaire à Agadir en termes de tourisme de masse avec des séjours à bas prix pour clientèle de classes moyennes européennes. Les services et accueils y sont pareils. Mais là où nous avons «merdé» au Maroc c’est l’accueil des touristes vip en hôtels 5 étoiles.


Les Tunisiens nous donnent une grande leçon d’humilité
Comparativement, ce que j’ai vu en Tunisie, les hôtels 4 étoiles dépassent de très loin nos meilleurs hôtels 5 étoiles et je n’exagère pas. Il faut les visiter pour voir la différence criante entre nos deux pays. Les chambres sont propres, la clim est mise dans toutes chambres, le personnel est d’une gentillesse renversante, le service est impeccable au petit-déjeuner, le service de plage aussi. Tout se passe sans prise de tête et on n’a pas besoin de crier pour passer commande et on n’attend pas éternellement sa commande non plus. Et pourtant les Tunisiens ne sont pas satisfaits de leur niveau d’accueil en ce moment. Ils me parlent de l’époque de Ben Ali et de l’ambiance de fête qu’il y avait à l’époque. J’ose à peine croire qu’ils ont été meilleurs que maintenant, mais je les crois. Et puis j’ai découvert la joie de vivre des Tunisiens et surtout leur gentillesse. Pas de prise de tête, pas de m’as-tu-vu, pas de chichis, pas de hogra, et surtout pas de «pétage au-dessus du cul».
Les Tunisiens riches ne le montrent pas. Ils n’ont pas besoin. Ils ont la richesse du cœur et ça leur suffit. C’est l’avantage d’un peuple travailleur qui connaît la valeur de l’effort et l’éducation qui doit impérativement aller avec.
Une grande leçon d’humilité que celle que nous donnent les Tunisiens. Ils sont malheureux comme pas possible de ce qui leur arrive depuis la révolution de 2011. Ils ont beaucoup perdu, en dynamisme, en pouvoir d’achat, mais aussi en assurance. Ils sont loin les Tunisiens fiers de leurs réussites et qui pouvaient toiser tout le monde arabe du haut de leur performances sociales ou en matière de liberté des femmes. Ils n’en reviennent pas quand je leur dis que je suis ébloui par leur pays que je trouve merveilleux et qu’ils ont une chance inouïe d’être ce qu’ils sont à travers leur éducation et leur sens de la famille et des relations sociales.
La preuve : ma venue en Tunisie coïncide ce lundi avec une cérémonie à laquelle tiennent les Tunisiens : l’annonce des résultats du baccalauréat. Toutes les familles dont les enfants ont réussi au bac font des fêtes chez elles et c’est un ballet incessant de gens qui viennent féliciter les lauréats et surtout boire un verre en famille, à la bonne franquette et sans chichis. Comme plusieurs enfants de la bourgeoisie tunisienne ont réussi cette année, je suis invité à plusieurs soirées dans la même soirée. Et je peux vous dire que les Tunisiens savent recevoir et surtout faire la fête. On me présente des banquiers, des médecins et des ingénieurs. Plusieurs hommes d’affaires et d’industriels aussi. De vraies fortunes, pas des pique-assiettes comme chez nous. Des gars qui sont à la tête de véritables empires en Tunisie et ailleurs dans le monde, mais dont la modestie les ferait passer chez nous à des «nobody». Finalement je crois que c’est chez nous que les fortunes sont très surévaluées…
Tunisie, grâce à son peuple très résilient, redémarre doucement
La Tunisie a connu de terribles années depuis le «printemps arabe» qui a démarré justement par l’immolation d’un vendeur ambulant, le fameux Bouazizi. Un pays jadis prospère sous les dictatures de Bourguiba et de BenAli et qui a depuis, sombré dans une disette économique sévère, qui dure encore. Mais la Tunisie grâce à son peuple justement, très résilient, redémarre doucement, même si beaucoup de cerveaux tunisiens brillants migrent de plus en plus, vers le pays qui leur parle le plus : le Maroc. C’est un drame pour la Tunisie qui n’arrive pas à retenir ses meilleurs talents, c’est une très grande opportunité pour le Maroc. Mais au-delà de tout ce qui se passe en Tunisie, le Maroc ne doit pas abandonner nos frères tunisiens. On se doit d’aider ce pays que l’on aime et qui nous aime depuis toujours. À commencer par la nomination d’un grand ambassadeur. Le dernier en date, Tarik n’a pas beaucoup brillé. Il faut dire qu’il n’avait aucune expérience diplomatique et qu’il s’était contenté d’exister au sein de l’USFP, pas vraiment le gabarit adéquat pour un pays aussi sensible que la Tunisie…
En ce moment précisément on ne doit pas abandonner la Tunisie, malgré toutes les déclarations de son président ou de sa proximité toxique avec l’Algérie…
Quant à mes amis tunisiens je les ai convaincus de venir investir dans l’hôtellerie au Maroc, on y a grandement besoin d’entrepreneurs, d’où qu’ils viennent, et surtout de notre chère Tunisie…
L’article Récit de voyage en Tunisie d’un Marocain curieux est apparu en premier sur Kapitalis.