LA CONTROVERSE – La Science économique en état de mort cérébrale ? Une critique radicale à l’heure du capitalisme algorithmique
La controverse suscitée par les prises de position de Mahjoub Lotfi Belhedi, notamment dans son dernier article intitulé « Brouillard : 404 – Science économique Not Found », dépasse la simple querelle académique. Elle vient poser avec une acuité rare une question qui dérange : la science économique, telle qu’elle est encore majoritairement enseignée et pratiquée, a-t-elle épuisé sa capacité à rendre compte du réel ? Ou pire encore : est-elle devenue un obstacle à la compréhension des transformations profondes du capitalisme contemporain ?
Une critique à contre-courant : quand la rupture remplace la réforme
Contrairement à la majorité des critiques adressées à l’économie dominante, Belhedi ne se situe pas dans une perspective réformiste. Il ne plaide ni pour une mise à jour des outils théoriques ni pour un élargissement des modèles d’analyse. Son propos est plus radical : il s’agit d’un diagnostic de décès disciplinaire. Selon lui, nous ne vivons pas une simple transition paradigmatique, mais bien un effondrement épistémologique, où les fondements mêmes de la pensée économique – la notion de travail, de valeur, de rareté ou de marché – ont perdu toute pertinence explicative.
L’enjeu n’est plus de corriger les angles morts d’une science en crise, mais de constater l’obsolescence de son architecture intellectuelle. Là où certains perçoivent des signes de résilience ou d’adaptation (économie comportementale, numérique, computationnelle), Belhedi voit des greffes sur un arbre déjà mort, des tentatives de sauvetage d’un langage devenu inaudible face à un monde reconfiguré par les algorithmes, les données et la logique des plateformes.
« Selon lui, nous ne vivons pas une simple transition paradigmatique, mais bien un effondrement épistémologique, où les fondements mêmes de la pensée économique – la notion de travail, de valeur, de rareté ou de marché – ont perdu toute pertinence explicative. »
La faillite de la valeur-travail : symptôme d’un basculement ontologique
Le point nodal de la critique réside dans la mise en faillite de la théorie de la valeur-travail. À l’heure du capitalisme algorithmique, la valeur n’est plus produite par le travail humain intentionnel, mais par la captation massive et automatique de comportements, d’affections et d’interactions, souvent inconscients. Les données générées par les utilisateurs d’un réseau social, les clics sur une plateforme, les modèles comportementaux prévus par une IA deviennent la nouvelle matière première du capital. Et ce capital, désormais auto-reproductif, se détache des catégories traditionnelles du travail, de la production et même du marché.
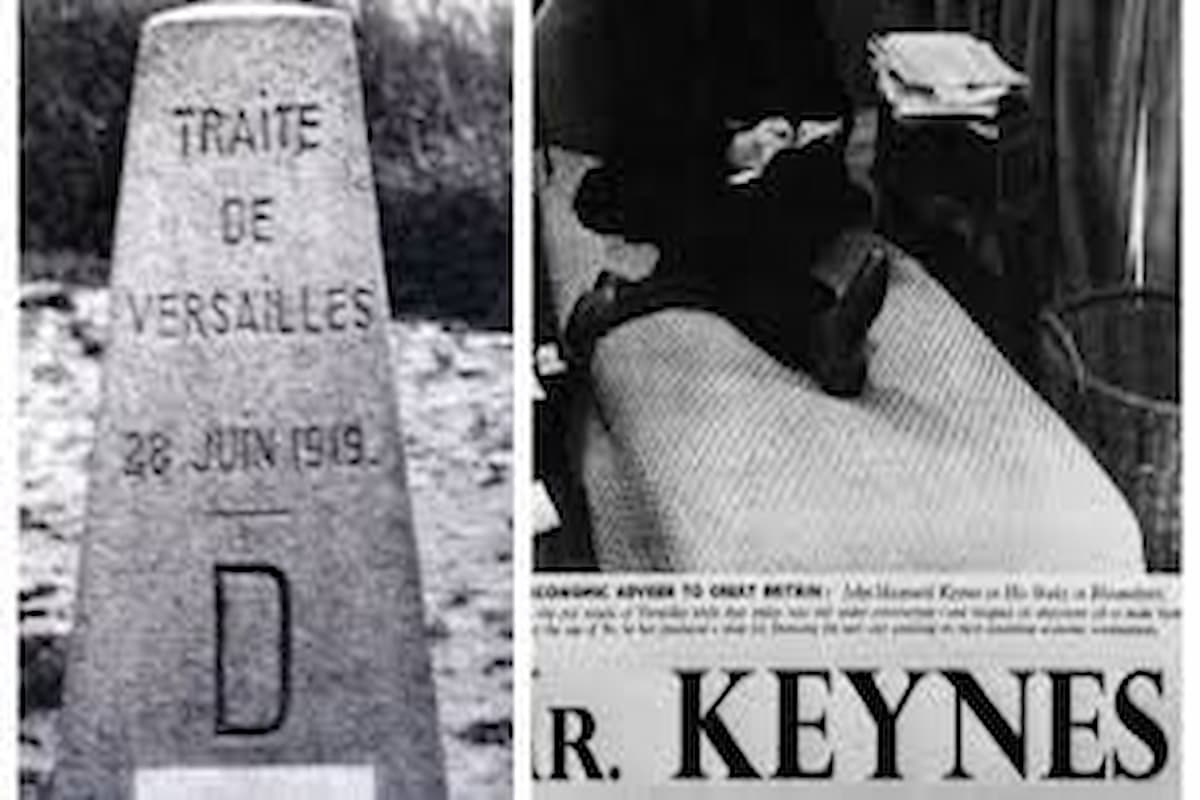 En ce sens, l’auteur affirme que Marx n’a pas simplement été pris de court par TikTok ; il n’avait tout simplement pas eu à penser un modèle économique où le travail vivant est marginalisé au profit de la valeur dérivée de l’attention et de la modulation prédictive des comportements. La critique de Belhedi ne nie donc pas l’importance historique des grands penseurs économiques, mais elle déclare leur inapplicabilité actuelle.
En ce sens, l’auteur affirme que Marx n’a pas simplement été pris de court par TikTok ; il n’avait tout simplement pas eu à penser un modèle économique où le travail vivant est marginalisé au profit de la valeur dérivée de l’attention et de la modulation prédictive des comportements. La critique de Belhedi ne nie donc pas l’importance historique des grands penseurs économiques, mais elle déclare leur inapplicabilité actuelle.
« Le point nodal de la critique réside dans la mise en faillite de la théorie de la valeur-travail. À l’heure du capitalisme algorithmique, la valeur n’est plus produite par le travail humain intentionnel, mais par la captation massive et automatique de comportements, d’affections et d’interactions, souvent inconscients. »
Une économie qui refuse de mourir : résistance symbolique et conservatisme méthodologique
Face à cette situation, le réflexe dominant est, selon Belhedi, celui du sauvetage interne. Une partie de la communauté économique s’efforce de maintenir la légitimité de la discipline en multipliant les ajustements marginaux, les extensions de modèles classiques ou les hybridations superficielles avec d’autres sciences sociales. Mais cette stratégie, qui vise à préserver le monopole d’interprétation de la science économique, empêche l’émergence d’alternatives véritablement transformatrices.
Il faut, affirme-t-il, oser la rupture. Car tant que l’économie classique conservera son autorité symbolique – dans les institutions, les politiques publiques, les médias, les universités – elle empêchera l’avènement d’un nouveau langage pour penser le monde. Ce n’est donc pas un débat académique clos, mais une lutte de pouvoir intellectuelle, où se joue la possibilité d’une refondation.
« Il faut, affirme-t-il, oser la rupture. Car tant que l’économie classique conservera son autorité symbolique – dans les institutions, les politiques publiques, les médias, les universités – elle empêchera l’avènement d’un nouveau langage pour penser le monde. »
L’économie des métadonnées : vers une nouvelle épistémè transdisciplinaire
La proposition de Belhedi ne se limite pas à la destruction critique : elle contient aussi un embryon de projet fondateur. Celui d’une économie des métadonnées, à la fois transdisciplinaire et critique, capable de penser les nouvelles logiques de création de valeur et de domination. Cette science en gestation croiserait les outils des sciences computationnelles, de l’algorithmique, de la théorie critique, de la philosophie politique et de l’éthique des systèmes. Elle s’intéresserait non plus seulement aux flux monétaires ou à la production matérielle, mais aux architectures de données, aux infrastructures numériques, à la dynamique des plateformes, aux régimes d’attention.
Loin d’être une utopie technocratique, cette perspective s’ancre dans une réalité déjà en cours : celle où le capital n’a plus besoin de produire pour accumuler, mais se contente de calculer, modéliser, anticiper. L’enjeu est alors d’élaborer une science qui ne soit pas seulement réactive, mais capable d’anticiper les formes de domination à venir.
« Une économie des métadonnées qui s’intéresserait non plus seulement aux flux monétaires ou à la production matérielle, mais aux architectures de données, aux infrastructures numériques, à la dynamique des plateformes, aux régimes d’attention. »
Une critique qui bouscule, mais qui reste à construire
Il serait tentant de rejeter cette critique comme trop radicale, trop spéculative ou trop théorique. Pourtant, elle pose une question essentielle : que vaut une science qui n’est plus capable de penser son objet ? Et plus encore : à partir de quand une discipline doit-elle accepter sa fin pour laisser émerger autre chose ?
Il reste certes à Belhedi la tâche de rendre son programme opérationnel. Car si la dénonciation de l’obsolescence des anciens cadres est convaincante, l’alternative reste encore en chantier. La transdisciplinarité, aussi prometteuse soit-elle, devra faire ses preuves : en termes de méthodologie, de modélisation, mais aussi d’application concrète.
« L’image finale proposée par Belhedi est forte : « une science qui refuse de mourir empêche une autre de naître ». Ce jugement sans appel peut heurter. Mais il a le mérite de rappeler une vérité souvent refoulée : les sciences ne sont pas éternelles. Elles naissent, prospèrent, se réforment parfois… et meurent aussi.«
In fine, penser contre la maison, pour reconstruire ailleurs
L’image finale proposée par Belhedi est forte : « une science qui refuse de mourir empêche une autre de naître ». Ce jugement sans appel peut heurter. Mais il a le mérite de rappeler une vérité souvent refoulée : les sciences ne sont pas éternelles. Elles naissent, prospèrent, se réforment parfois… et meurent aussi.
Face aux mutations profondes du capitalisme numérique, à l’irruption des plateformes, à l’automatisation de la cognition et à la financiarisation de l’attention, peut-être faut-il accepter que la maison économique actuelle est devenue inhabitable. Et qu’il est temps, non de la rénover, mais de bâtir ailleurs. Une nouvelle demeure théorique, à la hauteur de notre époque.
——————–
Articles en relation :
Proactivité financière : une illusion d’anticipation
ECLAIRAGE – La science économique à l’ère du soupçon numérique
Autopsie de la fin tragique des sciences économiques
===============================
* Dr. Tahar EL ALMI,
Economiste-Economètre.
Ancien Enseignant-Chercheur à l’ISG-TUNIS,
Psd-Fondateur de l’Institut Africain
D’Economie Financière (IAEF-ONG)
L’article LA CONTROVERSE – La Science économique en état de mort cérébrale ? Une critique radicale à l’heure du capitalisme algorithmique est apparu en premier sur Leconomiste Maghrebin.