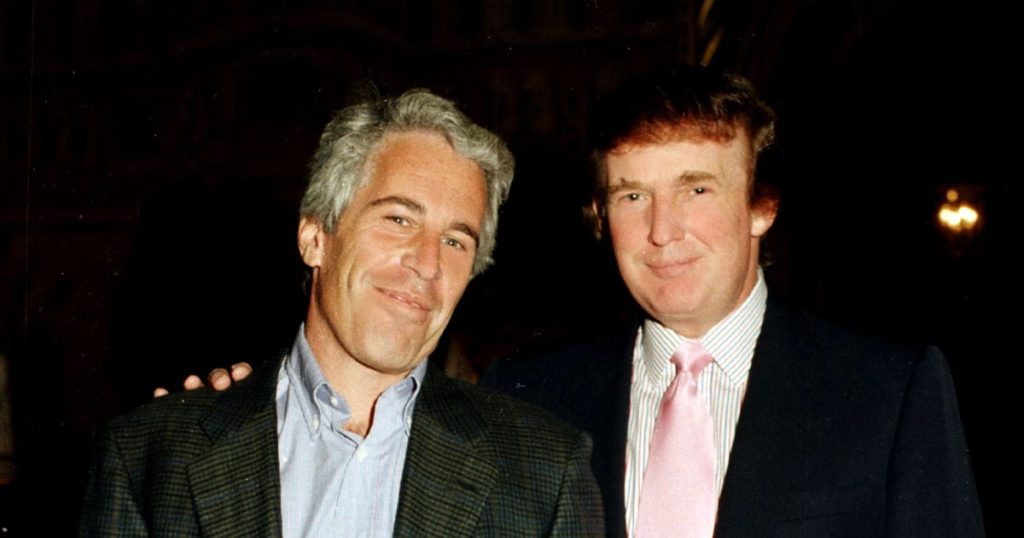Agnès Jésupret raconte l’enfance chahutée d’une Italienne de Tunisie
Avec ‘‘Les os noirs’’, son premier roman, Agnès Jésupret explore une histoire intime et oubliée née d’un témoignage recueilli presque par hasard : celui d’une vieille dame d’origine italienne ayant grandi dans la Tunisie du protectorat français. À travers ce récit nourri de mémoire, de malédictions et d’ombres coloniales, l’autrice tisse un fil entre fiction et réalité, entre silence et transmission. Dans cet entretien accordé à Kapitalis, elle revient sur la genèse de son livre, son regard sur l’histoire coloniale, sa méthode de travail minutieuse et sensorielle, et son désir de voir son roman dialoguer avec la Tunisie d’aujourd’hui. Une parole sensible et engagée, portée par une romancière pour qui l’écriture est un geste de réparation.
Entretien réalisé par Djamal Guettala
Kapitalis : Vous vous définissez comme «biographe anonyme pour des gens qui le sont tout autant ». Qu’est-ce qui vous a poussée à écrire un premier roman ?
Agnès Jésupret : J’ai commencé à écrire ce roman avant d’écrire des livres de souvenirs. J’ai eu envie de l’écrire parce que je suis tombée sur une dame assez âgée, d’origine italienne, qui m’a raconté son enfance en Tunisie. Cette histoire était tellement incroyable, tellement tourmentée, que je lui ai demandé l’autorisation d’en faire un roman. La dame m’a dit que je pouvais faire ce que je voulais de son histoire, alors j’ai commencé à «m’amuser» à écrire. Pendant une dizaine d’années, je suis revenue sur ce roman, c’était mon passe-temps. Quelque temps après avoir rencontré cette dame, j’ai commencé à faire des livres de souvenirs.
Je précise que la dame ne m’avait pas demandé d’écrire ses souvenirs, ce n’est pas une commande.
Quelle part de réalité se cache derrière cette fiction ? Est-ce l’écho d’un témoignage recueilli ou une construction totalement littéraire ?
Oui, j’ai recueilli le témoignage de cette dame en la filmant avec un camescope, ensuite j’ai retranscrit ses souvenirs et j’ai commencé à broder autour, à extrapoler, à nourrir son récit d’autres récits. Je me suis beaucoup documentée, j’ai beaucoup lu, j’ai fouillé dans les archives pour essayer de reconstituer le contexte dans lequel elle avait grandi, j’ai créé des personnages annexes pour donner une idée plus précise de ce qu’était la Tunisie à l’époque, et parce que c’était important pour moi de ne pas donner que le seul point de vue de la communauté italienne.
Dans ‘‘Les os noirs’’, beaucoup de choses sont donc vraies (l’histoire de la malédiction, les empoisonnements, la déchéance de la famille…) et beaucoup d’autres ont été ajoutées par mes soins…
Pourquoi avoir situé l’histoire en Tunisie, et plus précisément à Grombalia ?
Ce n’est pas un choix. Je voulais raconter l’histoire de cette dame, elle était née en Tunisie, à Grombalia.
Peut-être que cette histoire m’a attirée parce que je suis très attachée à la Méditerranée et aux pays méditerranéens.
Le thème de la malédiction traverse tout le roman. Est-ce pour vous une figure littéraire, une croyance culturelle ou un fil symbolique ?
Pour la vraie Clara, la malédiction est une réalité qui a touché sa famille, c’est comme ça qu’elle expliquait tous les malheurs survenus.
Pour moi, les malédictions n’existent pas, elles sont effectivement des croyances culturelles, mais je laisse les lectrices et lecteurs se faire leur opinion, chacun a le droit de croire ou de ne pas croire aux malédictions. La question reste ouverte, je n’émets pas de jugement catégorique dans le roman.
Il se trouve aussi que la malédiction a un côté très «romanesque», je crois qu’en tant que lecteur, on aime lire des histoires de malédiction…
Le récit évoque en creux la violence coloniale et les mécanismes d’appropriation. Était-ce un angle assumé dès le départ ?
Oui, je suis très touchée par toutes les histoires de colonisation, de colonialisme, je suis révoltée par les injustices, intéressée par les flux migratoires, les exils. Ce sont des thématiques qui m’animent depuis longtemps. J’ai été bénévole quelques années dans une association qui proposait des cours d’alphabétisation à des Afghans, Turcs, Algériens et Marocains habitant à Marseille. J’ai été confrontée, et je le suis encore, à des hommes et des femmes aux parcours chahutés et qui, pour se libérer de certaines dominations, risquaient leur vie. Je souffre de me sentir impuissante face aux injustices liées au colonialisme et aux mécanismes de domination. Je ne pouvais pas écrire un livre se déroulant sous le protectorat français de Tunisie sans montrer plus ou moins ouvertement mon désaccord avec certaines pratiques.
On sent dans le texte une attention très forte aux détails sensoriels : odeurs, textures, gestes. Comment avez-vous travaillé cette atmosphère ?
Je ne suis jamais allée en Tunisie, alors j’ai fait confiance à ce que m’avait raconté la vraie Clara et j’ai lu beaucoup, j’ai regardé des vidéos d’archives. Je voulais effectivement que l’on puisse sentir et ressentir les choses de manière assez précise.
Les lecteurs et lectrices tunisiens que j’ai eu l’occasion de rencontrer m’ont dit qu’ils avaient été bluffés par ces descriptions, ça me touche beaucoup.
La figure du père, Pierre Ignorante, est ambivalente : homme «honnête» mais inflexible, et parfois aveugle. Comment l’avez-vous construit ?
La vraie Clara m’a beaucoup parlé de son père, mais ça ne suffisait pas pour en faire un personnage crédible, alors j’ai affiné son portrait, j’ai exagéré certains de ses traits de caractère. Il est issu d’un mélange de réalité et de fiction.
Je voulais un personnage «humain», dont on puisse deviner les contradictions et les failles.
Le roman donne la parole à une femme très âgée. Comment avez-vous approché l’écriture de la vieillesse, de la mémoire fragmentée ?
C’est l’un des aspects qui m’intéresse le plus. En tant qu’autrice de livres de souvenirs, je suis très curieuse de voir comment fonctionne la mémoire, je manipule les souvenirs avec beaucoup de précaution et d’admiration.
Pour ‘‘Les Os noirs’’, dès le départ, j’ai décidé de prendre les souvenirs de cette dame tels qu’ils étaient, c’est-à-dire très incomplets. Je n’ai pas cherché à éclaircir certains points, j’avais envie de reconstituer moi-même la dentelle de ces souvenirs, de combler moi-même les vides et les manques. J’avais cette liberté, qui est celle de la romancière, je l’ai prise.
Avez-vous envisagé une suite à ce roman, ou d’autres récits liés à la mémoire familiale et coloniale ?
Non, il n’y aura pas de suite. En revanche, j’ai deux romans en préparation qui sont aussi en lien avec les souvenirs et avec les thématiques de colonisation, d’exil et de privation de liberté. Ce sont des questions que je veux creuser par le roman pour essayer de donner, par des histoires personnelles atypiques et des destins étonnants, une vision multiple de ces problématiques complexes et protéiformes.
Quelle serait, selon vous, la réception idéale de ce roman en Tunisie, là où l’histoire prend racine ?
J’ai déjà de très beaux retours de lecteurs et lectrices tunisiens. Ce sont ceux qui m’ont le plus émue. Mon vœu le plus cher serait que le roman soit traduit en arabe tunisien et j’aimerais qu’il me permette de tisser des liens avec ce pays que je rêve de découvrir.
Que voudriez-vous que retienne le lecteur, une fois le livre refermé : un souvenir, une émotion, une question, un malaise peut-être ?
Je crois que j’aimerais que l’on comprenne la souffrance qu’engendre l’exil de manière générale, quelle que soit la raison de cet exil, quelle que soit la nationalité de la personne. Mais je voudrais surtout que les lectrices et lecteurs sortent de la lecture du livre avec une vision plus précise de ce qu’était la Tunisie dominée par les Français, de ce que vivaient les Tunisiens musulmans sous ce protectorat et aussi des relations entre les différentes communautés.
L’article Agnès Jésupret raconte l’enfance chahutée d’une Italienne de Tunisie est apparu en premier sur Kapitalis.