Une mère palestinienne à Gaza
Elle est là, debout au milieu des ruines. Son foulard est noir de cendres, ses bras vides. Le vent soulève un reste de rideau accroché à un pan de mur — c’était la cuisine, ou peut-être la chambre. Elle ne sait plus. Il ne reste rien pour nommer les pièces de la maison. La maison elle-même a été dissoute dans l’air, comme ses enfants.
Khémaïs Gharbi *
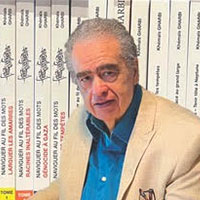
Autour d’elle, plus un cri, plus un appel, plus une main. Ils sont tous partis au paradis, à quelques semaines d’intervalle : ses parents, ses grands-parents, son mari, ses petits…
Un à un, emportés, étouffés, ensevelis. Et elle, seule survivante, seule témoin. Mais témoin de quoi, sinon d’un monde qui se défait sans honte ?
Et pourtant, elle ne quitte pas les lieux.
C’est encore un piège
Elle s’est hasardée une ou deux fois pour aller chercher de la nourriture, mais il y a eu trop de morts pour qu’elle puisse songer à y retourner. C’est encore un piège, se dit-elle, pour tenter de briser notre résistance.
Elle regarde les ruines, non comme on regarde un champ de guerre, mais comme on regarde une vieille photographie d’enfance. Chaque pierre retournée lui parle. Chaque fissure raconte une nuit d’hiver, un rire étouffé, un repas partagé debout faute de place.
Ce camp n’était pas une maison — mais c’était leur maison. Un entre-deux permanent entre deux bombardements.
Un foyer précaire, certes, mais tissé d’amour, d’attente, de résistance. Elle se souvient de la voix de sa mère chantant en pliant les couvertures. De la silhouette de son père traçant un carré de jardin au pied du mur pour jouer avec ses frères et sœurs. Des rires d’enfants jouant à cache-cache entre les citernes d’eau. Et même des jours de peur, où l’on s’abritait les uns contre les autres dans une pièce sans toit — ces jours-là réveillent en elle des sentiments d’amour et de solidarité.
Tout cela, oui, fait partie d’elle.
Et les ruines, aujourd’hui, ne lui sont pas étrangères : elles lui ressemblent.
C’est là que sa mémoire est enfouie. Pas dans les livres d’histoire, mais sous ces cailloux, dans ces creux où l’on a tenu, résisté, combattu les envahisseurs. C’est là, dans cette poussière que d’autres veulent encore bombarder, qu’habite son ADN, gravé à même la détresse. Pourquoi s’acharner encore sur des cailloux, sur des ruines ? se demande-t-elle. Veulent-ils venger leurs morts en tuant les nôtres trois, quatre fois de suite ?
Elle ne veut pas partir
Et maintenant, une rumeur circule : Ils n’arrêteront que si l’on quitte Gaza. Il faudra partir. Partir ? Quitter qui, quitter quoi ? Pour aller où ? Chercher de nouveaux camps ? De nouveaux cimetières ?
Mais comment quitter ce qui vous constitue ? Comment abandonner les restes de ses martyrs, les ombres de ses vivants, les traces de ses rêves effondrés ?
Elle ne veut pas partir. Pas parce qu’elle espère. Mais parce qu’elle appartient à ce monde de désolation. Elle appartient à ce lieu sans espoir, à cette terre meurtrie, à ces pierres brisées plusieurs fois par la folie des plus forts — ces cailloux qui lui parlent, qui lui disent qu’elle est chez elle, dans son pays.
Et quand elle regarde autour d’elle, c’est comme si elle s’adressait aux bourreaux du jour — ceux qui n’oseront jamais descendre de leurs bombardiers pour affronter les siens en face : «Ce que vous appelez ruines, c’est mon berceau, ma boussole, mon pays, mon histoire. C’est là que mon peuple a aimé, survécu, résisté. C’est là que mon âme demeurera.»
Son regard, désormais, n’est plus seulement celui d’une veuve, d’une mère, d’une orpheline. C’est le regard d’un peuple debout dans toute sa grandeur. Un regard qui dit non à l’effacement. Un regard qui retient tout ce que l’on voudrait détruire — par le souvenir et l’attachement.
Et voici que les cailloux sous ses pieds, souillés de sang, tachés de larmes, deviennent plus éclatants que les pierres précieuses. Car aucune richesse au monde ne renferme autant d’attachement, de fidélité aux ancêtres, d’honneur, de courage, de patriotisme — et de dignité.
Alors, après avoir fait lentement le tour des ruines de ce qui fut leur maison, elle revient sur ses pas. Elle choisit un gros caillou, parmi tant d’autres, et s’y assied, le dos droit, le regard fixe. Non pour pleurer, non pour fuir — mais pour veiller, comme on veille un sanctuaire, comme on protège une flamme fragile.
Elle ne partira pas.
Elle restera là, sentinelle muette, pour garder vivante la mémoire de sa condition de mère palestinienne.
* Ecrivain, traducteur.
L’article Une mère palestinienne à Gaza est apparu en premier sur Kapitalis.
