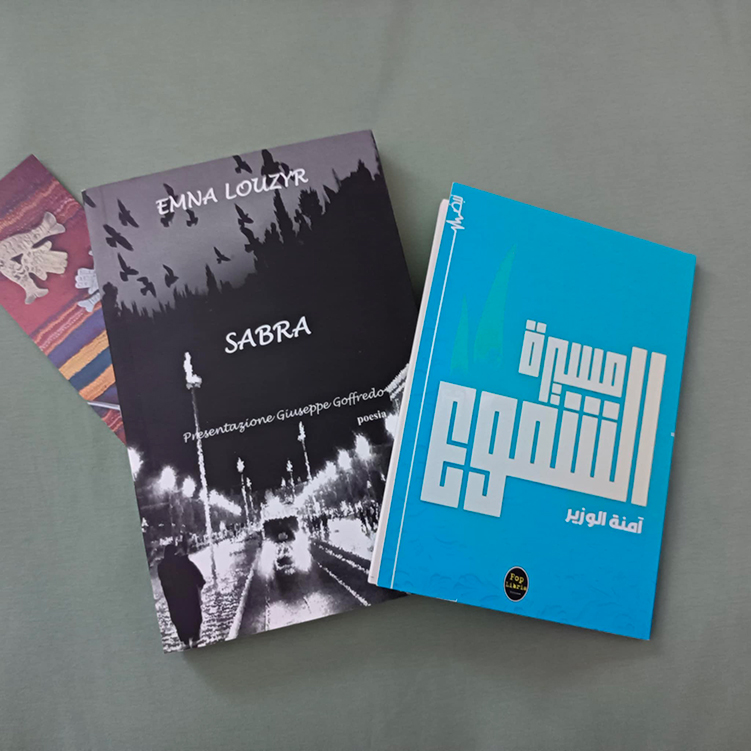Projet Elyssa : Des avancées concrètes
Sur 116 candidatures, cinq projets sont retenus pour les musiques et huit pour les arts visuels. Nous avons profité de cet évènement pour échanger avec les artistes et découvrir leurs démarches.
La Presse — Au mois d’octobre 2024, l’Institut français de Tunisie a annoncé le lancement d’un fonds d’aide pour la création et le soutien des artistes, baptisé « Elyssa ». Le principe est de lancer des appels à candidature afin de sélectionner, accompagner et mentorer les créations de qualité des artistes tunisiens émergents et confirmés.

Une rencontre a eu lieu le 9 mai, à mi-parcours, réunissant lauréats, partenaires, coachs formateurs et journalistes, afin de faire une mise au point des étapes franchies jusqu’à présent. Nous sommes partis à la rencontre des lauréats et de l’équipe qui chapeaute ce projet.
Un projet qui vise le marché international
M. Fabrice Rousseau, directeur de l’IFT, a rappelé dans son mot de bienvenue que « Elyssa » est un fonds d’aide à la création qui aspire à dynamiser la scène culturelle tunisienne et aider les artistes à être plus visibles sur le marché international. Deux catégories sont au centre de l’intérêt : les musiques et les arts visuels.
Le volet logistique a été assuré avec le soutien actif de partenaires de terrain tunisiens. Fany Roland attachée culturelle de l’IFT, a souligné dans son intervention que les artistes sélectionnés par des comités d’experts bénéficient actuellement d’un accompagnement personnalisé avec des séances de coaching et une résidence artistique de création. Le programme inclut également la mise en réseau et la diffusion des œuvres abouties à travers des concerts et des expositions. Saima Samoud, cheffe de projet, a annoncé la liste finale des lauréats. Sur 116 candidatures, cinq projets sont retenus pour les musiques et huit pour les arts visuels. Nous avons profité de cet évènement pour échanger avec les artistes et découvrir leurs démarches.
« Hor el Ensen-Walk free » de Broua
Broua est un ensemble musical réunissant des artistes venus de Tunisie, de France et des Pays-Bas. Leur musique propose une fusion originale entre les sonorités traditionnelles tunisiennes et des genres, tels que le jazz, le blues et la musique latine.Le projet est porté par Wissem Zaidi, musicien, auteur et compositeur tunisien.
À travers ses morceaux, Broua aborde des thématiques profondes, telles que l’identité, la nostalgie et la quête de soi, invitant le public à un voyage empreint de récits personnels et de métissages culturels. « La collaboration au projet Elyssa nous a offert le premier fonds qui nous ouvrira de nouveaux horizons. La résidence live à Hammamet sera une occasion pour nous réunir et travailler davantage sur le projet. Ce qu’il y a de plus intéressant, c’est surtout la possibilité d’une tournée en Europe», nous a confié Wissem Zaidi. « Nous sommes en train de travailler sur un album qui verra le jour en septembre prochain. Deux titres sont déjà dans les bacs».
« Dendri fel Midane » par le groupe Dendri-Stambeli Movement
Dirigé par Mohamed Khachnaoui, ce groupe aspire à dépoussiérer le stambeli, rituel musical et thérapeutique ancien, et le remettre au goût du jour avec une vision artistique moderne qui lui apporte un vent de fraîcheur. Enseignant universitaire à l’Ismt, Mohamed Khachnaoui a démarré ses recherches depuis 2008 dans le cadre de son parcours académique.
« Ce projet est l’aboutissement de mon engagement avec des musiciens curieux qui partagent avec moi cette passion », nous explique-t-il. « C’est une musique riche artistiquement et esthétiquement. Nous travaillons à la réinventer, la rejouer avec des instruments modernes : basse électrique, guitare électrique… ».
L’aventure dans le design vestimentaire de Wadi Mhiri
En artiste pluridisciplinaire, Wadi Mhiri a commencé depuis 2004 par pratiquer la photographie, puis la céramique, la vidéo et l’installation… Styliste de formation, depuis 2004, il collectionne photos, vidéos, céramique, installations.. « Ce projet sur lequel je réfléchis sérieusement depuis 4 ans est une rétrospective, un hommage à ma famille qui est dans le monde du textile et de l’habillement. Je suis moi-même styliste de formation», nous a-t-il indiqué.
Le projet de design écologique de Mohamed Ali Ouertani
Architecte de formation, Mohamed Ali Ouertani est aussi designer de céramique. Il a son propre atelier et sa propre marque. Sa collaboration avec Elyssa allie à la fois l’architecture et le design. « C’est un système de ventilation naturel qui va être installé dans les bâtiments existants avec une approche écologique. Je suis en train de développer le prototype par les recherches et les tests en vue de le commercialiser en Tunisie et à l’étranger », explique l’auteur du projet.
Le management artistique par Mohamed Ben Saïd
Le manager d’Acacia Production a tenu à souligner l’importance de l’accompagnement des artistes pour mener à bon port les projets sur lesquels ils travaillent actuellement. « Le profil de manager musical existe en Tunisie. C’est l’industrie proprement dite qui fait défaut. Le plus difficile pour un artiste émergent, c’est de décrocher des opportunités pour se produire dans de grands évènements culturels.
Nous avons des centaines de festivals en Tunisie, mais ce sont les mêmes noms qui s’en emparent. Les jeunes artistes ont peu de chance de se faire programmer, à part quelques exceptions qui ont eu un succès commercial fulgurant. Nous avons de jeunes talents et de la bonne musique dans tous les coins de la Tunisie. Il faut les encourager à la création, valoriser leurs œuvres et surtout les encadrer pour qu’ils puissent construire leur avenir autour de leur musique. »
Mohamed Ben Saïd travaille principalement sur ce volet. Ramener des coachs tunisiens et étrangers, des programmateurs de festivals, des experts en droits d’auteur. Ils apprennent aux artistes et aux managers artistiques les bases du métier : l’organisation d’un concert, la signature des contrats, le volet fiscal.
Notons que les résidences artistiques dans le cadre du projet Elyssa sont actuellement en cours. Un concert est prévu au mois de juin, à l’occasion de la fête de la musique, avec les lauréats à l’affiche. Des expositions auront lieu bientôt pour les arts visuels.