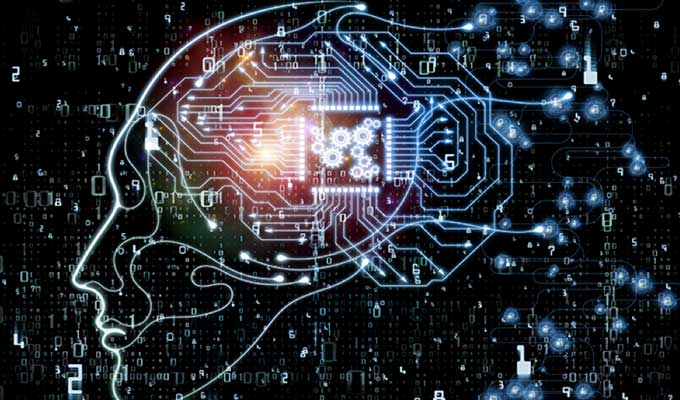 En dépit de cette atmosphère de précarité, de frustration et d’impuissance qui règne dans le pays, il y a, de temps en temps, des informations heureuses qui surgissent et viennent nous embaumer le cœur.
En dépit de cette atmosphère de précarité, de frustration et d’impuissance qui règne dans le pays, il y a, de temps en temps, des informations heureuses qui surgissent et viennent nous embaumer le cœur.
Le récent classement de la Tunisie à la 2ème place des pays africains les mieux préparés au développement des talents en intelligence artificielle, juste après l’Afrique du sud, est indéniablement une très très bonne nouvelle en raison de sa grande qualité stratégique et de son effet multiplicateur sur le développement futur du pays.
C’est un signe d’un grand espoir. Il vient illustrer de manière éloquente que malgré les difficultés par lesquelles la Tunisie est passée, le pays est sur la bonne voie, celle du progrès et de la maîtrise de l’Intelligence artificielle (IA) dont le monde entier ne jure que par elle.
“Le récent classement de la Tunisie à la 2ème place africaine en IA est indéniablement une très bonne nouvelle en raison de sa grande qualité stratégique.”
Pour revenir au classement de l’indice de préparation en intelligence artificielle pour l’Afrique connue sous l’appellation anglicane « AI Talent Readiness Index for Africa 2025 », ce classement, publié fin mai courant, évalue la capacité des 54 pays du continent à développer, retenir et déployer des talents en IA, en se basant sur 20 indicateurs tels que le pourcentage de développeurs Web par million d’habitants, le nombre d’établissements d’enseignement supérieur offrant des formations en IA et en « machine learning » (ML), le pourcentage des diplômés du supérieur dans la main-d’œuvre totale, le taux de pénétration d’Internet, l’adoption d’une stratégie nationale de développement de l’IA, le taux d’électrification, la qualité des réglementations dans le domaine de la protection des données.
Au plan nord africain, la Tunisie devance l’Egypte (3ème), l’Algérie (8ème) et le Maroc (9ème).
L’Afrique du Sud obtient un score de 52,15 points sur un total de 100, grâce notamment à ses bonnes performances dans les piliers des « compétences numériques » (1er rang à l’échelle continentale) et « données & infrastructures » (2e rang).
Les meilleures performances de la Tunisie
La Tunisie et l’Egypte occupent ex aequo le deuxième rang, avec un score de 51,80 points. La Tunisie, le plus petit pays du Maghreb doit essentiellement son rang, à sa première place à l’échelle africaine dans le pilier « données & infrastructures », tandis que l’Egypte réalise ses meilleures performances dans le pilier « compétences numériques » (2e rang à l’échelle africaine).
“Ce classement vient illustrer de manière éloquente que, malgré les difficultés, la Tunisie est sur la bonne voie du progrès et de la maîtrise de l’IA.”
Autre performance de pointe de la Tunisie :la densité de développeurs. Elle est élevée en Tunisie qui compte 4120 développeurs par million d’habitants, suivie du Maroc (1345), l’Egypte (1224) et l’Algérie (477).
Au plan nord africain, la Tunisie devance l’Egypte (3ème), l’Algérie (8ème) et le Maroc (9ème).
Ces acquis numériques qui ne sont pas visibles à l’œil nu
La Tunisie doit également sa 2ème place à la faveur de plusieurs autres leviers et réalisations.
Au nombre de ceux-ci figurent en bonne place : une volonté politique claire perceptible à travers la mise au point d’une stratégie nationale de l’Intelligence Artificielle (2021-2025), cette même stratégie qui positionne l’IA comme un levier de croissance économique et d’inclusion sociale.
Par ailleurs, des partenariats public-privé (soutien de la CDC, bras financier de l’Etat aux startups) sont établis pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique.
Point d’orgue de cette politique volontariste, la digitalisation des services publics avec des plateformes comme Evax, E-Bawaba, ou encore la simplification projetée des démarches administratives en ligne.
“La Tunisie a désormais les moyens et outils pour jouer le rôle de hub régional pour le développement de partenariats win-win en matière d’intelligence artificielle.”
Cette volonté politique est concrétisée par l’élaboration de réformes structurelles et la mobilisation d’ investissements ciblés pour faire émerger un écosystème numérique fondée sur l’innovation, une Infrastructures TIC de qualité (un taux de pénétration d’internet supérieur à 66 %), adoption des normes de téléphone mobile (4G et 5G), accès généralisé à l’électricité (taux d’électrification proche de 100 %), mise en place d un écosystème technologique dynamique :technopôles actifs (El Ghazala, Sfax, Sousse), des incubateurs spécialisés en tech, une vague de startups IA émergentes, et un réseau croissant de développeurs, ingénieurs data, et experts machine learning.
AI Talent Readiness Index for Africa 2025 a cité d’autres acquis accomplis par la Tunisie en matière de promotion de l’économie numérique. Il s’agit principalement de la formation par milliers chaque année d’ingénieurs en informatique et l’intégration dans les programmes académiques l’initiation à l’IA, data science, cloud computing …
Cela pour dire au final que par delà ces éclairages sur les arguments qui justifient cet excellent classement de la Tunisie au 2ème rang des pays africains les mieux préparés les mieux préparés au développement des talents en intelligence artificielle, nous pensons que la Tunisie a désormais les moyens et outils pour jouer, entre l’Europe et l’Afrique, le rôle de hub régional pour le développement de partenariats win win en matière d’intelligence artificielle et d’autres technologies de pointe (centre de données…).
Abou SARRA
Indicateurs clés
- 2ème place : Rang de la Tunisie en Afrique pour la préparation au développement des talents en IA.
- 51,80 points : Score de la Tunisie et de l’Égypte dans l’indice “AI Talent Readiness for Africa 2025”.
- 1ère place africaine : Position de la Tunisie dans le pilier “données et infrastructures”.
- 4120 développeurs : Nombre de développeurs par million d’habitants en Tunisie.
66% : Taux de pénétration d’Internet en Tunisie.
L’article Développement des talents IA en Tunisie : Un espoir pour l’économie numérique est apparu en premier sur WMC.

 Palmarès de la Coupe de Tunisie de football, à l’issue de la victoire de l’Espérance de Tunis face au Stade Tunisien (1-0), en finale disputée dimanche à Radès :
Palmarès de la Coupe de Tunisie de football, à l’issue de la victoire de l’Espérance de Tunis face au Stade Tunisien (1-0), en finale disputée dimanche à Radès : À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, la plateforme Med.tn a organisé une table ronde pour « distinguer le vrai du faux » autour des alternatives aux cigarettes. Animée par Malek Aouni, cette rencontre a réuni le cardiologue Dr Dhaker Lahidheb et le psychologue Dr Anas Laouini, spécialiste des thérapies comportementales, face à un public de journalistes et de professionnels de la santé.
À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, la plateforme Med.tn a organisé une table ronde pour « distinguer le vrai du faux » autour des alternatives aux cigarettes. Animée par Malek Aouni, cette rencontre a réuni le cardiologue Dr Dhaker Lahidheb et le psychologue Dr Anas Laouini, spécialiste des thérapies comportementales, face à un public de journalistes et de professionnels de la santé.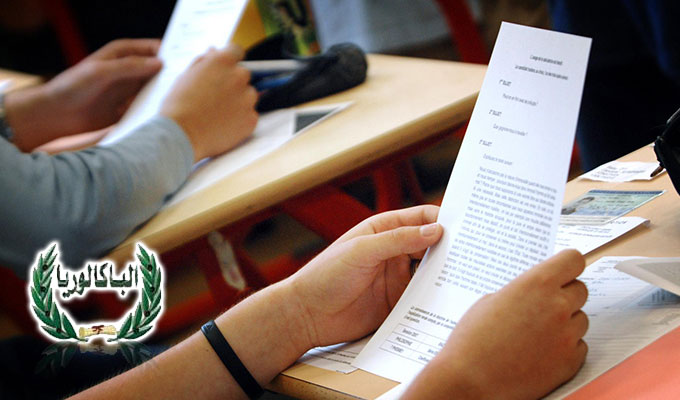 Pour cette session du baccalauréat 2025, les examens, qui débuteront ce lundi 2 juin, rassembleront 151 808 candidats, soit une augmentation de 11 602 inscrits par rapport à l’année précédente.
Pour cette session du baccalauréat 2025, les examens, qui débuteront ce lundi 2 juin, rassembleront 151 808 candidats, soit une augmentation de 11 602 inscrits par rapport à l’année précédente.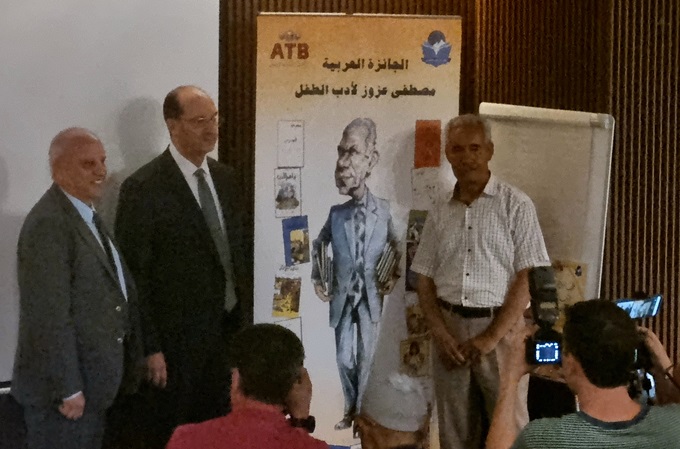 La 16ᵉ édition du Prix Mustapha Azzouz de littérature enfantine a été officiellement lancée, avec une présentation assurée par Riadh Hajjej, Directeur Général de l’Arab Tunisian Bank (ATB). Cette distinction vise à promouvoir la création littéraire destinée à la jeunesse arabe et à valoriser le rôle fondamental de la lecture dans l’éveil culturel et intellectuel des enfants.
La 16ᵉ édition du Prix Mustapha Azzouz de littérature enfantine a été officiellement lancée, avec une présentation assurée par Riadh Hajjej, Directeur Général de l’Arab Tunisian Bank (ATB). Cette distinction vise à promouvoir la création littéraire destinée à la jeunesse arabe et à valoriser le rôle fondamental de la lecture dans l’éveil culturel et intellectuel des enfants. Ce vendredi, selon l’Institut National de la Météorologie (INM), le temps sera généralement dégagé à légèrement nuageux sur la majeure partie du territoire tunisien. Les températures afficheront une nette différence selon les régions : elles oscilleront entre 23°C et 28°C sur les régions côtières et les hauteurs, tandis que le thermomètre indiquera entre 29°C et 34°C dans le reste du pays.
Ce vendredi, selon l’Institut National de la Météorologie (INM), le temps sera généralement dégagé à légèrement nuageux sur la majeure partie du territoire tunisien. Les températures afficheront une nette différence selon les régions : elles oscilleront entre 23°C et 28°C sur les régions côtières et les hauteurs, tandis que le thermomètre indiquera entre 29°C et 34°C dans le reste du pays.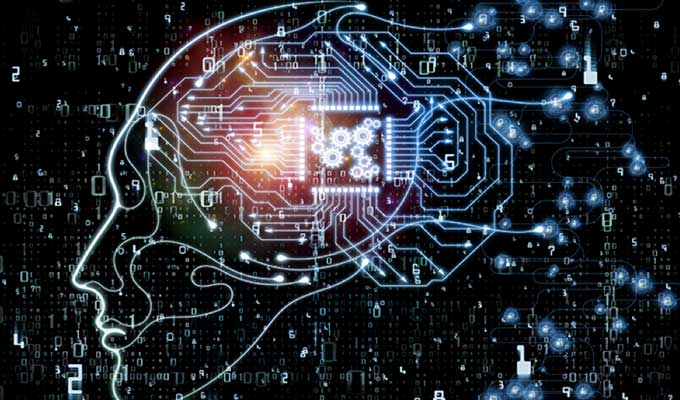 En dépit de cette atmosphère de précarité, de frustration et d’impuissance qui règne dans le pays, il y a, de temps en temps, des informations heureuses qui surgissent et viennent nous embaumer le cœur.
En dépit de cette atmosphère de précarité, de frustration et d’impuissance qui règne dans le pays, il y a, de temps en temps, des informations heureuses qui surgissent et viennent nous embaumer le cœur.