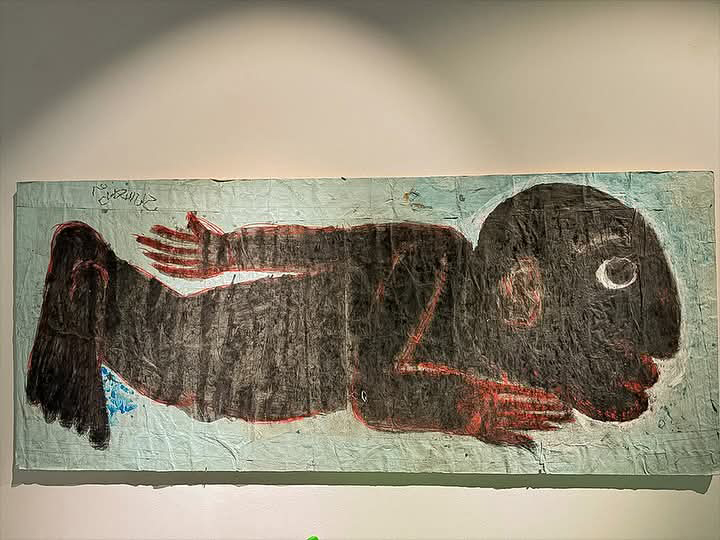Il est prévu l’introduction de réformes, notamment les plus urgentes, dans le cadre du Plan de développement 2026-2030, sur lesquelles travaille le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, et dans le cadre de la préparation de la nouvelle année de formation. En clair, le ministère a souhaité diversifier les spécialités de formation et offrir des conditions appropriées aux stagiaires.
La Presse — Donner une seconde chance aux personnes en marge de l’éducation, de l’apprentissage et de la formation professionnelle, telle est l’ambition des pouvoirs publics tunisiens. Loin du concept de l’école de la 2e chance qui n’a donné que des résultats peu significatifs à l’échelle nationale, c’est plutôt vers les moyens d’accompagner les personnes éducativement et académiquement marginalisées qui est désormais recherchée.
Pour atteindre de nouveaux objectifs, deux ministères sont en train de mettre en œuvre des actions en vue d’obtenir des résultats tangibles à terme. Le ministère des Affaires sociales a ainsi lancé une stratégie nationale pour le droit à l’apprentissage tout au long de la vie, mais aussi le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a mis en place de nouveaux débouchés en termes de formation, plus en phase et en synergie avec le marché de l’emploi.
Ainsi de nouvelles spécialités formatrices ont été créées pour donner plus de chances et d’opportunités aux personnes qui ne sont pas incluses dans les grandes filières de la formation professionnelle.
L’Agence tunisienne de la formation professionnelle a mis en œuvre un ensemble de démarches pour aboutir à la création de postes et de débouchés manquant dans le secteur. Dans ce contexte, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a récemment développé l’examen qui porte sur certains points et observations qui ont été formulés par l’Atfp, grâce aux diagnostics du système de Formation professionnelle.
Le ministre Riadh Chaoued a souligné que le système de gestion de son ministère prépare les ressources humaines futures à un meilleur accès à l’emploi, notamment à travers la réduction du chômage. Il a estimé qu’une révision du cadre actuel, puis des programmes de formation, est nécessaire.
Une mise à jour, également au niveau des bâtiments et de la maintenance, puis de nombreux autres secteurs d’activités devrait avoir lieu. Il est prévu l’introduction de réformes, notamment celles les plus urgentes dans le cadre du Plan de développement 2026-2030 sur lesquelles travaille le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et dans le cadre de la préparation de la nouvelle année de formation. En clair, le ministère a souhaité diversifier les spécialités de formation et offrir des conditions appropriées aux stagiaires.
Des formations ont été dispensées au bénéfice de 24 000 nouveaux stagiaires, dans les centres de toute la république. De nombreux niveaux de formation ont été créés à Siliana. Un poste de technicien supérieur à Sbeïtla, un technicien professionnel qualifié a été recruté au Centre de Formation et de brevets de Gafsa.
Travaillant de manière autonome, il possède une qualification technique élevée et un certificat de compétence professionnelle en soudage. Aujourd’hui, après presque des années d’inactivité, nous assisterons au lancement de notre centre de formation au Kef. Pour un lancement effectif en septembre. En réalité, c’est la diversification des spécialités de formation, durant la session d’automne, qui est recherchée.
L’Atfp sur plusieurs fronts
Ilyes Chérif, directeur général de l’Atfp, a donné un autre son de cloche, en marge du colloque sur la nouvelle année de formation professionnelle, tenu récemment à Tunis :
« Ce nouvel accompagnement institutionnel est venu en réponse au marché du travail et pour examiner l’étendue de la capacité opérationnelle des spécialités concernées au niveau du marché de l’emploi. La formation professionnelle, oui, mais en tenant compte de l’importance de l’insertion professionnelle sur le marché.
Notre stratégie reposera et s’appuiera au niveau de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle sur les deux éléments les plus importants, la motivation et l’attractivité de la formation professionnelle.
La formation professionnelle est un choix, et non un choix nécessaire. Le deuxième point concerne l’amélioration de la qualité de la formation professionnelle. Il s’agit de l’implication du tissu économique dans le système. L’implication d’économistes dès les premières étapes de la formation professionnelle du stagiaire ou du candidat à l’emploi est remise au goût du jour.
De manière claire pour toutes les parties prenantes cela permettra d’unifier les concepts. Le problème réside dans l’absence de procédures globales, ce pourquoi le forum a visé à examiner les problèmes qui existent ».
En marge de ce colloque et dans le cadre de l’emploi, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle a évoqué la volonté du ministère de conclure des accords avec les grandes institutions. Dans ce contexte, des accords ont été signés avec plusieurs institutions et les recrutements ont débuté avec un objectif de 12 000 emplois. Lui emboîtant le pas, le ministère des Affaires sociales n’est pas en reste et a développé un créneau pour faire face à l’analphabétisme en Tunisie.
Une action qui peut être en synergie avec celle du ministère de la Formation professionnelle et son organe principal, l’Atfp, principale sentinelle vers les métiers du secteur secondaire ou tertiaire. Le degré de réussite de l’intégration de chaque apprenant ou du stagiaire est le cheval de bataille des deux ministères évoqués.
Eradiquer l’analphabétisme
La lutte contre l’analphabétisme, qui touche 19,2% de la population tunisienne, a été placée au centre de l’intérêt des pouvoirs publics. Dans ce contexte, lundi 8 septembre 2025 à la Bourse de l’emploi de Tunis, le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, a affirmé « œuvrer au développement du programme d’éducation des adultes afin de renforcer l’autonomie des apprenants et de soutenir leur intégration économique et sociale ».
Il a présidé la commémoration de la Journée internationale de l’alphabétisation, célébrée chaque année le 8 septembre. L’événement était organisé par le Centre national d’éducation des adultes sur le thème « L’apprentissage tout au long de la vie : de l’alphabet aux compétences essentielles ». Il a également présenté des expériences réussies de plusieurs centres modèles d’apprentissage tout au long de la vie (le Centre « Frineen » à Nabeul, le Centre « Borj Touil » à l’Ariana et le Centre Manouba).
Le ministre a souligné, à cette occasion, que le concept du Programme d’apprentissage tout au long de la vie repose sur le principe du droit à l’éducation et son ouverture à tous sans exception, conformément aux garanties de la Constitution tunisienne et au principe d’une éducation démocratique et inclusive pour tous les groupes sociaux, tous les âges et tous les niveaux.
Il a souligné que les axes les plus importants du travail du ministère des Affaires sociales dans l’élaboration de ce programme concernent principalement le passage de la simple lecture au développement des acquis d’apprentissage et au renforcement de l’autonomie des apprenants, favorisant ainsi leur intégration économique et sociale dans un environnement global et inclusif, remplissant ainsi le rôle social de l’État. Il a également mis l’accent sur la coordination entre les parties prenantes, en particulier le ministère de l’Éducation, afin de réduire le décrochage scolaire.
Dans le même contexte, le ministre des Affaires sociales a indiqué que des travaux sont en cours, en coopération avec
l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alecso), pour élaborer un programme pratique et efficace sur la stratégie nationale d’alphabétisation et d’apprentissage tout au long de la vie, qui servira de document de référence pour les politiques sociales du ministère. Le lien entre la scolarité et les compétences de vie et le soutien à l’intégration globale des apprenants ont été soulignés.
À cette occasion, le ministre des Affaires sociales a honoré les étudiants exceptionnels ayant obtenu un certificat d’éducation sociale et un certificat de compétence professionnelle, ainsi que plusieurs entrepreneurs diplômés de centres de formation continue.
L’intégration économique et sociale en Tunisie est au cœur d’une dynamique de réformes profondes, menée conjointement par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et celui des Affaires sociales.
Ces efforts concertés visent à offrir une seconde chance aux personnes en marge de l’éducation et du marché de l’emploi.
Plutôt que de s’en tenir à des modèles traditionnels peu performants, les pouvoirs publics misent sur des actions concrètes et synergiques, comme le développement de nouvelles spécialités de formation plus adaptées aux besoins du marché du travail et le renforcement de l’autonomie des apprenants.
Les actions menées par l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (Atfp), en synergie avec les politiques du ministère de l’Emploi, sont orientées vers une amélioration de la qualité et de l’attractivité de la formation professionnelle. L’objectif est de la positionner comme un choix motivant plutôt qu’une solution par défaut.
De plus, l’accent mis sur l’implication du secteur économique dès les premières étapes de la formation est crucial pour garantir l’adéquation entre les compétences enseignées et les exigences des entreprises. Parallèlement, la lutte contre l’analphabétisme, portée par le ministère des Affaires sociales, s’inscrit dans cette même vision de l’apprentissage tout au long de la vie.
Les initiatives, comme celles célébrées lors de la Journée internationale de l’alphabétisation, visent à doter les individus non seulement des compétences de base en lecture et écriture, mais aussi des compétences de vie essentielles pour leur intégration économique et sociale.
<Cette coordination entre les ministères est la clé du succès, créant un pont entre l’éducation et l’emploi pour réduire le décrochage scolaire et le chômage.
En somme, ces réformes en cours, inscrites dans le Plan de développement 2026-2030, représentent un pas significatif vers un système plus démocratique et inclusif, où chaque citoyen, quel que soit son parcours, a le droit de se former et de s’épanouir professionnellement.