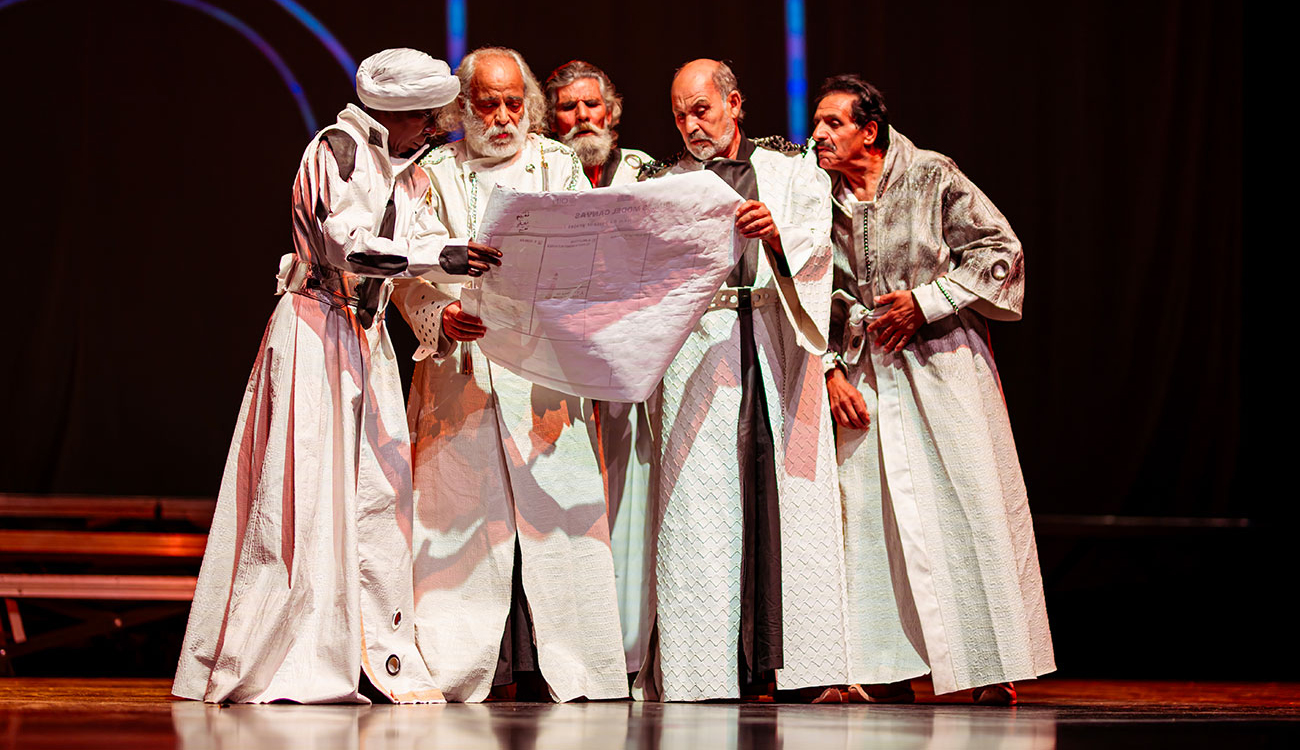Deux informations ont été données presque au cours de la même semaine. La première nous est parvenue de Sfax, où on a inauguré une œuvre d’art, représentant les agents de nettoiement de la municipalité.
La Presse — Ces hommes qui, par tous les temps, qu’il vente où qu’il pleuve, qu’une brise fraîche permet de renouer avec la vie ou sous l’effet d’un sirocco qui assèche les gorges et excite à fond les glandes sudoripares, sous une chaleur caniculaire, viennent ramasser les déchets de leurs concitoyens.
Un service public d’une importance incommensurable
Nous avons tous une idée de ce que représentent ces déchets et leurs dégâts, tant au point de vie hygiène que santé.
L’idée est géniale et cet acte de reconnaissance pour ces hommes qui le méritent est louable.
La seconde, concerne la désignation des municipalités les plus propres du pays. C’est ainsi que les villes d’Aïn Jloula (gouvernorat de Kairouan), Ras Jebel (gouvernorat de Bizerte), Sned (gouvernorat de Gafsa), Bir Lahmar (gouvernorat de Tataouine) et Lamta (gouvernorat de Monastir) ont été désignées comme les villes les plus propres à l’échelle nationale pour l’année 2025.
Les municipalités de ces villes ont été reconnues désignées comme les plus actives au niveau de la préservation des conditions d’hygiène et de propreté au niveau national. Extraordinaire!
Bien sûr, ces bouts de territoire de notre pays, ce n’est pas la capitale, un chef-lieu de gouvernorat, mais ils représentent une image positive qui honore aussi bien les citoyens de ces villes, que les responsables qui veillent sur elles.
Ces responsables assurément ne se vautrent pas dans leurs bureaux, mais se sentent bien à la faveur des tournées d’inspection qu’ils effectuent, pour que propreté et hygiène se conjuguent au présent et jamais au passé.
C’est que cette citation a été prononcée après avoir tenu compte de deux critères importants.
On a estimé qu’elle le méritait au niveau régional c’est-à-dire en tant qu’entité faisant partie des gouvernorats respectifs et au plan national à la suite des avis des autorités compétentes pour juger des résultats de cette gestion des affaires municipales. Une évaluation rigoureuse, menée par des équipes pluridisciplinaires relevant des ministères de l’Intérieur et de l’Équipement.
Les visites, il est inutile de le préciser, ont été effectuées de manière impromptue. Il n’y avait donc pas possibilité de se préparer à l’avance et d’effectuer un toilettage de circonstance. Tel qu’on le fait lorsqu’on apprend qu’un ministre est de passage. Une louche de goudron par-ci, des trottoirs repeints par-là et le tour est joué.
Cet aspect resplendissant ne pouvait, et en aucun cas être possible sans l’engagement ferme des agents municipaux, d’une part, et ne l’oublions pas, les efforts des citoyens de ces villes, d’autre part.
La collecte des ordures, le nettoyage des rues et des lieux publics, l’entretien des parcs et des espaces verts, la fourniture des conteneurs à déchets en nombre suffisant et leur placement en des endroits appropriés, l’organisation des campagnes de sensibilisation des citoyens sont des tâches quotidiennes qui nécessitent une communication régulière, une complicité entre agents et citoyens.
Le rôle des citoyens est aussi primordial qu’essentiel et incontournable pour la réussite de ce genre d’action.
Ce sont eux qui ont commencé à balayer devant leurs portes. Aucun d’entre eux n’est allé jeter ses ordures ménagères devant la porte du voisin ni ne s’est débarrassé d’un objet inutile en le mettant sous un arbre à l’abri des regards.
Mais l’estimation qui a fait des municipalités de ces villes les plus propres du pays ne s’est pas limitée aux seules activités dépendant directement des services municipaux.
On a effectué des visites de contrôle et d’inspection aux marchés municipaux, sans oublier les abattoirs, les espaces verts publics de plein air, vérifié l’état du matériel d’intervention des agents, inspecté les dépôts municipaux, les ateliers de formation, les services de réparation mécanique et autres, les lieux consacrés au lavage et à la remise en état des véhicules utilitaires municipaux et…. les cimetières.
Eh oui, les morts, nos aïeuls décédés, n’ont pas été oubliés. Allez voir dans quel état se trouvent bien des cimetières, où le désordre règne et où l’on se croirait en pleine savane.
Sans oublier les projets en cours d’exécution, tels que le bitumage des rues, la mise en place et en état des trottoirs, l’éclairage public, l’adduction de l’eau potable, etc.
Ont participé à cette élection de la municipalité les plus propres du pays, des organismes nationaux et internationaux.
Cela donne une idée du sérieux de cette initiative, qui honore et devrait donner plein d’idées à ceux qui hésitent à faire le minimum.
Ces villes lauréates de cette année, l’ont fait. C’est donc possible. À la condition que toutes les parties prenantes s’y mettent.
Où se trouve le maillon faible qui freine, bloque et dénature la mission des services publics?