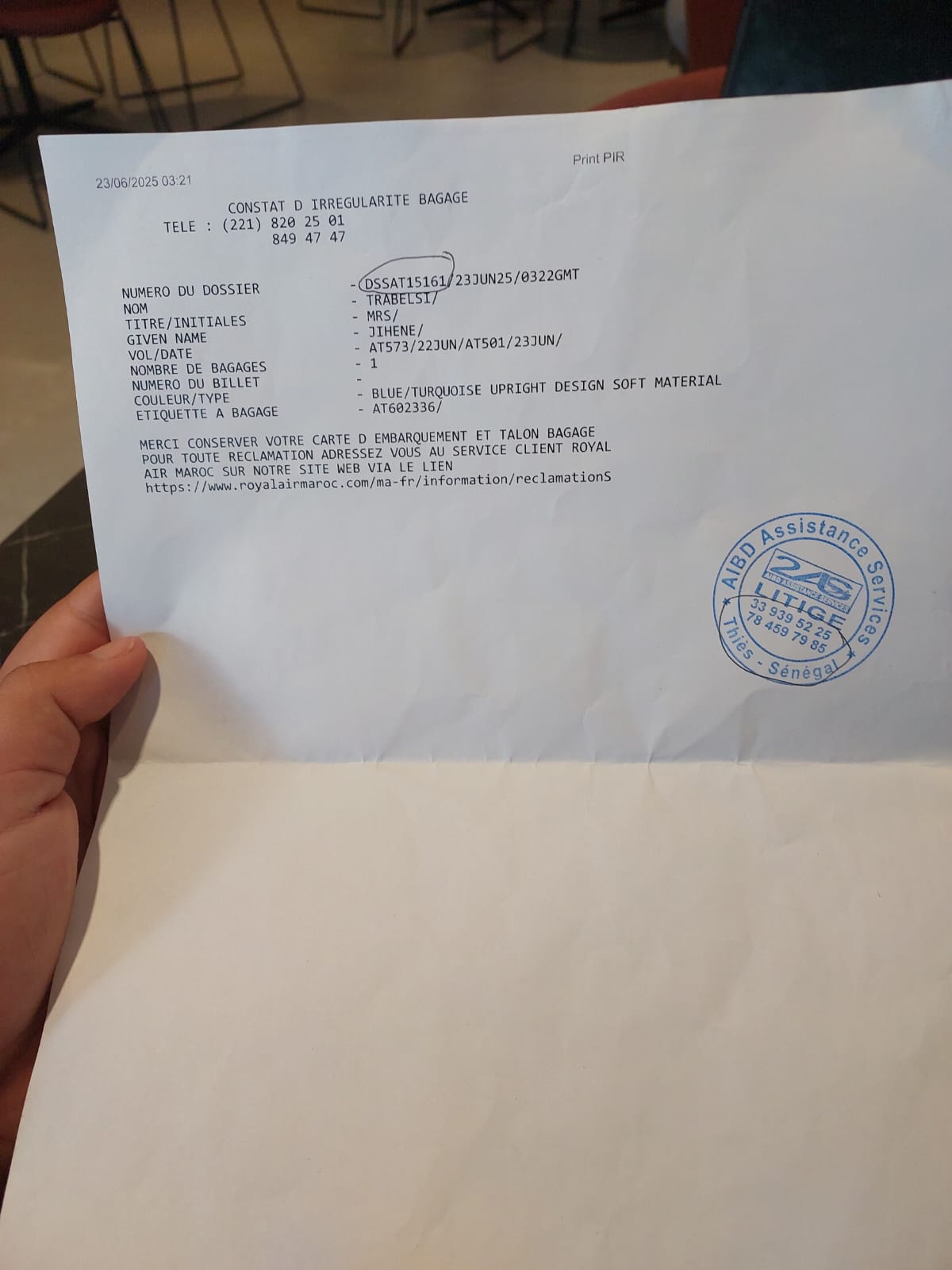ZOOM – Politique monétaire tunisienne : quand la cible tue l’indicateur
En Tunisie, alors que l’inflation persiste et que les déséquilibres économiques s’accentuent, la Banque centrale s’appuie toujours sur des instruments monétaires classiques pour stabiliser l’économie. Pourtant, la Loi de Goodhart (*) nous avertit : dès qu’un indicateur devient une cible politique, il cesse d’être un bon indicateur. À l’heure où le taux directeur, la masse monétaire ou encore l’inflation deviennent des objectifs en soi, leur valeur informative s’efface et l’efficacité des politiques publiques s’en trouve affaiblie.
L’indicateur devenu idole : le piège théorique de Goodhart
La Loi de Goodhart, énoncée dans les années 1970, résume une vérité fondamentale : lorsqu’un indicateur est érigé en objectif politique, il perd sa fonction de signal neutre. En matière de politique monétaire, cela signifie que des instruments tels que le taux directeur ou les agrégats monétaires, s’ils sont poursuivis comme des cibles rigides, peuvent produire des effets contre-productifs.
En Tunisie, cette loi trouve un écho particulier dans un contexte où la complexité des déséquilibres dépasse les schémas traditionnels. L’économie est fortement marquée par l’informalité, une instabilité budgétaire chronique, une dépendance aux importations et des tensions géopolitiques régionales. Dans cet environnement, cibler des indicateurs désincarnés revient souvent à piloter à vue.
Taux directeur : outil de crédibilité ou mirage anti-inflation?
Depuis 2018, la Banque centrale de Tunisie a progressivement adopté une approche implicite de ciblage de l’inflation. Le taux directeur en est devenu l’outil central, ajusté pour maîtriser les tensions sur les prix. Toutefois, cette mécanique repose sur une hypothèse devenue discutable : celle d’une inflation alimentée essentiellement par la demande.
L’économie tunisienne est fortement marquée par l’informalité, une instabilité budgétaire chronique, une dépendance aux importations et des tensions géopolitiques régionales. Dans cet environnement, cibler des indicateurs désincarnés revient souvent à piloter à vue.
Or, dans la réalité tunisienne, l’inflation est principalement d’origine structurelle et/ou importée. La dépréciation du dinar, la flambée des prix des matières premières, la dérégulation rampante de certains produits, la spéculation sur les biens de consommation et les blocages logistiques jouent un rôle bien plus déterminant que la dynamique de crédit.
Dans ce contexte, le relèvement du taux directeur agit surtout comme un signal adressé aux partenaires internationaux, sans effets significatifs sur les causes profondes de la hausse des prix. Il pénalise le crédit à l’investissement, étrangle les ménages endettés et bride une économie déjà sous-performante. Devenu cible politique, le taux directeur perd sa pertinence en tant que boussole économique.
La dépréciation du dinar, la flambée des prix des matières premières, la dérégulation rampante de certains produits, la spéculation sur les biens de consommation et les blocages logistiques jouent un rôle bien plus déterminant que la dynamique de crédit.
La masse monétaire, reflet déformé d’une économie duale
Les agrégats monétaires, tels que M2 ou M3, étaient autrefois considérés comme des repères fiables pour anticiper l’inflation. En Tunisie, ces indicateurs ont pourtant de plus en plus de mal à refléter la réalité économique.
Une grande partie de la liquidité circule aujourd’hui en dehors du système bancaire formel. L’économie informelle, la thésaurisation en cash ou en devises, et la montée des circuits non régulés de crédit brouillent la lecture des agrégats. La masse monétaire peut croître sans alimenter l’activité réelle ni déclencher une inflation mesurable par les canaux traditionnels.
Lorsque la Banque centrale ajuste ses instruments en se basant sur ces indicateurs, elle risque de sur-réagir ou de sous-estimer les tensions systémiques. En visant des objectifs chiffrés de croissance monétaire, elle poursuit un mirage statistique, et s’éloigne des dynamiques concrètes de la production, de la consommation et de l’emploi.
La dérive des indicateurs : une menace pour la crédibilité monétaire
Le danger souligné par la Loi de Goodhart ne se limite pas à la perte d’efficacité des outils. Il touche aussi à la crédibilité des institutions. Lorsque l’objectif affiché d’une inflation à 6,5 % ou même 5,4 %, n’est pas atteint pendant plusieurs trimestres consécutifs, ou que les hausses de taux n’entraînent aucune baisse des prix, la Banque centrale perd en autorité.
Cette crise de confiance est d’autant plus aiguë que la politique monétaire tunisienne évolue dans un cadre désarticulé. D’un côté, une Banque centrale qui agit sur la liquidité. De l’autre, un État dont la gestion budgétaire alimente les tensions inflationnistes, à travers des déficits mal maîtrisés, des subventions opaques et un endettement qui écrase l’espace fiscal.
La BCT se retrouve donc isolée, enfermée dans une logique technocratique où les cibles monétaires remplacent l’analyse des causes profondes. Cette dissonance réduit son influence sur les anticipations des agents économiques.
Cette crise de confiance est d’autant plus aiguë que la politique monétaire tunisienne évolue dans un cadre désarticulé. D’un côté, une Banque centrale qui agit sur la liquidité. De l’autre, un État dont la gestion budgétaire alimente les tensions inflationnistes, à travers des déficits mal maîtrisés, des subventions opaques, et un endettement qui écrase l’espace fiscal.
Vers une politique monétaire plus intelligente et moins mécanique?
Face à cette impasse, la Tunisie gagnerait à redéfinir sa stratégie monétaire autour de principes plus souples et mieux ancrés dans la réalité. Il s’agit d’abord de repenser le rôle des indicateurs. Les données classiques doivent être enrichies par des observations issues du terrain : dynamique des prix réels dans les circuits informels, marges de distribution, prix d’éviction sur les marchés alimentaires.
La coordination entre politique monétaire et politique budgétaire ne devient-elle pas indispensable, dès lors qu’aucune stabilité des prix ne peut être durable si les finances publiques entretiennent en permanence l’instabilité?
La Banque centrale peut-elle encore se permettre de croire à l’illusion d’un pilotage par les seuls chiffres?
L’objectif d’une politique monétaire ne doit-il pas dépasser une cible unique et figée, pour intégrer désormais les aléas climatiques, géopolitiques et sociaux, et s’ajuster à un horizon plus large, orienté vers une croissance inclusive, la stabilité sociale et la préservation du tissu productif?
La coordination entre politique monétaire et politique budgétaire ne devient-elle pas indispensable, dès lors qu’aucune stabilité des prix ne peut être durable si les finances publiques entretiennent en permanence l’instabilité ? La Banque centrale peut-elle encore se permettre de croire à l’illusion d’un pilotage par les seuls chiffres?
L’intelligence des politiques économiques ne réside-t-elle pas dans la modestie des instruments utilisés?
La Loi de Goodhart rappelle une vérité que les décideurs oublient parfois : dans une économie vivante, les indicateurs sont des balises, pas des idoles. À force de transformer le taux directeur, la masse monétaire ou l’inflation en objectifs rigides, on s’éloigne de la complexité du réel.
En Tunisie, une politique monétaire moderne ne sera ni quantitative ni dogmatique. Elle sera contextuelle, coordonnée et profondément lucide.
————————–
*« Toute régularité statistique observée tend à perdre toute crédibilité dès qu’elle est mise sous tension à des fins de contrôle ».
===============================
* Dr. Tahar EL ALMI,
Economiste-Economètre.
Ancien Enseignant-Chercheur à l’ISG-TUNIS,
Psd-Fondateur de l’Institut Africain
D’Economie Financière (IAEF-ONG)
L’article ZOOM – Politique monétaire tunisienne : quand la cible tue l’indicateur est apparu en premier sur Leconomiste Maghrebin.